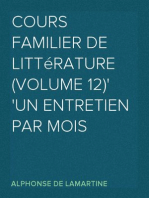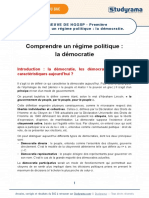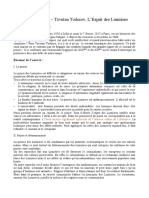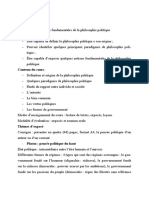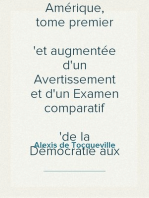Professional Documents
Culture Documents
J.S MILL de La Liberté
Uploaded by
Deborah BardetOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
J.S MILL de La Liberté
Uploaded by
Deborah BardetCopyright:
Available Formats
John Stuart MILL (1859)
De la libert
Traduit de langlais par Laurence Lenglet partir de la traduction de Dupond White (en 1860)
Un document produit en version numrique par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales" Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
John Stuart Mill (1859), De la libert
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi partir de :
John Stuart Mill (1859)
DE LA LIBERT.
Une dition lectronique ralise partir du livre de John Stuart Mill (1859), De la libert. Traduit de langlais par Laurence Lenglet partir de la traduction de Dupond White en 1860.
Polices de caractres utilise : Pour le texte: Times, 12 points. Pour les citations : Times 10 points. Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2001 pour Macintosh. Mise en page sur papier format LETTRE (US letter), 8.5 x 11) dition complte le 19 mai 2002 Chicoutimi, Qubec.
John Stuart Mill (1859), De la libert
Table des matires
I. II. III. IV. V.
Introduction De la libert de pense et de discussion De l'individualit comme l'un des lments du bien-tre Des limites de l'autorit de la socit sur l'individu Applications
John Stuart Mill (1859), De la libert
John Stuart Mill : De la libert Traduit de l'anglais par Laurence Lenglet partir de la traduction de Dupond White Le sujet de cet essai est la libert sociale ou civile : la nature et les limites du pouvoir que la socit peut lgitimement exercer sur l'individu. Cette question, bien que rarement pose ou thorise, influence profondment les controverses pratiques de notre poque par sa prsence latente et devrait bientt s'imposer comme la question vitale de l'avenir. ( ... ) Je considre l'utilit comme le critre absolu dans toutes les questions thiques ; mais ici l'utilit doit tre prise dans son sens le plus large : se fonder sur les intrts permanents de lhomme en tant qu'tre susceptible de progrs. Je soutiens que ces intrts autorisent la sujtion de la spontanit individuelle un contrle extrieur uniquement pour les actions de chacun qui touchent l'intrt d'autrui. J. S. M.
John Stuart Mill (1859), De la libert
Chapitre I
Introduction
Retour la table des matires
Le sujet de cet essai n'est pas ce qu'on appelle le libre arbitre - doctrine oppose tort la prtendue ncessit philosophique -, mais la libert sociale ou civile : la nature et les limites du pouvoir que la socit peut lgitimement exercer sur l'individu. Cette question, bien que rarement pose ou thorise, influence profondment les controverses pratiques de notre poque par sa prsence latente et devrait bientt s'imposer comme la question vitale de l'avenir. En un certain sens, elle divise depuis toujours l'humanit; aussi est-elle loin d'tre neuve. Mais tant donn le niveau de progrs atteint aujourd'hui par les peuples les plus civiliss, elle se prsente sous des formes nouvelles et ncessite un traitement diffrent et plus fondamental. La lutte entre libert et autorit est le trait le plus remarquable de ces priodes historiques qui nous sont familires ds l'enfance, comme la Grce, la Rome antique et l'Angleterre notamment. Mais autrefois, c'tait une dispute qui opposait le souverain ses sujets, ou certaines classes de ses sujets. Par libert, on entendait protection contre la tyrannie des souverains ; gouvernants et gouverns tenaient alors des positions ncessairement antagonistes. Le pouvoir tait aux mains d'un individu, d'une tribu ou d'une caste qui avaient acquis leur autorit soit par hritage, soit par conqute, mais
John Stuart Mill (1859), De la libert
ne la tenait en aucun cas du peuple; et nul n'osait, ni ne dsirait peut-tre, contester leur suprmatie, quelles que fussent les prcautions prendre contre l'exercice oppressif qu'ils en faisaient. Le pouvoir des gouvernants tait ressenti la fois comme ncessaire et extrmement dangereux: comme une arme qu'ils pouvaient loisir retourner et contre leurs sujets et contre leurs ennemis extrieurs. Pour viter que d'innombrables vautours ne fondent sur les membres les plus faibles de la communaut, il avait bien fallu charger un aigle, plus puissant celui-l, de les tenir en respect. Mais comme le roi des oiseaux n'tait pas moins enclin que les charognards infrieurs fondre sur le troupeau, on vivait perptuellement dans la crainte de son bec et de ses serres. Aussi le but des patriotes tait-il d'imposer des limites, supportables pour la communaut, au pouvoir du gouvernant: c'est cette limitation qu'ils nommaient libert. Il y avait deux faons d'y parvenir. Tout d'abord, en obtenant la reconnaissance de certaines immunits, appeles liberts ou droits politiques, que le gouvernant ne pouvait transgresser sans manquer son devoir et dclencher une rsistance spcifique ou une rbellion gnrale, alors tout fait justifie. Le second expdient, gnralement plus rcent, fut l'tablissement de freins constitutionnels : le consentement de la communaut - ou d'un corps quelconque cens reprsenter ses intrts - devenait la condition ncessaire de certains actes les plus importants du gouvernement. Au premier de ces modes de restriction, les gouvernants de la plupart des pays d'Europe furent plus ou moins contraints de se soumettre. Il n'en fut pas ainsi du second: l'instaurer - ou achever de l'instaurer lorsqu'il n'existait encore que partiellement - devint partout le but atteindre des amoureux de la libert. Et tant que l'humanit se contenta de combattre un ennemi par l'autre, et de se laisser diriger par un matre condition d'tre garantie plus ou moins efficacement contre sa tyrannie, elle n'aspira rien de plus. Mais dans la marche des affaires humaines vint le temps o les hommes cessrent de considrer qu'une loi naturelle confrait leurs gouvernants un pouvoir indpendant, oppos leurs propres intrts. Il fallait que les diffrents magistrats de l'tat fussent pour eux des tenants, des dlgus, rvocables leur gr. C'tait, leur semblait-il, la seule faon de se prmunir compltement contre les abus de pouvoir du gouvernement. Peu peu, cette revendication - ce besoin nouveau de gouvernants lectifs et temporaires - devint l'objet principal des efforts du parti dmocratique partout o un tel parti existait et se substitua trs largement l'ancienne volont de limiter le pouvoir des gouvernants. Tandis qu'on luttait pour placer le pouvoir des gouvernants sous la tutelle des gouverns, certains se mirent penser qu'on avait attach trop d'importance la limitation du pouvoir lui-mme. C'tait une ressource uniquement (semblait-il) lorsque les dirigeants avaient des intrts opposs ceux du peuple. A prsent, ce qu'on voulait, c'tait que les dirigeants fussent identifis au peuple : que leurs intrts et leur volont devinssent les intrts et la volont de la nation. La nation n'avait nul besoin d'tre protge contre sa propre volont; il n'y avait aucun risque qu'elle ne se tyrannist elle-mme. Si les gouvernants taient effectivement responsables devant elle, promptement rvocables par elle, elle serait alors en mesure de leur confier un pouvoir dont elle dicterait elle-mme l'usage. Leur pouvoir ne serait plus que celui de la nation, concentr sous une forme propice son
John Stuart Mill (1859), De la libert
exercice. Cette faon de penser - de sentir peut-tre - tait rpandue dans la dernire gnration du libralisme europen et semble prdominer encore dans sa section continentale. Ceux qui admettent une limite ce que peut faire un gouvernement, sauf s'il s'agit selon eux d'un gouvernement illgitime, font figure de brillantes exceptions parmi les penseurs politiques du Continent. Et aujourd'hui mme, une tendance similaire se serait impose chez, nous si les circonstances qui l'encouragrent un temps ne s'taient pas modifies depuis. Mais, dans les thories politiques et philosophiques comme chez les personnes, le succs rvle des fautes et des infirmits que l'chec et peut-tre drobes l'observation. L'ide que les peuples n'ont pas besoin de limiter leur pouvoir sur eux-mmes pouvait sembler axiomatique lorsqu'un gouvernement dmocratique n'existait encore que dans nos rves ou nos livres d'histoires. Mais cette ide ne se laisse pas pour autant amoindrir par les aberrations passagres de la Rvolution franaise dont les plus graves furent le fait d'une minorit usurpatrice et qui, par ailleurs, ne trouvrent pas de lgitimit dans les institutions dmocratiques, mais dans une explosion de rvolte soudaine et convulsive contre le despotisme aristocratique et monarchique. Cependant, avec le temps, une rpublique dmocratique vint occuper une grande partie de la surface de la terre et s'imposa comme l'un des membres les plus puissants de la communaut des nations; ds lors, le gouvernement lectif et responsable devint l'objet de ces observations et de ces critiques qu'on adresse tout grand fait existant. C'est alors qu'on s'aperut que des expressions telles que l'autonomie politique et le pouvoir du peuple sur lui-mme n'exprimaient pas un vritable tat de choses. Les gens du peuple qui exercent le pouvoir ne sont pas toujours les mmes que ceux sur qui il s'exerce; et l'autonomie politique en question n'est pas le gouvernement de chacun par soi-mme, mais celui de chacun par tous les autres. Bien plus, la volont du peuple signifie en pratique la volont du plus grand nombre ou de la partie la plus active du peuple: de la majorit, ou ceux qui parviennent s'imposer en tant que majorit. Il est donc possible que les gens du peuple soient tents d'opprimer une partie des leurs ; aussi est-ce un abus de pouvoir dont il faut se prmunir au mme titre qu'un autre. C'est pourquoi il demeure primordial de limiter le pouvoir du gouvernement sur les individus, mme lorsque les dtenteurs du pouvoir sont rgulirement responsables devant la communaut, c'est--dire devant son parti le plus fort. Si cette conception est devenue ralit, c'est qu'elle s'est impose d'elle-mme tant l'intelligence des penseurs qu'aux inclinations de ces classes importantes de la socit europenne qui, tort ou raison, voient en la dmocratie une menace pour leurs intrts. Ainsi range-t-on aujourd'hui, dans les spculations politiques, la tyrannie de la majorit au nombre de ces maux contre lesquels la socit doit se protger. De mme que les autres tyrannies, la tyrannie de la majorit inspirait - et inspire encore gnralement - de la crainte d'abord parce qu'elle transparaissait dans les actes des autorits publiques. Mais les gens rflchis s'aperurent que, lorsque la socit devient le tyran - lorsque la masse en vient opprimer l'individu - ses moyens de tyranniser ne se limitent pas aux actes qu'elle impose ses fonctionnaires politiques. La socit applique les dcisions qu'elle prend. Si elle en prend de mauvaises, si elle veut
John Stuart Mill (1859), De la libert
ce faisant s'ingrer dans des affaires qui ne sont pas de son ressort, elle pratique une tyrannie sociale d'une ampleur nouvelle - diffrente des formes d'oppression politique qui s'imposent coups de sanctions pnales - tyrannie qui laisse d'autant moins d'chappatoire qu'elle va jusqu' se glisser dans les plus petits dtails de la vie, asservissant ainsi l'me elle-mme. Se protger contre la tyrannie du magistrat ne suffit donc pas. Il faut aussi se protger contre la tyrannie de l'opinion et du sentiment dominants, contre la tendance de la socit imposer, par d'autres moyens que les sanctions pnales, ses propres ides et ses propres pratiques comme rgles de conduite ceux qui ne seraient pas de son avis. Il faut encore se protger contre sa tendance entraver le dveloppement - sinon empcher la formation - de toute individualit qui ne serait pas en harmonie avec ses murs et faonner tous les caractres sur un modle prtabli. Il existe une limite l'ingrence lgitime de l'opinion collective dans l'indpendance individuelle : trouver cette limite - et la dfendre contre tout empitement ventuel - est tout aussi indispensable la bonne marche des affaires humaines que se protger contre le despotisme politique. Mais si cette question n'est gure contestable en thorie, celle de savoir o placer cette limite dans la pratique - trouver le juste milieu entre indpendance individuelle et contrle social - est un domaine o presque tout reste explorer. Tout ce qui donne sa valeur notre existence repose sur les restrictions poses aux actions d'autrui. Il est donc ncessaire d'imposer certaines rgles de conduite, par la loi d'abord; puis, pour les nombreuses questions qui ne sont pas de son ressort, par l'opinion. Ce que doivent tre ces rgles est le problme majeur des socits humaines. C'est un problme qui n'a pas encore trouv de solution vritable. Il n'y a pas deux poques, voire deux pays, qui l'aient tranch de la mme faon; et la solution adopte par une poque ou un pays donn a toujours t une source d'tonnement pour les autres. Pourtant, l'humanit n'a jamais accord ce problme qu'une attention limite, comme s'il y avait toujours eu consensus sur la question. Les rgles qui ont cours dans les diffrents pays sont si videntes pour leurs habitants qu'elles semblent naturelles. Cette illusion universelle est un exemple de l'influence magique de l'habitude qui, comme le dit le proverbe, devient non seulement une seconde nature, mais se confond constamment avec la premire. La coutume, qui neutralise toute critique ventuelle des rgles de conduite que l'humanit s'impose elle-mme, est une arme d'autant plus efficace que nul n'prouve gnralement le besoin de la remettre en question, que ce soit collectivement ou individuellement. Les gens ont pris l'habitude de croire - et ceux qui passent pour des philosophes les ont encourags dans ce sens - que leur opinion personnelle sur ce genre de questions rendait superflue toute remise en question globale. Dans la pratique, le principe qui dtermine leur opinion sur la conduite adopter provient de l'ide qu'il existe en chacun la mme volont de se comporter en modle pour son voisin et de se conformer au modle que reprsentent ses amis. Personne ne conoit en effet qu'un choix puisse tre le rsultat d'une inclination personnelle. En revanche, un avis premptoire sur la conduite adopter dans telle ou telle situation, voil ce qui tait office d'inclination personnelle,, que l'on en vienne expliquer les raisons de ce choix, et l'on constate qu'il est le plus souvent motiv par l'inclination du plus grand nombre. Cependant, que l'inclination de l'homme ordinaire
John Stuart Mill (1859), De la libert
soit rgie par celle du plus grand nombre est pour lui non seulement un critre tout fait satisfaisant, mais celui qui dtermine toutes ses notions de moralit, de got ou de convenance, autant de questions qui ne sont pas expressment abordes par sa religion - le critre qui dtermine mme l'interprtation de sa foi. En consquence, les opinions des hommes sur ce qui est louable ou blmable sont le produit de causes multiples - tantt la raison, tantt les prjugs ou les superstitions ; souvent la sociabilit, assez frquemment les penchants antisociaux, l'envie ou la jalousie, l'arrogance ou le mpris ; mais surtout l'ambition ou la peur de perdre: l'intrt, lgitime ou illgitime - autant de causes qui influencent leurs dsirs concernant la conduite d'autrui ou toute autre question. Partout o existe une classe dominante, la moralit du pays mane dans une large mesure des intrts et du sentiment de supriorit de cette classe. Spartiates et Ilotes, planteurs et esclaves, princes et sujets, nobles et roturiers, hommes et femmes : la morale est d'abord issue des intrts et des sentiments de classe. Et les sentiments ainsi engendrs agissent leur tour sur les conceptions morales de la classe dominante dans les relations entre ses membres. En revanche, lorsqu'une classe autrefois dominante perd son influence, ou lorsque cette position dominante devient impopulaire, la morale qui prvaut porte frquemment l'empreinte d'une vive aversion de toute supriorite. L'autre grand principe, impos par la loi ou l'opinion, qui dtermine les rgles de conduite en matire d'intolrance et de tolrance est la servilit de l'humanit envers les prfrences et aversions supposes de ses matres temporels, c'est--dire de ses dieux. Ouoique essentiellement goste, cette servilit n'est pas de l'hypocrisie; elle provoque d'authentiques sentiments de rpulsion, et c'est elle qui pousse les hommes brler les magiciens et les hrtiques. Au nombre des influences les plus viles, les intrts gnraux et vidents de la socit ont naturellement eu une part - une large part - dans l'orientation des conceptions morales : moins guides, cependant, par la justification de ces intrts que par la consquence des sympathies et des antipathies qui en rsultaient. Ce furent ces sympathies et antipathies, qui pourtant n'avaient que peu ou rien voir avec les intrts de la socit, qui contriburent fortement l'tablissement des diffrentes morales. Ce furent donc les prfrences et les aversions de la socit - ou celles de sa classe la plus puissante - qui, grce la sanction de la loi et de l'opinion, dterminrent dans la pratique les rgles observer par tous. Et en gnral, les avant-gardes intellectuelles ne remirent pas en question cet tat de choses, mme s'il leur arrivait parfois de faire office d'opposition pour certains points de dtail. Elles s'employrent rflchir sur la nature des aversions et des prfrences de la socit, sans se demander s'il tait bon que les individus les considrassent comme des lois. Elles prfrrent s'efforcer de modifier les conceptions sur ces points de dtails auxquels elles s'opposaient plutt que de faire cause commune pour la dfense de la libert avec l'ensemble des opposants. Seule la question religieuse connut une plus grande envergure en devenant l'objet d'un dbat entretenu avec cohrence par l'ensemble de la socit, exception faite de quelques individus dissmins. C'est un dbat instructif maints gards, d'autant plus qu'il constitue un exemple des plus frappants de la faillibilit de ce qu'on appelle le sens moral - car l'odium theologicum est, pour le bigot sincre, le fondement le moins quivoque de sa conception morale. Pourtant ceux qui, les pre-
John Stuart Mill (1859), De la libert
10
miers, secourent le joug de ce qui se prtendait glise universelle taient en gnral aussi peu disposs que cette dernire autoriser la libert de culte. Mais lorsque la fivre de la lutte fut retombe, sans donner victoire complte aucun parti, et que chaque glise ou chaque secte dut se borner rester en possession du terrain qu'elle occupait dj, les minorits, constatant qu'elles n'avaient aucune chance de devenir la majorit, se virent contraintes de prier ceux qu'elles ne pouvaient convertir de leur accorder la permission de diffrer. C'est donc presque exclusivement sur ce terrain-l que les droits de l'individu contre la socit ont t tablis sur de larges principes, et que la prtention de la socit exercer son autorit sur les dissidents fut ouvertement conteste. Les grands crivains, auxquels le monde doit ce qu'il possde de libert religieuse, ont dfini la libert de conscience comme un droit inalinable; il tait inconcevable pour eux qu'un tre humain et rendre compte aux autres de sa croyance religieuse. Cependant l'intolrance est si naturelle l'espce humaine pour tout ce qui lui tient rellement cur, que la libert religieuse n'a t mise en application presque nulle part - except l o l'indiffrence religieuse, qui n'aime gure voir sa paix trouble par des querelles thologiques, venait peser dans la balance. Dans l'esprit de la plupart des croyants - et cela mme dans les pays les plus tolrants - la tolrance est un devoir qui n'est admis qu'avec des rserves tacites. L'un souffrira le dsaccord en matire de gouvernement ecclsiastique, mais non de dogme; l'autre tolrera tout le monde, hormis les papistes et les unitariens ; un autre encore, tous ceux qui croient en la religion rvle ; et une minorit poussera la charit un peu plus loin, mais jamais au point de revenir sur la croyance en un dieu unique et en une vie future. Partout o le sentiment de la majorit est encore authentique et intense, on s'aperoit que ses prtentions se faire obir n'ont gure diminu. Si, en Angleterre tant donn les circonstances particulires de notre histoire politique - le joug de l'opinion demeure pesant, celui de la loi est plus lger que dans la plupart des pays, d'Europe; on est trs jaloux de prserver la vie prive face l'interfrence directe du pouvoir lgislatif ou excutif, et cela non pas tant par souci de l'indpendance de l'individu que par habitude : l'habitude toujours persistante de considrer le gouvernement comme un intrt oppos celui du public. La majorit n'a pas encore compris que le pouvoir du gouvernement est son propre pouvoir, ni que les opinions du gouvernement sont les siennes propres : lorsqu'elle y parviendra, la libert individuelle sera probablement expose l'invasion du gouvernement, autant qu'elle l'est dj celle de l'opinion publique. Mais pour l'instant, il existe une somme considrable de sentiments prts se soulever contre toute tentative de la loi pour contrler les individus dans des domaines qui jusque-l n'taient pas de son ressort, mais cela sans gure s'interroger sur ce qui fait partie ou non de la sphre lgitime du contrle officiel. Si bien que ces sentiments, hautement salutaires en soi, sont peut-tre tout aussi souvent appliqus tort qu' raison. De fait, il n'existe aucun principe reconnu qui dtermine dans la pratique les cas o l'intervention de l'tat est justifie ou non. On en dcide selon ses prfrences personnelles. Certains - partout o ils voient du bien faire ou un mal rparer - voudraient inciter le gouvernement entreprendre cette tche, tandis que d'autres prfrent subir toute espce de prjudices sociaux plutt que de risquer d'largir les attributions du gouvernement dans le domaine des intrts humains. Ds que surgit un problme particulier, les hommes se rangent d'un
John Stuart Mill (1859), De la libert
11
ct ou de l'autre suivant l'orientation gnrale de leurs sentiments, suivant le degr d'intrt qu'ils accordent la chose en question qu'on propose d'ajouter la comptence du gouvernement, ou encore suivant leur certitude que le gouvernement agit toujours, ou jamais, comme ils le souhaitent. Mais c'est trs rarement une opinion mrement rflchie sur la nature des attributions du gouvernement qui les pousse agir. Le rsultat de cette absence de rgle ou de principe, me semble-t-il, est qu'aujourd'hui un parti a aussi souvent tort que l'autre ; l'intervention du gouvernement est aussi souvent invoque tort que condamne tort. L'objet de cet essai est de poser un principe trs simple, fond rgler absolument les rapports de la socit et de l'individu dans tout ce qui est contrainte ou contrle, que les moyens utiliss soient la force physique par le biais de sanctions pnales ou la contrainte morale exerce par l'opinion publique. Ce principe veut que les hommes ne soient autoriss, individuellement ou collectivement, entraver la libert d'action de quiconque que pour assurer leur propre protection. La seule raison lgitime que puisse avoir une communaut pour user de la force contre un de ses membres est de l'empcher de nuire aux autres. Contraindre quiconque pour son propre bien, physique ou moral, ne constitue pas une justification suffisante. Un homme ne peut pas tre lgitimement contraint d'agir ou de s'abstenir sous prtexte que ce serait meilleur pour lui, que cela le rendrait plus heureux ou que, dans l'opinion des autres, agir ainsi serait sage ou mme juste. Ce sont certes de bonnes raisons pour lui faire des remontrances, le raisonner, le persuader ou le supplier, mais non pour le contraindre ou lui causer du tort s'il agit autrement. La contrainte ne se justifie que lorsque la conduite dont on dsire dtourner cet homme risque de nuire quelqu'un d'autre. Le seul aspect de la conduite d'un individu qui soit du ressort de la socit est celui qui concerne les autres. Mais pour ce qui ne concerne que lui, son indpendance est, de droit, absolue. Sur lui-mme, sur son corps et son esprit, l'individu est souverain. Il n'est peut-tre gure ncessaire de prciser que cette doctrine n'entend s'appliquer qu'aux tres humains dans la maturit de leurs facults. Nous ne parlerons pas ici des enfants, ni des adolescents des deux sexes en dessous de l'ge de la majorit fix par la loi. Ceux qui sont encore dpendants des soins d'autrui doivent tre protgs contre leurs propres actions aussi bien que contre les risques extrieurs. C'est pour cette mme raison que nous laisserons de ct ces ges arrirs de la socit o l'espce elle-mme pouvait sembler dans son enfance. Les toutes premires difficults qui se dressent sur le chemin du progrs spontan sont si considrables, qu'on a rarement le choix des moyens pour les surmonter; aussi un souverain progressiste peut-il se permettre d'utiliser n'importe quel expdient pour atteindre un but, autrement inaccessible. Le despotisme est un mode de gouvernement lgitime quand on a affaire des barbares, pourvu que le but vise leur avancement et que les moyens se justifient par la ralisation effective de ce but. La libert, comme principe, ne peut s'appliquer un tat de chose antrieur l'poque o l'humanit devient capable de s'amliorer par la libre discussion entre individus gaux. Avant ce stade, il n'existe pour les hommes que l'obissance aveugle un Akbar ou un Charlemagne, s'ils ont la bonne fortune d'en trouver un. Mais ds que l'humanit devient capable de
John Stuart Mill (1859), De la libert
12
se guider sur la voie du progrs grce la conviction ou la persuasion (c'est depuis longtemps le cas des nations qui nous intressent ici), la contrainte - exerce directement ou en rpression par le biais de sanctions pnales - ne peut plus tre admise comme un moyen de guider les hommes vers leur propre bien : elle se justifie uniquement ds lors qu'il s'agit de la scurit des autres. Il convient de remarquer que je renonce tout avantage que je pourrais tirer au cours de mon argumentation de l'ide d'un droit abstrait, indpendant de l'utilit. Je considre l'utilit comme le critre absolu dans toutes les questions thiques ; mais ici l'utilit doit tre prise dans son sens le plus large : se fonder sur les intrts permanents de l'homme en tant qu'tre susceptible de progrs. Je soutiens que ces intrts autorisent la sujtion de la spontanit individuelle un contrle extrieur uniquement pour les actions de chacun qui touchent l'intrt d'autrui. Si un homme commet un acte nuisible pour les autres, c'est l la raison premire de le punir, soit par la loi, soit par la rprobation gnrale, dans les cas o des sanctions pnales s'avreraient risques. Il existe galement bon nombre d'actes positifs pour le bien des autres qu'un homme peut tre lgitimement contraint d'accomplir - comme de tmoigner devant un tribunal, de participer pleinement la dfense commune ou toute oeuvre collective ncessaire aux intrts de la socit dont il reoit protection, et enfin d'accomplir des actes de bienfaisance individuelle (sauver la vie de son semblable ou s'interposer pour protger les faibles des mauvais traitements par exemple). Un homme peut en effet tre rendu responsable devant la socit s'il a manqu d'accomplir de tels actes lorsque tel tait son devoir. Une personne peut nuire aux autres non seulement par ses actions, mais aussi par son inaction, et dans les deux cas, elle est responsable envers eux du dommage caus. Il est vrai que dans le second cas, la contrainte doit tre exerce avec beaucoup plus de prudence que dans le premier. Rendre quelqu'un responsable du mal qu'il fait aux autres, c'est la rgle; le rendre responsable de n'avoir pas empch un mal, c'est, comparativement, l'exception. Cependant, nombreux sont les cas suffisamment clairs et graves qui justifient cette exception. En tout ce qui concerne ses relations avec autrui, l'individu est de jure responsable envers ceux dont les intrts sont engags, et si ncessaire, envers la socit en tant que leur protectrice. Il y a souvent de bonnes raisons pour ne pas lui infliger cette responsabilit, mais ces raisons restent dterminer selon les cas: soit qu'il s'agisse d'un cas o l'individu a des chances de mieux se comporter livr sa propre discrtion que contrl d'aucune faon par la socit, soit qu'une tentative de contrle causerait davantage de mal que celui qu'elle entend prvenir. Lorsque de telles raisons empchent de sanctionner la responsabilit, la conscience de l'agent lui-mme devrait prendre la place du juge absent afin de protger les intrts d'autrui qui ne jouissent d'aucune protection extrieure ; l'agent en question devrait se juger d'autant plus svrement que le cas ne le soumet pas au jugement de ses semblables. Mais il y a une sphre d'action dans laquelle la socit, en tant que distincte de l'individu, n'a tout au plus qu'un intrt indirect, savoir cette partie de la conduite d'une personne qui n'affecte qu'elle-mme ou qui, si elle en affecte d'autres, c'est alors qu'ils y ont consenti et particip librement, volontairement et en toute connaissance
John Stuart Mill (1859), De la libert
13
de cause. Quand je dis elle-mme , j'entends ce qui la touche directement et prioritairement ; car tout ce qui affecte une personne peut en affecter d'autres par son intermdiaire ; et l'objection qui se fonde sur cette ventualit fera l'objet de nos rflexions ultrieures. Voil donc la rgion propre de la libert humaine. Elle comprend d'abord le domaine intime de la conscience qui ncessit la libert de conscience au sens le plus large : libert de penser et de sentir, libert absolue d'opinions et de sentiments sur tous les sujets, pratiques ou spculatifs, scientifiques, moraux ou thologiques. La libert d'exprimer et de publier des opinions peut sembler soumise un principe diffrent, puisqu'elle appartient cette partie de conduite de l'individu qui concerne autrui ; mais comme elle est presque aussi importante que la libert de penser elle-mme, et qu'elle repose dans une large mesure sur les mmes raisons, ces deux liberts sont pratiquement indissociables, C'est par ailleurs un principe qui requiert la libert des gots et des occupations, la libert de tracer le plan de notre vie suivant notre caractre, d'agir notre guise et risquer toutes les consquences qui en rsulteront, et cela sans en tre empch par nos semblables tant que nous ne leur nuisons pas, mme s'ils trouvaient notre conduite insense, perverse ou mauvaise. En dernier lieu, c'est de cette libert propre chaque individu que rsulte, dans les mmes limites, la libert d'association entre individus : la libert de s'unir dans n'importe quel but, condition qu'il soit inoffensif pour autrui, que les associs soient majeurs et qu'il n'y ait eu dans leur enrlement ni contrainte ni tromperie. Une socit quelle que soit la forme de son gouvernement n'est pas libre, moins de respecter globalement ces liberts ; et aucune n'est compltement libre si elles n'y sont pas absolues et sans rserves. La seule libert digne de ce nom est de travailler notre propre avancement notre gr, aussi longtemps que nous ne cherchons pas priver les autres du leur ou entraver leurs efforts pour l'obtenir. Chacun est le gardien naturel de sa propre sant aussi bien physique que mentale et spirituelle. L'humanit gagnera davantage laisser chaque homme vivre comme bon lui semble qu' le contraindre vivre comme bon semble aux autres. Quoique cette doctrine soit loin d'tre neuve et que pour certains elle puisse avoir l'air d'un truisme, il n'y en a pas de plus directement oppose l'opinion et la pratique existantes. La socit s'est tout autant applique (selon ses lumires) forcer ses membres se conformer ses notions de perfection personnelle qu' ses notions de perfection sociale. Les anciennes rpubliques s'arrogeaient le droit - et les philosophes de l'Antiquit les y encourageaient - de soumettre tous les aspects de la vie prive aux rgles de l'autorit publique, sous prtexte que l'tat prenait grand intrt la discipline physique et morale de ses citoyens. Cette manire de penser pouvait tre envisage dans de petites rpubliques entoures d'ennemis puissants et constamment la merci d'une attaque extrieure ou de troubles intrieurs ; le moindre relchement de leur vigilance et de leur matrise de soi leur et t facilement fatal, de sorte qu'elles ne pouvaient se permettre d'attendre les effets salutaires et permanents de la libert. Dans le monde moderne, la dimension des communauts politiques, et surtout la sparation des autorits spirituelle et temporelle (qui a plac la direction des consciences dans d'autres mains que celles qui contrlaient ses affaires temporelles)
John Stuart Mill (1859), De la libert
14
empcha une telle interfrence de la loi dans les dtails de la vie prive. Du mme coup, c'est avec davantage de rigueur qu'on a utilis les armes de la rpression contre toute divergence par rapport la morale rgnante dans la vie prive ; car la religion le constituant le plus puissant du sentiment moral - a presque de tous temps t gouverne, soit par l'ambition d'une hirarchie aspirant contrler tous les aspects de la conduite humaine, soit par l'esprit du puritanisme. Et certains de ces rformateurs modernes qui se sont le plus violemment opposs aux religions du pass n'ont en aucune faon contest aux glises et aux sectes le droit de domination spirituelle qu'elles affirmaient : M. Comte, en particulier, dont le systme social, tel qu'il l'expose dans son Systme de politique positive, vise tablir (plutt, il est vrai, par des moyens moraux que lgaux) un despotisme de la socit sur l'individu qui dpasse tout ce qu'ont pu imaginer les plus rigides partisans de la discipline parmi les philosophes de l'Antiquit. Hormis ce type de doctrines propres un penseur particulier, il y a aussi dans le monde une forte et croissante tendance tendre indment le pouvoir de la socit sur l'individu, et cela autant par la force de l'opinion que par celle de la lgislation. Or, comme tous les changements qui surviennent dans le monde ont gnralement pour effet de renforcer la socit au dtriment de l'individu, cet empitement n'est pas de ces maux qui tendent disparatre, mais de ceux qui au contraire vont en s'amplifiant. La disposition des hommes, tant dirigeants que concitoyens, imposer aux autres leurs propres opinions et prfrences comme rgles de conduite est fortement soutenue par des sentiments - les meilleurs comme les pires -,inhrents la nature humaine; au point que seul un affaiblissement de son pouvoir pourrait la contenir. Mais puisque ce pouvoir ne va pas dclinant mais croissant, il faut donc, dans la situation actuelle du monde - moins qu'un mur de convictions morales ne vienne se dresser contre le mal - se rsigner le voir augmenter, Pour les besoins de l'argument, au lieu d'aborder sur-le-champ la thse gnrale, nous nous limiterons en premier lieu une seule de ses branches, sur laquelle les opinions courantes s'accordent reconnatre - sinon entirement, du moins jusqu' un certain point - le principe expos ici. Cette branche a trait la libert de pense, laquelle est indissociablement lie la libert de parler et d'crire. Bien que ces liberts constituent dans une large mesure la morale politique de tous les pays qui professent la tolrance religieuse et les libres institutions, leurs fondements tant philosophiques que pratiques ne sont peut-tre pas - contrairement ce qu'on pourrait croire - aussi familiers au publie, voire parfaitement valus par les chefs de file de l'opinion. Compris dans leur ensemble, ces fondements deviennent plus largement applicables que lorsqu'ils sont morcels, et un examen approfondi de cet aspect du problme sera la meilleure introduction au reste. C'est pourquoi ceux qui ne trouveront rien de nouveau dans ce que je vais dire voudront bien, je l'espre, m'excuser si je m'aventure discuter une fois de plus un sujet si souvent dbattu depuis maintenant trois sicles.
John Stuart Mill (1859), De la libert
15
Chapitre II
De la libert de pense et de discussion
Retour la table des matires
Il est esprer que le temps o il aurait fallu dfendre la libert de presse , comme l'une des scurits contre un gouvernement corrompu ou tyrannique est rvolu. On peut supposer qu'il est aujourd'hui inutile de dfendre l'ide selon laquelle un lgislatif ou un excutif dont les intrts ne seraient pas identifis ceux du peuple n'est pas autoris lui prescrire des opinions ni dterminer pour lui les doctrines et les arguments entendre. D'ailleurs, les philosophes qui m'ont prcd ont dj si souvent et triomphalement mis en vidence cet aspect du problme que point n'est besoin d'y insister ici. Quoique la loi anglaise sur la presse soit aussi servile de nos jours qu'au temps des Tudor, il n'y a gure de risque qu'elle fasse office d'outil de rpression contre la discussion politique, sinon dans un moment de panique passagre
John Stuart Mill (1859), De la libert
16
o la crainte fait perdre la tte aux ministres et aux juges 1 . Et gnralement, il n'est pas craindre dans un pays constitutionnel que le gouvernement, qu'il soit ou non entirement responsable envers le peuple, cherche souvent contrler l'expression de l'opinion, except lorsque, en agissant ainsi, il se fait l'organe de l'intolrance gnrale du public. Supposons donc que le gouvernement ne fasse qu'un avec le peuple et ne songe jamais exercer aucun pouvoir de coercition, moins d'tre en accord avec ce qu'il estime tre la voix du peuple. Mais je refuse au peuple le droit d'exercer une telle coercition, que ce soit de lui-mme ou par l'intermdiaire de son gouvernement, car ce pouvoir est illgitime. Le meilleur gouvernement n'y a pas davantage de droit que le pire : un tel pouvoir est aussi nuisible, si ce n'est plus, lorsqu'il s'exerce en accord avec l'opinion publique qu'en opposition avec elle. Si tous les hommes moins un partageaient la mme opinion, ils n'en auraient pas pour autant le droit d'imposer silence cette personne, pas plus que celle-ci, d'imposer silence aux hommes si elle en avait le pouvoir. Si une opinion n'tait qu'une possession personnelle, sans valeur pour d'autres que son possesseur; si d'tre gn dans la jouissance de cette possession n'tait qu'un dommage priv, il y aurait une diffrence ce que ce dommage ft inflig peu ou beaucoup de personnes. Mais ce qu'il y a de particulirement nfaste imposer silence l'expression d'une opinion, c'est que cela revient voler l'humanit : tant la postrit que la gnration prsente, les dtracteurs de cette opinion davantage encore que ses dtenteurs. Si l'opinion est juste, on les prive de l'occasion d'changer l'erreur pour la vrit ; si elle est fausse, ils perdent un bnfice presque aussi considrable: une perception plus claire et une impression plus vive de la vrit que produit sa confrontation avec l'erreur. Il est ncessaire de considrer sparment ces deux hypothses, chacune desquelles correspond une branche distincte de l'argument. On ne peut jamais tre sr
Ces mots taient peine crits lorsque, comme pour leur donner un dmenti solennel, survinrent en 1858 les poursuites du gouvernement contre la presse. Cette intervention malavise dans la discussion publique ne m'a pas entran changer un seul mot au texte; elle n'a pas davantage affaibli ma conviction que, les moments de panique excepts, l're des sanctions l'encontre de la discussion politique tait rvolue dans notre pays. Car d'abord on ne persista pas dans les poursuites et secondement, ce ne furent jamais proprement parler des poursuites politiques. L'offense reproche n'tait pas d'avoir critiqu les instructions, les actes ou les personnes des gouvernants, mais d'avoir propag une doctrine estime immorale : la lgitimit du tyrannicide. Si les arguments du prsent chapitre ont quelque validit, c'est qu'il devrait y avoir la pleine libert de professer et de discuter, en tant que conviction thique, n'importe quelle doctrine, aussi immorale puisse-t-elle sembler. Il serait donc inappropri et dplac d'examiner ici si la doctrine du tyrannicide mrite bien ce qualificatif. Je me contenterai de dire que cette question fait depuis toujours partie des dbats moraux et qu'un citoyen qui abat un criminel s'lve ce faisant au-dessus de la loi et se place hors de porte des chtiments et des contrles lgaux. Cette action est reconnue par des nations entires et par certains hommes, les meilleurs et les plus sages, non comme un crime, mais comme un acte d'extrme vertu. En tout cas, bon ou mauvais, le tyrannicide n'est pas de l'ordre de l'assassinat, mais de la guerre civile. En tant que tel, je considre que l'instigation au tyrannicide, dans un cas prcis, peut donner lieu un chtiment appropri, mais cela seulement s'il est suivi de l'acte proprement dit ou si un lien vraisemblable entre l'acte et l'instigation peut tre tabli. Mais dans ce cas, seul le gouvernement attaqu lui-mme - et non un gouvernement tranger - peut lgitimement, pour se dfendre, punir les attaques contre sa propre existence.
John Stuart Mill (1859), De la libert
17
que l'opinion qu'on s'efforce d'touffer est fausse ; et si nous l'tions, ce serait encore un mal. Premirement, il se peut que l'opinion qu'on cherche supprimer soit vraie: ceux qui dsirent la supprimer en contestent naturellement la vrit, mais ils ne sont pas infaillibles. Il n'est pas en leur pouvoir de trancher la question pour l'humanit entire, ni de retirer d'autres qu'eux les moyens de juger. Refuser d'entendre une opinion sous prtexte qu'ils sont srs de sa fausset, c'est prsumer que leur certitude est la certitude absolue. touffer une discussion, c'est s'arroger l'infaillibilit. Cet argument commun suffira la condamnation de ce procd, car tout commun qu'il soit, il n'en est pas plus mauvais. Malheureusement pour le bon sens des hommes, le fait de leur faillibilit est loin de garder dans leur jugement pratique le poids qu'ils lui accordent en thorie. En effet, bien que chacun se sache faillible, peu sont ceux qui jugent ncessaire de se prmunir contre cette faillibilit, ou d'admettre qu'une opinion dont ils se sentent trs srs puisse tre un exemple de cette erreur. Les princes absolus, ou quiconque accoutum une dfrence illimite, prouvent ordinairement cette entire confiance en leurs propres opinions sur presque tous les sujets. Les hommes les plus heureusement placs qui voient parfois leurs opinions disputes, et qui ne sont pas compltement inaccoutums tre corrigs lorsquils ont tort, n'accordent cette mme confiance illimite qu'aux opinions qu'ils partagent avec leur entourage, ou avec ceux envers qui ils dfrent habituellement ; car moins un homme fait confiance son jugement solitaire, plus il s'en remet implicitement l'infaillibilit du monde en gnral. Et le monde, pour chaque individu, signifie la partie du monde avec laquelle il est en contact : son parti, sa secte, son glise, sa classe sociale. En comparaison, on trouvera un homme l'esprit large et libral s'il tend le terme de monde son pays ou son poque. Et sa foi dans cette autorit collective ne sera nullement branle quoiqu'il sache que d'autres sicles, d'autres pays, d'autres sectes, d'autres glises, d'autres partis ont pens et pensent encore exactement le contraire. il dlgue a son propre monde la responsabilit d'avoir raison face aux mondes dissidents des autres hommes, et jamais il ne s'inquite de ce que c'est un pur hasard qui a dcid lequel de ces nombreux mondes serait l'objet de sa confiance, et de ce que les causes qui font de lui un anglican Londres sont les mmes qui en auraient fait un bouddhiste ou confucianiste Pkin. Cependant il est vident, comme pourraient le prouver une infinit d'exemples, que les poques ne sont pas plus infaillibles que les individus, chaque poque ayant profess nombre d'opinions que les poques suivantes ont estimes non seulement fausses, mais absurdes. De mme il est certain que nombre d'opinions aujourd'hui rpandues seront rejetes par les poques futures, comme l'poque actuelle rejette nombre d'opinions autrefois rpandues. Cet argument suscitera probablement une objection de la forme suivante: interdire la propagation de l'erreur n'est effectivement pas davantage une garantie d'infaillibilit que n'importe quel acte accompli par l'autorit publique selon son propre jugement et sous sa propre responsabilit, mais le jugement est donn aux hommes pour
John Stuart Mill (1859), De la libert
18
qu'ils s'en servent. Pour autant faut-il dfendre purement et simplement aux hommes de s'en servir sous prtexte qu'ils risquent d'en faire mauvais usage ? En interdisant ce qu'ils estiment pernicieux, ils ne prtendent pas tre exempts d'erreurs : ils ne font que remplir leur devoir d'agir selon leur conscience et leur conviction, malgr leur faillibilit. Si nous ne devions jamais agir selon nos opinions de peur qu'elles ne soient fausses, ce serait ngliger la fois tous nos intrts et nos devoirs. Une opinion qui s'applique toute conduite en gnral ne saurait tre une objection valable aucune conduite en particulier. C'est le devoir du gouvernement, et des individus, de se former les opinions les plus justes qu'ils peuvent, de se les former avec soin, sans jamais les imposer aux autres moins d'tre tout fait srs d'avoir raison. Mais quand ils en sont srs (diront les raisonneurs), ce n'est point la conscience, mais la couardise qui les retient de laisser se diffuser certaines doctrines qu'honntement ils estiment dangereuses pour le bien-tre de l'humanit, soit dans cette vie, soit dans l'autre ; et cela, parce que d'autres peuples en des temps moins clairs ont rprim des opinions qu'on croit justes aujourd'hui. Gardons-nous, dira-t-on, de refaire la mme erreur. Mais gouvernements et nations ont commis des erreurs dans d'autres domaines dont on ne nie pas qu'ils soient du ressort de l'autorit publique: ils ont lev de mauvais impts, men des guerres injustes. Est-ce une raison pour ne plus lever d'impts ou pour ne plus faire de guerres, en dpit des provocations ? Les hommes et les gouvernements doivent agir du mieux qu'ils peuvent. Il n'existe pas de certitude absolue, mais il y en a assez pour les besoins de la vie. Nous pouvons et devons prsumer juste notre opinion, suffisamment pour diriger notre conduite ; et ce n'est prsumer rien de plus que d'empcher les mauvaises gens de pervertir la socit en propageant des opinions que nous jugeons fausses et pernicieuses. Je rponds que c'est prsumer bien davantage. Il existe une diffrence extrme entre prsumer vraie une opinion qui a survcu toutes les rfutations et prsumer sa vrit afin de ne pas en permettre la rfutation. La libert complte de contredire et de rfuter notre opinion est la condition mme qui nous permet de prsumer sa vrit en vue d'agir: c'est l la seule faon rationnelle donne un tre dou de facults humaines de s'assurer qu'il est dans le vrai. Quand nous considrons soit l'histoire de l'opinion, soit le cours ordinaire de la vie humaine, quoi attribuer que l'une et l'autre ne soient pas pires ? Certes pas la force propre de l'intelligence humaine; car, pour toute question dlicate, une personne sur cent sera capable de trancher ; et encore, la capacit de cette unique personne n'est que relative. Car la majorit des grands hommes des gnrations passes a soutenu maintes opinions aujourd'hui tenues pour errones et fait et approuv nombre de choses que nul ne justifie plus aujourd'hui. Comment se fait-il alors qu'il y ait globalement prpondrance d'opinions et de conduites rationnelles dans l'humanit ? Si prpondrance il y a - et sans elle, les affaires humaines seraient et eussent toujours t dans un tat presque dsespr - elle le doit une qualit de l'esprit humain, la source de tout ce qu'il y a de respectable en l'homme en tant qu'tre intellectuel et moral, savoir que se erreurs. Par la discussion et l'exprience - mais non par la seule exprience - il est capable de corriger ses erreurs : la discussion est ncessaire pour
John Stuart Mill (1859), De la libert
19
montrer comment interprter l'exprience. Fausses opinions et fausses pratiques cdent graduellement devant le fait et l'argument, mais pour produire quelque effet sur l'esprit, ces faits et arguments doivent lui tre prsents. Rares sont les faits qui parlent d'eux-mmes, sans commentaire qui fasse ressortir leur signification. Il s'ensuit que toute la force et la valeur de l'esprit humain - puisqu'il dpend de cette facult d'tre rectifi quand il s'gare - n'est vraiment fiable que si tous les moyens pour le rectifier sont porte de main. Le jugement d'un homme s'avre-t-il digne de confiance, c'est qu'il a su demeurer ouvert aux critiques sur ses opinions et sa conduite; c'est qu'il a pris l'habitude d'couter tout ce qu'on disait contre lui, d'en profiter autant qu'il tait ncessaire et de s'exposer lui-mme - et parfois aux autres - la fausset de ce qui tait faux: c'est qu'il a senti que la seule faon pour un homme d'accder la connaissance exhaustive d'un sujet est d'couter ce qu'en disent des personnes d'opinions varies et comment l'envisagent diffrentes formes d'esprit, Jamais homme sage n'acquit sa sagesse autrement; et la nature de l'intelligence humaine est telle qu'elle ne peut l'acqurir autrement. Loin de susciter doute et hsitation lors de la mise en pratique, s'habituer corriger et complter systmatiquement son opinion en la comparant celle des autres est la seule garantie qui la rende digne de confiance. En effet l'homme sage - pour connatre manifestement tout ce qui se peut dire contre lui, pour dfendre sa position contre tous les contradicteurs, pour savoir que loin d'viter les objections et les difficults, il les a recherches et n'a nglig aucune lumire susceptible d'clairer tous les aspects du sujet - l'homme sage a le droit de penser que son jugement vaut mieux que celui d'un autre ou d'une multitude qui n'ont pas suivi le mme processus. Ce n'est pas trop exiger que d'imposer ce qu'on appelle le public - ce mlange htroclite d'une minorit de sages et d'une majorit de sots - de se soumettre ce que les hommes les plus sages - ceux qui peuvent le plus prtendre la fiabilit de leur jugement - estiment ncessaire pour garantir leur jugement. La plus intolrante des glises, l'glise catholique romaine, admet et coute patiemment, mme lors de la canonisation d'un saint, un avocat du diable . Les plus saints des hommes ne sauraient tre admis aux honneurs posthumes avant que tout ce que le diable peut dire contre eux ne soit connu et pes. S'il tait interdit de remettre en question la philosophie newtonienne, l'humanit ne pourrait aujourd'hui la tenir pour vraie en toute certitude. Les croyances pour lesquelles nous avons le plus de garantie n'ont pas d'autre sauvegarde qu'une invitation constante au monde entier de les prouver non fondes. Si le dfi n'est pas relev - ou s'il est relev et que la tentative choue - nous demeurerons assez loigns de la certitude, mais nous aurons fait de notre mieux dans l'tat actuel de la raison humaine : nous n'aurons rien nglig pour donner la vrit une chance de nous atteindre. Les lices restant ouvertes, nous pouvons esprer que s'il existe une meilleure vrit, elle sera dcouverte lorsque l'esprit humain sera capable de la recevoir. Entre-temps, nous pouvons tre srs que notre poque a approch la vrit d'aussi prs que possible. Voil toute la certitude laquelle peut prtendre un tre faillible, et la seule manire d'y parvenir.
John Stuart Mill (1859), De la libert
20
Il est tonnant que les hommes admettent la validit des arguments en faveur de la libre discussion, mais qu'ils objectent ds qu'il s'agit de les pousser jusqu'au bout , et cela sans voir que si ces raisons ne sont pas bonnes pour un cas extrme, c'est qu'elles ne valent rien. Il est tonnant qu'ils s'imaginent s'attribuer l'infaillibilit en reconnaissant la ncessit de la libre discussion sur tous les sujets ouverts au doute, mais pensent galement que certaines doctrines ou principes particuliers devraient chapper la remise en question sous prtexte que leur certitude est prouve, ou plutt qu'ils sont certains, eux, de leur certitude. Qualifier une proposition de certaine tant qu'il existe un tre qui nierait cette certitude s'il en avait la permission alors qu'il est prive de celle-ci, c'est nous prsumer - nous et ceux qui sont d'accord avec nous les garants de la certitude, garants qui de surcrot pourraient se dispenser d'entendre la partie adverse. Dans notre poque - qu'on a dcrite comme prive de foi, mais terrifie devant le scepticisme - o les gens se sentent srs non pas tant de la vrit de leurs opinions que de leur ncessit, les droits d'une opinion demeurer protge contre l'attaque publique se fondent moins sur sa vrit que sur son importance pour la socit. Il y a, dit-on, certaines croyances si utiles, voire si indispensables au bien-tre qu'il est du devoir des gouvernements de les dfendre, au mme titre que d'autres intrts de la socit. Devant une telle situation de ncessit, devant un cas s'inscrivant aussi videmment dans leur devoir, assure-t-on, un peu moins d'infaillibilit suffirait pour justifier, voire obliger, les gouvernements agir selon leur propre opinion, confirme par l'opinion gnrale de l'humanit. On avance aussi souvent - et on le pense plus souvent encore -que seuls les mchants dsireraient affaiblir ces croyances salutaires ; aussi n'y a-t-il rien de mal interdire ce qu'eux seuls voudraient faire. Cette manire de penser, en justifiant les restrictions sur la discussion, fait de ce problme non plus une question de vrit, mais d'utilit des doctrines ; et on se flatte ce faisant d'chapper l'accusation de garant infaillible des opinions. Mais ceux qui se satisfont si bon compte ne s'aperoivent pas que la prtention l'infaillibilit est simplement dplace. L'utilit mme d'une opinion est affaire d'opinion : elle est un objet de dispute ouvert la discussion, et qui l'exige autant que l'opinion elle-mme. Il faudra un garant infaillible des opinions tant pour dcider qu'une opinion est nuisible que pour dcider qu'elle est fausse, moins que l'opinion ainsi condamne n'ait toute latitude pour se dfendre. Il ne convient donc pas de dire qu'on permet un hrtique de soutenir l'utilit ou le caractre inoffensif de son opinion si on lui dfend d'en soutenir la vrit. La vrit d'une opinion fait partie de son utilit. Lorsque nous voulons savoir s'il est souhaitable qu'une proposition soit partage, est-il possible d'exclure la question de savoir si oui ou non elle est vraie ? Dans l'opinion, non des mchants mais des meilleurs des hommes, nulle croyance contraire la vrit ne peut tre rellement utile: pouvez-vous empcher de tels hommes d'avancer cet argument quand on les accuse de s'opposer l'utilit prtendue d'une doctrine qu'ils estiment fausse par ailleurs ? Ceux qui dfendent les opinions reues ne manquent jamais de tirer tous les avantages possibles de cette excuse : jamais on ne les voit, eux, traiter de la question de l'utilit comme si on pouvait l'abstraire compltement de celle de la vrit. Au contraire, c'est avant tout parce que leur doctrine est la vrit qu'ils
John Stuart Mill (1859), De la libert
21
estiment si indispensable de la connatre ou d'y croire. Il ne peut y avoir de discussion loyale sur la question de l'utilit quand un seul des deux partis peut se permettre d'avancer un argument aussi vital. Et en fait, lorsque la loi ou le sentiment public ne permettent pas de remettre en question la vrit d'une opinion, ils tolrent tout aussi peu un dni de son utilit. Ce qu'ils permettent, tout au plus, c'est une attnuation de sa ncessit absolue ou de la faute indniable qu'il y aurait la rejeter. Afin de mieux illustrer tout le mal qu'il y a refuser d'couter des opinions parce que nous les avons condamnes d'avance dans notre propre jugement, il convient d'ancrer la discussion sur un cas concret. Je choisirai de prfrence les cas qui me sont le moins favorables, ceux dans lesquels les arguments contre la libert d'opinion - tant du ct de la vrit que de l'utilit - sont estims les plus forts. Supposons que les opinions contestes soient la croyance en un Dieu et en une vie future, ou n'importe laquelle des doctrines morales communment reues. Livrer bataille sur un tel terrain, c'est donner grand avantage un adversaire de mauvaise foi, car il dira srement (et bien d'autres qui ne voudraient pas faire montre de mauvaise foi se le diront intrieurement avec lui): sont-ce l les doctrines que vous n'estimez pas suffisamment certaines pour tre protges par la loi ? La croyance en un Dieu estelle, selon vous, de ces opinions dont on ne peut se sentir sr sans prtendre l'infaillibilit ? Qu'on me permette de remarquer que le fait de se sentir sr d'une doctrine (quelle qu'elle soit) n'est pas ce que j'appelle prtendre l'infaillibilit. J'entends par l le fait de vouloir dcider cette question pour les autres sans leur permettre d'entendre ce qu'on peut dire de l'autre ct. Et je dnonce et ne rprouve pas moins cette prtention quand on l'avance en faveur de mes convictions les plus solennelles. Quelque persuad que soit un homme non seulement de la fausset, mais des consquences pernicieuses d'une opinion - non seulement de ses consquences pernicieuses, mais (pour employer des expressions que je condamne absolument) de son immoralit et de son impit - c'est prsumer de son infaillibilit, et cela en dpit du soutien que lui accorderait le jugement public de son pays ou de ses contemporains, que d'empcher cette opinion de plaider pour sa dfense. Et cette prsomption, loin d'tre moins dangereuse ou rprhensible, serait d'autant plus fatale que l'opinion en question serait appele immorale ou impie. Telles sont justement les occasions o les hommes commettent ces terribles erreurs qui inspirent la postrit stupeur et horreur. Nous en trouvons des exemples mmorables dans l'histoire lorsque nous voyons le bras de la justice utilis pour dcimer les meilleurs hommes et les meilleurs doctrines, et cela avec un succs dplorable quant aux hommes ; quant aux doctrines, certaines ont survcu pour tre (comme par drision) invoques en dfense d'une conduite semblable envers ceux-l mmes qui divergeaient de celles-ci ou de leur interprtation couramment admise. On ne saurait rappeler trop souvent l'humanit qu'il a exist autrefois un homme du nom de Socrate, et qu'il y eut, entre celui-ci et les autorits et l'opinion publique de son temps, un affrontement mmorable. N dans un sicle et dans un pays riche en grandeur individuelle, l'image qui nous a t transmise par ceux qui connaissaient le mieux la fois le personnage et son poque, est celle de l'homme le plus vertueux de
John Stuart Mill (1859), De la libert
22
son temps; mais nous le connaissons galement comme le chef et le modle de tous ces grands matres de vertu qui lui furent postrieurs, tout la fois la source et la noble inspiration de Platon et de l'utilitarisme judicieux d'Aristote, i mastri di color que sanno , eux-mmes l'origine de l'thique et de toute philosophie. Ce matre avou de tous les minents penseurs qui vcurent aprs lui - cet homme dont la gloire ne cesse de crotre depuis plus de deux mille ans et clipse celle de tous les autres noms qui illustrrent sa ville natale - fut mis mort par ses concitoyens aprs une condamnation juridique pour impit et immoralit. Impit, pour avoir ni les dieux reconnus par l'tat ; en effet, ses accusateurs affirmaient (voir l'Apologie) qu'il ne croyait en aucun dieu. Immoralit, pour avoir t par ses doctrines et son enseignement le corrupteur de la jeunesse . Il y a tout lieu de croire que le tribunal le trouva en conscience coupable de ces crimes; et il condamna mort comme un criminel l'homme probablement le plus digne de mrite de ses contemporains et de l'humanit. Passons prsent au seul autre exemple d'iniquit judiciaire dont la mention, aprs la condamnation de Socrate, ne nous fasse pas tomber dans la trivialit. L'vnement eut lieu sur le Calvaire il y a un peu plus de mille huit cents ans. L'homme qui laissa sur tous les tmoins de sa vie et de ses paroles une telle impression de grandeur morale que les dix-huit sicles suivants lui ont rendu hommage comme au Tout-Puissant en personne - cet homme fut ignominieusement mis mort. A quel titre ? Blasphmateur. Non seulement les hommes mconnurent leur bienfaiteur, mais ils le prirent pour exactement le contraire de ce qu'il tait et le traitrent comme un prodige d'impit, accusation aujourd'hui retourne contre eux pour le traitement qu'ils lui infligrent. Aujourd'hui, les sentiments qui animent les hommes en considrant ces vnements lamentables, spcialement le second, les rendent extrmement injustes dans leur jugement envers les malheureux acteurs de ces drames. Ceux-ci, selon toute esprance, n'taient point des mchants - ils n'taient pas pires que le commun des hommes -, mais au contraire des hommes qui possdaient au plus haut point les sentiments religieux, moraux et patriotiques de leur temps et de leur peuple : la sorte mme d'homme qui, toutes les poques y compris la ntre, ont toutes les chances de traverser la vie irrprochables et respects. Le grand prtre qui dchira ses vtements en entendant prononcer les paroles qui, selon toutes les conceptions de son pays, constituaient le plus noir des crimes, prouva sans doute une horreur sincre, la mesure des sentiments moraux et religieux professs par le commun des hommes pieux et respectables. Pourtant la plupart de ceux qui frmissent aujourd'hui devant sa conduite auraient agi exactement de mme s'ils avaient vcu cette poque et taient ns juifs. Les chrtiens orthodoxes qui sont tents de croire que ceux qui lapidrent les premiers martyrs furent plus mchants qu'eux mmes devraient se souvenir que saint Paul fut au nombre des perscuteurs. Ajoutons encore un exemple, le plus frappant de tous si tant est que le caractre impressionnant d'une erreur se mesure la sagesse et la vertu de celui qui la commet. Si jamais monarque eut sujet de se croire le meilleur et le plus clair de ses contemporains, ce fut l'empereur Marc Aurle. Matre absolu du monde civilis tout
John Stuart Mill (1859), De la libert
23
entier, il se conduisit toute sa vie avec la plus pure justice et conserva, en dpit de son ducation stocienne, le plus tendre des curs. Le peu de fautes qu'on lui attribue viennent toutes de son indulgence, tandis que ses crits, luvre thique la plus noble de l'Antiquit, ne diffre qu' peine, sinon pas du tout, des enseignements les plus caractristiques du Christ. Ce fut cet homme - meilleur chrtien dans tous les sens du terme (le dogmatique except) que la plupart des souverains officiellement chrtiens qui ont rgn depuis - ce fut cet homme qui perscuta le christianisme. A la pointe de tous les progrs antrieurs de l'humanit, dou d'une intelligence ouverte et libre et d'un caractre qui le portait incarner dans ses crits moraux l'idal chrtien, il ne sut pas voir - tout pntr qu'il tait de son devoir - que le christianisme tait un bien et non un mal pour le monde. Il savait que la socit de son temps tait dans un tat dplorable. Mais telle qu'elle tait, il vit ou s'imagina voir que ce qui l'empchait d'empirer tait la foi et la vnration qu'elle vouait aux anciennes divinits. En tant que souverain, il estima de son devoir de ne pas laisser la socit se dissoudre, et ne vit pas comment, si on tait les liens existants, on en pourrait reformer d'autres pour la ressouder. La nouvelle religion visait ouvertement dfaire ces liens ; et comme son devoir ne lui dictait pas d'adopter cette religion, c'est qu'il lui fallait la dtruire. C'est ainsi que le plus doux et le plus aimable des philosophes et des souverains parce qu'il ne pouvait ni croire que la thologie du christianisme ft vraie ou d'origine divine, ni accrditer cette trange histoire d'un dieu crucifi, ni prvoir qu'un systme cens reposer entirement sur de telles bases s'avrerait par la suite, en dpit des revers, l'agent du renouvellement - fut conduit par un sens profond du devoir autoriser la perscution du christianisme. mon sens, c'est l'un des vnements les plus tragiques de l'histoire. On n'imagine pas sans amertume combien le christianisme du monde aurait t diffrent si la foi chrtienne tait devenue la religion de l'empire sous les auspices de Marc Aurle et non ceux de Constantin. Mais ce serait tre la fois injuste envers Marc Aurle et infidle la vrit de nier que, s'il rprima comme il le fit la propagation du christianisme, il invoqua tous les arguments pour rprimer les enseignements antichrtiens. Tout chrtien croit fermement que l'athisme mne la dissolution de la socit: Marc Aurle le pensait tout aussi fermement du christianisme, lui qui, de tous ses contemporains, paraissait le plus capable d'en juger. A moins de rivaliser en sagesse et en bont avec Marc Aurle, moins d'tre plus profondment vers dans la sagesse de son temps, de se compter parmi les esprits suprieurs, de montrer plus de srieux dans la qute de la vrit et lui tre plus dvou aprs l'avoir trouve - mieux vaut donc que le partisan des sanctions l'encontre de ceux qui Propagent certaines opinions cesse d'affirmer sa propre infaillibilit et celle de la multitude, comme le fit le grand Antonin avec un si fcheux rsultat. Conscients de l'impossibilit de dfendre des sanctions l'encontre des opinions irrligieuses sans justifier Marc Aurle, les ennemis de la libert de culte acceptent parfois cette consquence, quand on les pousse dans leurs derniers retranchements; et ils disent, avec le Dr Johnson, que les perscuteurs du christianisme taient dans le vrai, que la perscution est une preuve que la vrit doit subir, et qu'elle subit toujours avec succs, puisque les sanctions - bien qu'efficaces contre les erreurs perni-
John Stuart Mill (1859), De la libert
24
cieuses - s'avrent toujours impuissantes contre la vrit. Voil une forme remarquable de l'argument en faveur de l'intolrance religieuse qui mrite qu'on s'y arrte. Une thorie qui soutient qu'il est lgitime de perscuter la vrit sous prtexte que la perscution ne peut pas lui faire de tort, ne saurait tre accuse d'tre hostile par avance l'accueil de vrits nouvelles. Mais elle ne se recommande pas par la gnrosit du traitement qu'elle rserve ceux envers qui l'humanit est redevable de ces vrits. Rvler au monde quelque chose qui lui importe au premier chef et qu'il ignorait jusque-l, lui montrer son erreur sur quelque point vital de ses intrts spirituels et temporels, c'est le service le plus important qu'un tre humain puisse rendre ses semblables ; et dans certains cas, comme celui des premiers chrtiens et des rformateurs, les partisans de l'opinion du Dr Johnson croient qu'il s'agit l des dons les plus prcieux qu'on puisse faire l'humanit. En revanche, qu'on rcompense les auteurs de ces magnifiques bienfaits par le martyr ou le traitement qu'on rserve aux plus vils criminels, voil qui n'est pas, selon cette thorie, une erreur et un malheur dplorables dont l'humanit devrait se repentir dans le sac et la cendre, mais le cours normal et lgitime des choses. Toujours selon cette thorie, l'auteur d'une vrit nouvelle devrait, comme chez les Locriens celui qui proposait une loi nouvelle, se prsenter la corde au cou qu'on serrait aussitt si l'assemble publique, aprs avoir entendu ses raisons, n'adoptait pas sur-le-champ sa proposition. Il est impossible de supposer que ceux qui dfendent cette faon de traiter les bienfaiteurs attachent beaucoup de prix aux bienfaits. Et je crois que ce point de vue n'existe que chez les gens persuads que les vrits nouvelles taient peut-tre souhaitables autrefois, mais que nous en avons assez aujourd'hui. Mais assurment, cette affirmation selon laquelle la vrit triomphe toujours de la perscution est un de ces mensonges que les hommes se plaisent se transmettre mais que rfute toute exprience - jusqu' ce qu'ils deviennent des lieux communs. L'histoire regorge d'exemples de vrits touffes par la perscution ; et si elle n'est pas supprime, elle se perptuera encore des sicles durant. Pour ne parler que des opinions religieuses, la Rforme clata au moins vingt fois avant Luther, et elle fut rduite au silence. Arnaud de Brescia, Fra Dolcino, Savonarole : rduits au silence. Les Albigeois, les Vaudois, les Lollards, les Hussites : rduits au silence. Mme aprs Luther, partout o la perscution se perptua, elle fut victorieuse. En Espagne, en Italie, en Flandres, en Autriche, le protestantisme fut extirp ; et il en aurait t trs probablement de mme en Angleterre, si la reine Marie avait vcu, ou si la reine Elizabeth tait morte. La perscution a triomph partout, except l o les hrtiques formaient un parti trop puissant pour tre efficacement perscuts. Le christianisme aurait pu tre extirp de l'empire romain: aucun homme raisonnable n'en peut douter. Il ne se rpandit et ne s'imposa que parce que les perscutions demeurrent sporadiques, de courte dure et spares par de longs intervalles de propagande presque libre. C'est pure sensiblerie de croire que la vrit, la vrit la plus pure - et non l'erreur - porte en elle ce pouvoir de passer outre le cachot et le bcher. Souvent les hommes ne sont pas plus zls pour la vrit que pour l'erreur; et une application suffisante de peines lgales ou mme sociales russit le plus souvent arrter la
John Stuart Mill (1859), De la libert
25
propagation de l'une et l'autre. Le principal avantage de la vrit consiste en ce que lorsqu'une opinion est vraie, on a beau l'touffer une fois, deux fois et plus encore, elle finit toujours par rapparatre dans le corps de l'histoire pour s'implanter dfinitivement une poque o, par suite de circonstances favorables, elle chappe la perscution assez longtemps pour tre en mesure de faire front devant les tentatives de rpression ultrieures. On nous dira qu'aujourd'hui, nous ne mettons plus mort ceux qui introduisent des opinions nouvelles. Contrairement nos pres, nous ne massacrons pas les prophtes : nous leur levons des spulcres. Il est vrai, nous ne mettons plus mort les hrtiques, et les sanctions pnales que nous tolrons aujourd'hui, mme contre les opinions les plus odieuses, ne suffiraient pas les extirper. Mais ne nous flattons pas encore d'avoir chapp la honte de la perscution lgale. Le dlit d'opinion - ou tout du moins de son expression - existe encore, et les exemples en sont encore assez nombreux pour ne pas exclure qu'ils reviennent un jour en force. En 1857, aux assises d't du comt de Cornouailles, un malheureux 1 , connu pour sa conduite irrprochable tous gards, fut condamn vingt et un mois d'emprisonnement pour avoir dit et crit sur une porte quelques mots offensants l'gard du christianisme. peine un mois plus tard, l'Old Bailey, deux personnes, deux occasions distinctes, furent refuses comme jurs 2 , et l'une d'elles fut grossirement insulte par le juge et l'un des avocats, parce qu'elles avaient dclar honntement n'avoir aucune croyance religieuse. Pour la mme raison, une troisime personne, un tranger victime d'un vol 3 se vit refuser justice. Ce refus de rparation fut tabli en vertu de la doctrine lgale selon laquelle une personne qui ne croit pas en Dieu (peu importe le dieu) et en une vie future ne peut tre admise tmoigner au tribunal ; ce qui quivaut dclarer ces personnes hors-la-loi, exclues de la protection des tribunaux; non seulement elles peuvent tre impunment l'objet de vols ou de voies de fait si elles n'ont d'autres tmoins qu'elles-mmes ou des gens de leur opinion, mais encore n'importe qui peut subir ces attentats impunment si la preuve du fait dpend de leur tmoignage. Le prsuppos l'origine de cette loi est que le serment d'une personne qui ne croit pas en une vie future est sans valeur, proposition qui rvle chez ceux qui l'admettent une grande ignorance de l'histoire (puisqu'il est historiquement vrai que la plupart des infidles de toutes les poques taient des gens dots d'un sens de l'honneur et d'une intgrit remarquables); et pour soutenir une telle opinion, il faudrait ne pas souponner combien de personnes rputes dans le monde tant pour leurs vertus que leurs talents sont bien connues, de leurs amis intimes du moins, pour tre des incroyants. D'ailleurs cette rgle se dtruit d'elle-mme en se coupant de ce qui la fonde. Sous prtexte que les athes sont des menteurs, elle incite tous les athes mentir et ne rejette que ceux qui bravent la honte de confesser publiquement une opinion dteste plutt que de soutenir un mensonge. Une rgle qui se condamne ainsi l'absurdit eu gard son but avou ne peut tre maintenue en vigueur que comme une marque de
1 2 3
Thomas Pooley, assises de Bodmin, 31 juillet 1857: au mois de dcembre suivant, il reut un libre pardon de la Couronne. Georges-Jacob Holyake, 17 aot 1857; Edward Truelove, juillet 1857. Baron de Gleichen, cour de police de Marlborough Street, 4 aot 1857.
John Stuart Mill (1859), De la libert
26
haine, comme un vestige de perscution - perscution dont la particularit est de n'tre inflige ici qu' ceux qui ont prouv ne pas la mriter. Cette rgle et la thorie qu'elle implique ne sont gure moins insultantes pour les croyants que pour les infidles. Car si celui qui ne croit pas en une vie future est ncessairement un menteur, il s'ensuit que seule la crainte de l'enfer empche, si tant est qu'elle empche quoi que ce soit, ceux qui y croient de mentir. Nous ne ferons pas aux auteurs et aux complices de cette rgle l'injure de supposer que l'ide qu'ils se sont forme de la vertu chrtienne est le fruit de leur propre conscience. la vrit, ce ne sont l que des lambeaux et des restes de perscution que l'on peut considrer non pas tant comme l'indication de la volont de perscuter, mais comme une manifestation de cette infirmit trs frquente chez les esprits anglais de prendre un plaisir absurde affirmer un mauvais principe alors qu'ils ne sont plus eux-mmes assez mauvais pour dsirer rellement le mettre en pratique. Avec cette mentalit, il n'y a malheureusement aucune assurance que la suspension des plus odieuses formes de perscution lgale, qui s'est affirme l'espace d'une gnration, continuera. A notre poque, la surface paisible de la routine est frquemment trouble la fois par des tentatives de ressusciter des maux passs que d'introduire de nouveaux biens. Ce qu'on vante prsent comme la renaissance de la religion correspond toujours dans les esprits troits et incultes la renaissance de la bigoterie; et lorsqu'il couve dans les sentiments d'un peuple ce puissant levain d'intolrance, qui subsiste dans les classes moyennes de ce pays, il faut bien peu de choses pour les pousser perscuter activement ceux qu'il n'a jamais cess de juger dignes de perscution 1 . C'est bien cela - les opinions que cultivent les hommes et les sentiments qu'ils nourrissent l'gard de ceux qui s'opposent aux croyances qu'ils estiment importantes - qui empche ce pays de devenir un lieu de libert pour l'esprit. Depuis longtemps dj, le principal mfait des sanctions lgales est de renforcer le stigmate social. Et ce stigmate est particulirement virulent en Angleterre o l'on professe bien moins
1
Il faut voir un avertissement srieux dans le dchanement de passions perscutrices qui s'est ml, lors de la rvolte des Cipayes, l'expression gnrale des pires aspects de notre caractre national. Les dlires furieux que des fanatiques ou des charlatans profraient du haut de leurs chaires ne sont peut-tre pas dignes d'tre relevs ; mais les chefs du parti vanglique ont pos pour principe de gouvernement des Hindous et des Musulmans de ne financer par les deniers publics que les coles dans lesquelles on enseigne la Bible, et de n'attribuer par consquent les postes de fonctionnaire qu' des chrtiens rels ou prtendus tels. Un sous-secrtaire d'tat, dans un discours ses lecteurs le 12 novembre 1857, aurait dclar : Le gouvernement britannique, en tolrant leur foi (la foi de cent millions de sujets britanniques), n'a obtenu d'autres rsultats que freiner la suprmatie du nom anglais et d'empcher le dveloppement salutaire christianisme. (...) La tolrance est la grande pierre angulaire de ce pays ; mais ne les laissez pas abuser de ce mot prcieux de tolrance. Comme l'entendait le sous-secrtaire d'tat, elle signifiait libert complte, la libert de culte pour tous parmi les chrtiens qui clbraient leur culte sur de mmes bases. Elle signifiait la tolrance de toutes les sectes et confessions de chrtiens croyant en la seule et unique mdiation. Je souhaite attirer l'attention sur le fait qu'un homme qui a t jug apte remplir une haute fonction dans le gouvernement de ce pays, sous un ministre libral, dfend l la doctrine selon laquelle tous ceux qui ne croient pas en la divinit du Christ sont hors des bornes de la tolrance. Qui, aprs cette dmonstration imbcile, peut s'abandonner l'illusion que les perscutions religieuses sont rvolues ?
John Stuart Mill (1859), De la libert
27
frquemment des opinions mises au ban de la socit que dans d'autres pays o l'on avoue des opinions entranant des punitions judiciaires. Pour tout le monde, except ceux que leur fortune ne rend pas dpendants de la bonne volont des autres, l'opinion est sur ce point aussi efficace que la loi : il revient au mme que les hommes soient emprisonns qu'empchs de gagner leur pain. Ceux dont le pain est dj assur et qui n'attendent la faveur ni des hommes au pouvoir, ni d'aucun corps, ni du public, ceux-l n'ont rien craindre en avouant franchement n'importe quelle opinion si ce n'est le mpris ou la calomnie, et, pour supporter cela, point n'est besoin d'un grand hrosme. Il n'y a pas lieu d'en appeler ad misericordiam en faveur de telles personnes. Mais, bien que nous n'infligions plus tant de maux qu'autrefois ceux qui pensent diffremment de nous, nous nous faisons peut-tre toujours autant de mal. Socrate fut mis mort, mais sa philosophie s'leva comme le soleil dans le ciel et rpandit sa lumire sur tout le firmament intellectuel. Les chrtiens furent jets aux lions, mais l'glise chrtienne devint un arbre imposant et large, dpassant les plus vieux et les moins vigoureux et les touffant de son ombre. Notre intolrance, purement sociale, ne tue personne, n'extirpe aucune opinion, mais elle incite les hommes dguiser les leurs et ne rien entreprendre pour les diffuser. Aujourd'hui, les opinions hrtiques ne gagnent ni mme ne perdent grand terrain d'une dcade ou d'une gnration l'autre; mais jamais elles ne brillent d'un vif clat et perdurent dans le cercle troit de penseurs et de savants o elles ont pris naissance, et cela sans jamais jeter sur les affaires gnrales de l'humanit une lumire qui s'avrerait plus tard vraie ou trompeuse. C'est ainsi que se perptue un tat de choses trs satisfaisant pour certains esprits, parce qu'il maintient toutes les opinions dominantes dans un calme apparent, sans avoir le souci de mettre quiconque l'amende ou au cachot et sans interdire absolument l'exercice de la raison aux dissidents affligs de la maladie de penser. C'est l un plan fort commode pour maintenir la paix dans le monde intellectuel et pour laisser les choses suivre leur cours habituel. Mais le prix de cette sorte de pacification intellectuelle est le sacrifice de tout le courage moral de l'esprit humain. Un tat de chose, o les plus actifs et les plus curieux des esprits jugent prudent de garder pour eux les principes gnraux de leurs convictions, et o ils s'efforcent en public d'adapter autant que faire se peut leurs propres conclusions des prmisses qu'ils nient intrieurement, un tel systme cesse de produire ces caractres francs et hardis, ces intelligences logiques et cohrentes qui ornaient autrefois le monde de la pense. Le genre d'hommes qu'engendre un tel systme sont soit de purs esclaves du lieu commun, soit des opportunistes de la vrit dont les arguments sur tous les grands sujets s'adaptent en fonction de leurs auditeurs et ne sont pas ceux qui les ont convaincus eux-mmes. Ceux qui vitent cette alternative y parviennent en limitant leur champ de pense et d'intrt aux choses dont on peut parler sans s'aventurer sur le terrain des principes ; c'est--dire un petit nombre de problmes pratiques qui se rsoudraient d'eux-mmes si seulement les esprits se raffermissaient et s'largissaient, mais qui resteront sans solution tant qu'est laiss l'abandon ce qui renforce et ouvre l'esprit humain aux spculations libres et audacieuses sur les sujets les plus levs. Les hommes qui ne jugent pas mauvaise cette rserve des hrtiques devraient d'abord considrer qu'un tel silence revient ce que les opinions hrtiques ne fassent
John Stuart Mill (1859), De la libert
28
jamais l'objet d'une rflexion franche et approfondie, de sorte que celles d'entre elles qui ne rsisteraient pas une pareille discussion ne disparaissent pas, mme si par ailleurs on les empche de se rpandre. Mais ce n'est pas l'esprit hrtique que nuit le plus la mise au ban de toutes les recherches dont les conclusions ne seraient pas conformes l'orthodoxie. Ceux qui en souffrent davantage sont les bien-pensants, dont tout le dveloppement intellectuel est entrav et dont la raison est soumise la crainte de l'hrsie. Qui peut calculer ce que perd le monde dans cette multitude d'intelligences prometteuses doubles d'un caractre timide qui n'osent pas mener terme un enchanement d'ides hardi, vigoureux et indpendant de peur d'aboutir une conclusion juge irrligieuse ou immorale ? Parmi eux, il est parfois des hommes d'une grande droiture, l'esprit subtil et raffin, qui passent leur vie ruser avec une intelligence qu'ils ne peuvent rduire au silence, puisant ainsi leurs ressources d'ingniosit s'efforcer de rconcilier les exigences de leur conscience et de leur raison avec l'orthodoxie, sans forcment toujours y parvenir. Il est impossible d'tre un grand penseur sans reconnatre que son premier devoir est de suivre son intelligence, quelle que soit la conclusion laquelle elle peut mener. La vrit bnficie encore plus des erreurs d'un homme qui, aprs les tudes et la prparation ncessaire, pense par lui-mme, que des opinions vraies de ceux qui les dtiennent uniquement parce qu'ils s'interdisent de penser. Non pas que la libert de penser soit exclusivement ncessaire aux grands penseurs. Au contraire, elle est aussi indispensable sinon plus indispensable - l'homme du commun pour lui permettre d'atteindre la stature intellectuelle dont il est capable. il y a eu, et il y aura encore peut-tre, de grands penseurs individuels dans une atmosphre gnrale d'esclavage intellectuel. Mais il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais dans une telle atmosphre de peuple intellectuellement actif. Quand un peuple accdait temporairement cette activit ,c'est que la crainte des spculations htrodoxes tait pour un temps suspendue. L o il existe une entente tacite de ne pas remettre en question les principes, l o la discussion des questions fondamentales qui proccupent l'humanit est estime close, on ne peut esprer trouver cette activit intellectuelle de grande envergure qui a rendu si remarquables certaines priodes de l'histoire. Lorsque la controverse vite les sujets assez fondamentaux pour enflammer l'enthousiasme, jamais on ne voit l'esprit d'un peuple se dgager de ses principes fondamentaux, jamais il ne reoit l'impulsion qui lve mme les gens d'une intelligence moyenne la dignit d'tres pensants. L'Europe a connu de telles priodes d'mulation intellectuelle: la premire, immdiatement aprs la Rforme; une autre, quoique limite au Continent et la classe la plus cultive, lors du mouvement spculatif de la dernire moiti du XVIIIe sicle ; et une troisime plus brve encore, lors de la fermentation intellectuelle de l'Allemagne au temps de Goethe et de Fichte. Ces trois priodes diffrent grandement quant aux opinions particulires qu'elles dvelopprent, mais elles se ressemblent en ce que tout le temps de leur dure le joug de l'autorit fut bris. Dans les trois cas, un ancien despotisme intellectuel fut dtrn, sans qu'un autre ne soit venu le remplacer. L'impulsion donne par chacune de ces trois priodes a fait de l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui. Le moindre progrs qui s'est produit, dans l'esprit ou dans les institutions humaines, remonte manifestement l'une ou l'autre de ces priodes. Tout indique
John Stuart Mill (1859), De la libert
29
depuis quelque temps que ces trois impulsions sont pour ainsi dire puises ; et nous ne prendrons pas de nouveau dpart avant d'avoir raffirm la libert de nos esprits. Passons maintenant la deuxime branche de notre argument et, abandonnant l'hypothse que les opinions reues puissent tre fausses, admettons qu'elles soient vraies et examinons ce que vaut la manire dont on pourra les soutenir l o leur vrit n'est pas librement et ouvertement dbattue. Quelque peu dispos qu'on soit admettre la possibilit qu'une opinion laquelle on est fortement attach puisse tre fausse, on devrait tre touch par l'ide que, si vraie que soit cette opinion, on la considrera comme un dogme mort et non comme une vrit vivante, si on ne la remet pas entirement, frquemment, et hardiment en question. Il y a une classe de gens (heureusement moins nombreuse qu'autrefois) qui estiment suffisant que quelqu'un adhre aveuglment une opinion qu'ils croient vraie sans mme connatre ses fondements et sans mme pouvoir la dfendre contre les objections les plus superficielles. Quand de telles personnes parviennent faire enseigner leur croyance par l'autorit, elles pensent naturellement que si l'on en permettait la discussion, il n'en rsulterait que du mal. L o domine leur influence, elles rendent presque impossible de repousser l'opinion reue avec sagesse et rflexion, bien qu'on puisse toujours la rejeter inconsidrment et par ignorance ; car il est rarement possible d'exclure compltement la discussion, et aussitt qu'elle reprend, les croyances qui ne sont pas fondes sur une conviction relle cdent facilement ds que surgit le moindre semblant d'argument. Maintenant, cartons cette possibilit et admettons que l'opinion vraie reste prsente dans l'esprit, mais l'tat de prjug, de croyance indpendante de l'argument et de preuve contre ce dernier: ce n'est pas encore l la faon dont un tre raisonnable devrait dtenir la vrit. Ce n'est pas encore connatre la vrit. Cette conception de la vrit n'est qu'une superstition de plus qui s'accroche par hasard aux mots qui noncent une vrit. Si l'intelligence et le jugement des hommes doivent tre cultivs - ce que les protestants au moins ne contestent pas -, sur quoi ces facults pourront-elles le mieux s'exercer si ce n'est sur les choses qui concernent chacun au point qu'on juge ncessaire pour lui d'avoir des opinions leur sujet ? Si l'entretien de l'intelligence a bien une priorit, c'est bien de prendre conscience des fondements de nos opinions personnelles. Quoi que l'on pense sur les sujets o il est primordial de penser juste, on devrait au moins tre capable de dfendre ses ides contre les objections ordinaires. Mais, nous rtorquera-t-on: Qu'on enseigne donc aux hommes les fondements de leurs opinions ! Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais entendu contester des opinions qu'on doit se contenter de les rpter comme un perroquet. Ceux qui tudient la gomtrie ne se contentent pas de mmoriser les thormes, mais ils les comprennent et en apprennent galement les dmonstrations : aussi serait-il absurde de prtendre qu'ils demeurent ignorants des fondements des vrits gomtriques sous prtexte qu'ils n'entendent jamais qui que ce soit les rejeter et s'efforcer de les rfuter. Sans doute. Mais un tel enseignement suffit pour une matire comme les mathmatiques, o la contestation est impossible. L'vidence des vrits mathmatiques a ceci de
John Stuart Mill (1859), De la libert
30
singulier que tous les arguments sont du mme ct. Il n'y a ni objection ni rponses aux objections. Mais sur tous sujets o la diffrence d'opinion est possible, la vrit dpend d'un quilibre tablir entre deux groupes d'arguments contradictoires. Mme en philosophie naturelle, il y a toujours une autre explication possible des mmes faits : une thorie gocentrique au lieu de l'hliocentrique, le phlogistique au lieu de l'oxygne; et il faut montrer pourquoi cette autre thorie ne peut pas tre la vraie; et avant de savoir le dmontrer, nous ne comprenons pas les fondements de notre opinion. Mais si nous nous tournons vers des sujets infiniment plus compliqus, vers la morale, la religion, la politique, les relations sociales et les affaires de la vie, les trois quarts des arguments pour chaque opinion conteste consistent dissiper les aspects favorables de l'opinion oppose. L'un des plus grands orateurs de l'Antiquit rapporte qu'il tudiait toujours la cause de son adversaire avec autant, sinon davantage, d'attention que la sienne propre. Ce que Cicron faisait en vue du succs au barreau doit tre imit par tous ceux qui se penchent sur un sujet afin d'arriver la vrit. Celui qui ne connat que ses propres arguments connat mal sa cause. Il se peut que ses raisons soient bonnes et que personne n'ait t capable de les rfuter. Mais s'il est tout aussi incapable de rfuter les raisons du parti adverse, s'il ne les connat mme pas, rien ne le fonde prfrer une opinion l'autre. Le seul choix raisonnable pour lui serait de suspendre son jugement, et faute de savoir se contenter de cette position, soit il se laisse conduire par l'autorit, soit il adopte, comme on le fait en gnral, le parti pour lequel il se sent le plus d'inclination. Mais il ne suffit pas non plus d'entendre les arguments des adversaires tels que les exposent ses propres matres, c'est--dire leur faon et accompagns de leurs rfutations. Telle n'est pas la faon de rendre justice ces arguments ou d'y mesurer vritablement son esprit. Il faut pouvoir les entendre de la bouche mme de ceux qui y croient, qui les dfendent de bonne foi et de leur mieux. Il faut les connatre sous leur forme la plus plausible et la plus persuasive : il faut sentir toute la force de la difficult que la bonne approche du sujet doit affronter et rsoudre. Autrement, jamais on ne possdera cette partie de vrit qui est seule capable de rencontrer et de supprimer la difficult. C'est pourtant le cas de quatre-vingt-dix-neuf pour cent des hommes dits cultivs, mme de ceux qui sont capables d'exposer leurs opinions avec aisance. Leur conclusion peut tre vraie, mais elle pourrait tre fausse sans qu'ils s'en doutassent: jamais ils ne se sont mis la place de ceux qui pensent diffremment, jamais ils n'ont prt attention ce que ces personnes avaient dire. Par consquent, ils ne connaissent pas, proprement parler, la doctrine qu'ils professent. Ils ne connaissent pas ces points fondamentaux de leur doctrine qui en expliquent et justifient le reste, ces considrations qui montrent que deux faits, en apparence contradictoires, sont rconciliables, ou que de deux raisons apparemment fortes, l'une doit tre prfre l'autre. De tels hommes demeurent trangers tout ce pan de la vrit qui dcide du jugement d'un esprit parfaitement clair. Du reste, seuls le connaissent ceux qui ont galement et impartialement frquents les deux partis et qui se sont attachs respectivement envisager leurs raisons sous leur forme la plus convaincante. Cette discipline est si essentielle une vritable comprhension des sujets moraux ou humains que, s'il n'y a pas d'adversaires pour toutes les vrits importantes, il est indispensable d'en imaginer et de leur fournir les arguments les plus forts que puisse invoquer le plus habile avocat du diable.
John Stuart Mill (1859), De la libert
31
Pour diminuer la force de ces considrations, supposons qu'un ennemi de la libre discussion rtorque qu'il n'est pas ncessaire que l'humanit tout entire connaisse et comprenne tout ce qui peut tre avanc pour ou contre ses opinions par des philosophes ou des thologiens ; qu'il n'est pas indispensable pour le commun des hommes de pouvoir exposer toutes les erreurs et les sophismes d'un habile adversaire; qu'il suffit qu'il y ait toujours quelqu'un capable d'y rpondre, afin qu'aucun sophisme propre tromper les personnes sans instruction ne reste pas sans rfutation et que les esprits simples, une fois qu'ils connaissent les principes vidents des vrits qu'on leur a inculques, puissent s'en remettre l'autorit pour le reste ; que, bien conscients qu'ils n'ont pas la science et le talent ncessaires pour rsoudre toutes les difficults susceptibles d'tre souleves, ils peuvent avoir l'assurance que toutes celles qu'on a souleves ont reu une rponse ou peuvent en recevoir une de ceux qui sont spcialement entrans cette tche. Mme en concdant ce point de vue tout ce que peuvent rclamer en sa faveur ceux qui se satisfont le plus facilement d'une comprhension imparfaite de la vrit, les arguments les plus convaincants en faveur de la libre discussion n'en sont nullement affaiblis ; car mme cette doctrine reconnat que l'humanit devrait avoir l'assurance que toutes les objections ont reu une rponse satisfaisante. Or, comment peut-on y rpondre si ce qui demande rponse n'est pas exprim ? Comment savoir si la rponse est satisfaisante si les objecteurs n'ont pas la possibilit de montrer qu'elle ne l'est pas ? Si le public en est empch, il faut au moins que les philosophes et les thologiens puissent rsoudre ces difficults, se familiariser avec celles-ci sous leur forme la plus dconcertante; pour cela, ils ne peuvent y parvenir que si elles sont prsentes sous leur jour le plus avantageux. L'glise catholique traite sa faon ce problme embarrassant. Elle spare nettement entre ceux qui ont le droit de se convaincre des doctrines et ceux qui doivent les accepter sans examen. A la vrit, elle ne permet aucun des deux groupes de choisir ce qu'ils veulent ou non accepter; mais pour le clerg - ou du moins ceux de ses membres en qui on peut avoir confiance -, il est non seulement permis, mais mritoire de se familiariser avec les arguments des adversaires afin d'y rpondre; il peut par consquent lire les livres hrtiques ; tandis que les laques ne le peuvent pas sans une permission spciale difficile obtenir. Cette discipline juge bnfique que les professeurs connaissent la cause adverse, mais trouve les moyens appropris de la refuser aux autres, accordant ainsi l'lite une plus grande culture, sinon une plus grande libert d'esprit, qu' la masse. C'est par ce procd qu'elle russit obtenir la sorte de libert intellectuelle qu'exige son but ; car bien qu'une culture sans libert n'ait jamais engendr d'esprit vaste et libral, elle peut nanmoins produire un habile avocat d'une cause. Mais ce recours est exclu dans les pays professant le protestantisme, puisque les protestants soutiennent, du moins en thorie, que la responsabilit de choisir sa propre religion incombe chacun et qu'on ne peut s'en dcharger sur ses matres. D'ailleurs, dans l'tat actuel du monde, il est pratiquement impossible que les ouvrages lus par les gens instruits demeurent hors d'atteinte des incultes. S'il faut que les matres de
John Stuart Mill (1859), De la libert
32
l'humanit aient connaissance de tout ce qu'ils devraient savoir, il faut avoir l'entire libert d'crire et de publier. Cependant, si l'absence de libre discussion ne causait d'autre mal - lorsque les opinions reues sont vraies - que de laisser les hommes dans l'ignorance des principes de ces opinions, on pourrait penser qu'il s'agit l non d'un prjudice moral, mais d'un prjudice simplement intellectuel, n'affectant nullement la valeur des opinions quant leur influence sur le caractre. Le fait est pourtant que l'absence de discussion fait oublier non seulement les principes, mais trop souvent aussi le sens mme de l'opinion. Les mots qui l'expriment cessent de suggrer des ides ou ne suggrent plus qu'une mince partie de celles qu'ils servaient rendre originairement. Au lieu d'une conception forte et d'une foi vivante, il ne reste plus que quelques phrases apprises par cur ; ou si l'on garde quelque chose du sens, ce n'en est plus que l'enveloppe: l'essence la plus subtile est perdue. Ce fait, qui occupe et remplit un grand chapitre de l'histoire, ne saurait tre trop tudi et mdit. Il est prsent dans l'exprience de presque toutes les doctrines morales et croyances religieuses. Elles sont pleines de sens et de vitalit pour leurs initiateurs et leurs premiers disciples. Leur sens demeure aussi fort - peut-tre mme devient-il plus pleinement conscient - tant qu'on lutte pour donner la doctrine ou la croyance un ascendant sur toutes les autres. A la fin, soit elle s'impose et devient l'opinion gnrale, soit son progrs s'arrte ; elle conserve le terrain conquis, mais cesse de s'tendre. Quand l'un ou l'autre de ces rsultats devient manifeste, la controverse sur le sujet faiblit et s'teint graduellement. La doctrine a trouv sa place, sinon comme l'opinion reue, du moins comme l'une des sectes ou divisions admises de l'opinion ; ses dtenteurs l'ont gnralement hrite, ils ne l'ont pas adopte ; c'est ainsi que les conversions de l'une l'autre de ces doctrines deviennent un fait exceptionnel et que leurs partisans finissent par ne plus se proccuper de convertir. Au lieu de se tenir comme au dbut constamment sur le qui-vive, soit pour se dfendre contre le monde, soit pour le conqurir, ils tombent dans l'inertie, n'coutent plus que rarement les arguments avancs contre leur credo et cessent d'ennuyer leurs adversaires (s'il y en a) avec des arguments en sa faveur. C'est ce point qu'on date habituellement le dclin de la vitalit d'une doctrine. On entend souvent les catchistes de toutes croyances se plaindre de la difficult d'entretenir dans l'esprit des croyants une perception vive de la vrit qu'ils reconnaissent nominalement afin qu'elle imprgne leurs sentiments et acquire une influence relle sur leur conduite. On ne rencontre pas une telle difficult tant que la croyance lutte encore pour s'tablir; alors, mme les combattants les plus faibles savent et sentent pourquoi ils luttent et connaissent la diffrence entre leur doctrine et les autres. C'est ce moment de l'existence de toute croyance qu'on rencontre nombre de personnes qui ont assimil ses principes fondamentaux sous toutes les formes de la pense, qui les ont pess et considrs sous tous leurs aspects importants, et qui ont pleinement ressenti sur leur caractre l'effet que cette croyance devrait produire sur un esprit qui en est totalement pntr. Mais une fois la croyance devenue hrditaire - une fois qu'elle est admise passivement et non plus activement, une fois que l'esprit ne se sent plus autant contraint de concentrer toutes ses facults
John Stuart Mill (1859), De la libert
33
sur les questions qu'elle lui pose - on tend tout oublier de cette croyance pour ne plus en retenir que des formules ou ne plus lui accorder qu'un mol et torpide assentiment, comme si le fait d'y croire dispensait de la ncessit d'en prendre clairement conscience ou de l'appliquer dans sa vie: c'est ainsi qu'une croyance finit par ne plus se rattacher du tout la vie intrieure de l'tre humain. Alors apparaissent ces cas - si frquents aujourd'hui qu'ils sont presque la majorit - o la croyance semble demeurer hors de l'esprit, dsormais encrote et ptrifi contre toutes les autres influences destines aux parties les plus nobles de notre nature, figement qui se manifeste par une allergie toute conviction nouvelle et vivante et qui joue le rle de sentinelle afin de maintenir vides l'esprit et le cur. On voit quel point les doctrines susceptibles en elles-mmes de produire la plus profonde impression sur l'esprit peuvent y rsider l'tat de croyances mortes, et cela sans jamais nourrir ni l'imagination, ni les sentiments, ni l'intelligence, lorsqu'on voit comment la majorit des croyants professent le christianisme. Par christianisme, j'entends ici ce que tiennent pour tel toutes les glises et sectes : les maximes et les prceptes contenus dans le Nouveau Testament. Tous ceux qui se prtendent chrtiens les tiennent pour sacrs et les acceptent comme lois. Et pourtant on peut dire que moins d'un chrtien sur mille guide ou juge sa conduite individuelle d'aprs ces lois. Le modle auquel on se rfre est la coutume de son pays, de sa classe ou de sa secte religieuse. Le chrtien croit donc qu'il existe d'un ct une collection de maximes thiques que la sagesse infaillible, selon lui, a daign lui transmettre comme rgle de conduite, et de l'autre un ensemble de jugements et de pratiques habituels qui s'accordent assez bien avec certaines de ces maximes, moins bien avec d'autres, ou qui s'opposent directement d'autres encore - lesquels constituent en somme un compromis entre la foi chrtienne et les intrts et les suggestions de la vie matrielle. Au premier de ces modles le chrtien donne son hommage ; au deuxime, son obissance effective. Tous les chrtiens croient que bienheureux sont les pauvres, les humbles et tous ceux que le monde maltraite; qu'il est plus facile un chameau de passer par le chas d'une aiguille qu' un riche d'entrer au royaume des cieux; qu'ils ne doivent pas juger de peur d'tre jugs eux-mmes; qu'ils ne doivent pas jurer; qu'ils doivent aimer leur prochain comme eux-mmes; que si quelqu'un prend leur manteau, ils doivent lui donner aussi leur tunique; qu'ils ne doivent pas penser au lendemain; que pour tre parfaits, ils doivent vendre tout ce qu'ils ont et le donner aux pauvres. Ils ne mentent pas quand ils disent qu'ils croient ces choses-l, ils les croient comme les gens croient ce qu'ils ont toujours entendu louer, mais jamais discuter. Mais, dans le sens de cette croyance vivante qui rgle la conduite, ils croient en ces doctrines uniquement dans la mesure o l'on a coutume d'agir d'aprs elles. Dans leur intgrit, les doctrines servent accabler les adversaires; et il est entendu qu'on doit les mettre en avant (si possible) pour justifier tout ce qu'on estime louable. Mais s'il y avait quelqu'un pour leur rappeler que ces maximes exigent une foule de choses qu'ils n'ont jamais l'intention de faire, il n'y gagnerait que d'tre class parmi ces personnages impopulaires qui affectent d'tre meilleurs que les autres. Les doctrines n'ont aucune prise sur les croyants ordinaires, aucun pouvoir sur leurs esprits. Par habitude, ils en respectent les formules, mais pour eux, les mots sont dpourvus de sens et ne
John Stuart Mill (1859), De la libert
34
suscitent aucun sentiment qui force l'esprit les assimiler et les rendre conformes la formule. Pour savoir quelle conduite adopter, les hommes prennent comme modle leurs voisins pour apprendre jusqu'o il faut aller dans l'obissance du Christ. Nous pouvons tre certains qu'il en allait tout autrement chez les premiers chrtiens. Autrement, jamais le christianisme ne serait pass de l'tat de secte obscure d'Hbreux mpriss la religion officielle de l'Empire romain. Quand leurs ennemis disaient: Voyez comme ces chrtiens s'aiment les uns les autres (une remarque que personne ne ferait aujourd'hui), ils avaient assurment un sentiment autrement plus vif qu'aujourd'hui de la signification de leur croyance. Voil sans doute la raison principale pour laquelle le christianisme fait aussi peu de progrs maintenant et se trouve, aprs dix-huit sicles, peu prs circonscrit aux Europens et leurs descendants. Mme chez les personnes strictement religieuses, qui prennent leurs doctrines au srieux et qui y attachent plus de signification qu'on ne le fait en gnral, il arrive frquemment que la partie la plus active de leur esprit soit ferme par Calvin ou Knox, ou toute autre personnalit d'un caractre apparent au leur. Les paroles du Christ coexistent passivement dans leur esprit, ne produisant gure d'autre effet que l'audition machinale de paroles si aimables et si douces. Nombre de raisons pourraient sans doute expliquer pourquoi les doctrines servant d'attribut distinctif une secte conservent mieux leur vitalit que les doctrines communes toutes les sectes reconnues ; l'une d'elle est que ceux qui les enseignent prennent plus de soin maintenir vive leur signification. Mais la principale raison, c'est que ces doctrines sont davantage mises en question et doivent plus souvent se dfendre contre des adversaires dclars. Ds qu'il n'y a plus d'ennemi en vue, matres et disciples s'endorment leur poste. La mme chose vaut en gnral pour toutes les doctrines traditionnelles - dans les domaines de la prudence et de la connaissance de la vie, aussi bien que de la morale et de la religion. Toutes les langues et toutes les littratures abondent en observations gnrales sur la vie et sur la manire de s'y comporter - observations que chacun connat, rpte ou coute docilement, qu'on reoit comme des truismes et dont pourtant on n'apprend en gnral le vrai sens que lorsque l'exprience souvent pnible les transforme en ralit. Que de fois une personne accable par un malheur ou une dception ne se rappelle-t-elle pas quelque proverbe ou dicton populaire qu'elle connat depuis toujours et qui, si elle en avait plus tt compris la signification, lui aurait pargn cette calamit. En fait, il y a d'autres raisons cela que l'absence de discussion ; nombreuses sont les vrits dont on ne peut pas comprendre tout le sens tant qu'on ne les a pas vcues personnellement. Mais on aurait bien mieux compris la signification de ces vrits, et ce qui en aurait t compris aurait fait sur l'esprit une impression bien plus profonde, si l'on avait eu l'habitude d'entendre des gens qui la comprenaient effectivement discuter le pour et le contre. La tendance fatale de l'espce humaine laisser de ct une chose ds qu'il n'y a plus de raison d'en douter est la cause de la moiti de ses erreurs. Un auteur contemporain a bien dcrit le profond sommeil d'une opinion arrte .
John Stuart Mill (1859), De la libert
35
Mais quoi! demandera-t-on, l'absence d'unanimit est-elle une condition indispensable au vrai savoir ? Est-il ncessaire qu'une partie de l'humanit persiste dans l'erreur pour permettre l'autre de comprendre la vrit ? Une croyance cesse-telle d'tre vraie et vivante ds qu'elle est gnralement accepte ? Une proposition n'est-elle jamais compltement comprise et prouve si l'on ne conserve quelque doute sur son compte ? La vrit prit-elle aussitt que l'humanit l'a unanimement accepte ? N'a-t-on pas pens jusqu' prsent que le but suprme et le rsultat le plus parfait du progrs de l'intelligence taient d'unir les hommes dans la reconnaissance de toutes les vrits fondamentales ? L'intelligence ne dure-t-elle que tant qu'elle n'a pas atteint son but ? Les fruits de la conqute meurent-ils avec la plnitude, la victoire ? Je n'affirme rien de tel. mesure que l'humanit progressera, le nombre des doctrines qui ne sont plus objet ni de discussion ni de doute ira croissant; et le bien-tre de l'humanit pourra presque se mesurer au nombre et l'importance des vrits arrives au point de n'tre plus contestes. L'abandon progressif des diffrents points d'une controverse srieuse est l'un des alas ncessaires de la consolidation de l'opinion, consolidation aussi salutaire dans le cas d'une opinion juste que dangereuse et nuisible quand les opinions sont errones. Mais, quoique ce rtrcissement progressif des limites de la diversit d'opinions soit ncessaire dans les deux sens du terme - la fois invitable et indispensable -, rien ne nous oblige pour autant conclure que toutes ses consquences doivent tre bnfiques. Bien que la perte d'une aide aussi importante que la ncessit d'expliquer ou de dfendre une vrit contre des opposants ne puisse se mesurer au bnfice de sa reconnaissance universelle, elle n'en est pas moins un inconvnient non ngligeable. L o n'existe plus cet avantage, j'avoue que j'aimerais voir les matres de l'humanit s'attacher lui trouver un substitut - un moyen de mettre les difficults de la question en vidence dans l'esprit de l'lve, tel un fougueux adversaire s'acharnant le convertir. Mais au lieu de chercher de tels moyens, ils perdent ceux qu'ils avaient autrefois. La dialectique socratique, si magnifiquement illustre dans les dialogues de Platon, en tait un. Elle tait essentiellement une discussion ngative des grandes questions de la philosophie et de la vie visant convaincre avec un art consomm quiconque s'tait content d'adopter les lieux communs de l'opinion reue, qu'il ne comprenait pas le sujet - qu'il n'avait attach aucun sens dfini aux doctrines qu'il professait jusque-l - de sorte qu'en prenant conscience de son ignorance, il ft en mesure de se constituer une croyance stable, reposant sur une perception claire la fois du sens et de l'vidence des doctrines. Au moyen ge, les disputes scolastiques avaient un but peu prs similaire. Elles servaient vrifier que l'lve comprenait sa propre opinion et (par une corrlation ncessaire) l'opinion oppose, et qu'il pouvait aussi bien dfendre les principes de l'une que rfuter ceux de l'autre. Ces joutes avaient pourtant un dfaut irrmdiable: celui de tirer leurs prmisses non de la raison, mais de l'autorit; c'est pourquoi en tant que discipline de l'esprit, elles taient en tout point infrieure la puissante dialectique qui modle les intelligences des Socratici viri ; mais l'esprit moderne doit beaucoup plus toutes deux qu'il ne veut gnralement le
John Stuart Mill (1859), De la libert
36
reconnatre, et les modes d'ducation actuels n'ont pour ainsi dire rien pour prtendre remplacer l'une ou l'autre. Celui qui tient toute son instruction des professeurs ou des livres n'est nullement contraint d'entendre les deux cts d'une question, et cela mme s'il chappe la tentation habituelle de se satisfaire de connatre les choses par cur. C'est pourquoi il est fort rare de bien connatre les deux versants d'un mme problme; c'est ce qu'il y a de plus faible dans ce que l'on dit pour dfendre ses opinions qui fait office de rplique ses adversaires. C'est aujourd'hui la mode de dprcier la logique ngative, celle qui rvle les faiblesses thoriques et les erreurs pratiques, sans tablir de vrits positives. Il est vrai qu'une telle critique ngative ferait un assez pauvre rsultat final; mais en tant que moyen d'acqurir une connaissance positive ou une conviction digne de ce nom, on ne saurait trop insister sur sa valeur. Et tant que les hommes n'y seront pas de nouveau systmatiquement entrans, il y aura fort peu de grands penseurs, et le niveau moyen d'intelligence dans les domaines de la spculation autres que les mathmatiques et les sciences physiques demeurera trs bas. Sur tout autre sujet, aucune opinion ne mrite le nom de connaissance moins d'avoir suivi, de gr ou de force, la dmarche intellectuelle qu'et exig de son tenant une controverse active avec des adversaires. On voit donc quel point il est aussi absurde de renoncer un avantage indispensable qui s'offre spontanment, alors qu'il est si difficile crer quand il manque. S'il y a des gens pour contester une opinion reue ou pour dsirer le faire si la loi ou l'opinion publique le leur permet, il faut les en remercier, ouvrir nos esprits leurs paroles et nous rjouir qu'il y en ait qui fassent pour nous ce que nous devrions prendre davantage la peine de faire, si tant est que la certitude ou la vitalit de nos convictions nous importe. Il nous reste encore parler d'une des principales causes qui rendent la diversit d'opinions avantageuse et qui le demeurera tant que l'humanit n'aura pas atteint un niveau de dveloppement intellectuel dont elle semble aujourd'hui encore mille lieues. Nous n'avons jusqu' prsent examin que deux possibilits: la premire, que l'opinion reue peut tre fausse, et une autre, du mme coup, vraie; la deuxime, que si l'opinion reue est vraie, c'est que la lutte entre celle-ci et l'erreur oppose est essentielle une perception claire et un profond sentiment de sa vrit. Mais il arrive plus souvent encore que les doctrines en conflit, au lieu d'tre l'une vraie et l'autre fausse, se dpartagent la vrit; c'est ainsi que l'opinion non conforme est ncessaire pour fournir le reste de la vrit dont la doctrine reue n'incarne qu'une partie. Les opinions populaires sur les sujets qui ne sont pas la porte des sens sont souvent vraies, mais elles ne sont que rarement ou jamais toute la vrit. Elles sont une partie de la vrit, tantt plus grande, tantt moindre, mais exagre, dforme et coupe des vrits qui devraient l'accompagner et la limiter. De l'autre ct, les opinions hrtiques sont gnralement de ces vrits exclues, ngliges qui, brisant leurs chanes, cherchent soit se rconcilier avec la vrit contenue dans l'opinion commune, soit l'affronter comme ennemie et s'affirment aussi exclusivement comme l'entire vrit. Ce dernier cas a t jusqu' prsent le plus frquent, car l'esprit humain est plus gnralement partial qu'ouvert. De l vient qu'ordinairement, mme dans les rvolutions de l'opinion, une partie de la vrit sombre tandis qu'une autre monte la surface. Le progrs lui-mme, qui devrait tre un gain, se contente le plus
John Stuart Mill (1859), De la libert
37
souvent de substituer une vrit partielle et incomplte une autre. L'amlioration consiste surtout en ceci que le nouveau fragment de vrit est plus ncessaire, mieux adapt au besoin du moment que celui qu'il supplante. La partialit des opinions dominantes est telle que mme lorsqu'elle se fonde sur la vrit, toute opinion qui renferme une once de la portion de vrit omise par l'opinion commune, devrait tre considre comme prcieuse, quelle que soit la somme d'erreur et de confusion mle cette vrit. Aucun juge sens des affaires humaines ne se sentira forc de s'indigner parce que ceux qui mettent le doigt sur des vrits que, sans eux, nous eussions contournes, ne ngligent leur tour certaines que nous apercevons. Il pensera plutt que tant que la vrit populaire sera partiale, il sera encore prfrable qu'une vrit impopulaire ait aussi des dtenteurs partiaux, parce qu'au moins ils sont plus nergiques et plus aptes forcer une attention rtive considrer le fragment de sagesse qu'ils exaltent comme la sagesse tout entire. C'est ainsi qu'au XVIIIe sicle les paradoxes de Rousseau produisirent un choc salutaire lorsqu'ils explosrent au milieu de cette socit de gens instruits et d'incultes sous leur coupe, perdus d'admiration devant ce qu'on appelle la civilisation, devant les merveilles de la science, de la littrature, de la philosophie modernes, n'exagrant la diffrence entre les Anciens et les Modernes que pour y voir leur propre supriorit. Rousseau rendit le service de disloquer la masse de l'opinion partiale et de forcer ses lments se reconstituer sous une meilleure forme et avec des ingrdients supplmentaires. Non pas que les opinions admises fussent dans l'ensemble plus loignes de la vrit que celles de Rousseau; au contraire, elles en taient plus proches ; elles contenaient davantage de vrit positive et bien moins d'erreur. Nanmoins, il y avait dans la doctrine de Rousseau un grand nombre de ces vrits qui manquaient prcisment l'opinion populaire, et qui depuis se sont mles son flux: aussi continurent-elles subsister. Le mrite suprieur de la vie simple, l'effet dbilitant et dmoralisant des entraves et des hypocrisies d'une socit artificielle, sont des ides qui depuis Rousseau n'ont jamais compltement quitt les esprits cultivs ; et elles produiront un jour leur effet, quoique, pour le moment, elles aient encore besoin d'tre proclames haut et fort et d'tre traduites ; car sur ce sujet, les mots ont peuprs puis toutes leurs forces. Paralllement, il est reconnu en politique qu'un parti d'ordre ou de stabilit et un parti de progrs ou de rforme sont les deux lments ncessaires d'une vie politique florissante, jusqu' ce que l'un ou l'autre ait ce point largi son horizon intellectuel qu'il devienne la fois un parti d'ordre et de progrs, connaissant et distinguant ce qu'il est bon de conserver et ce qu'il faut liminer. Chacune de ces manires de penser tire son utilit des dfauts de l'autre ; mais c'est dans une large mesure leur opposition mutuelle qui les maintient dans les limites de la raison et du bon sens. Si l'on ne peut exprimer avec une gale libert, soutenir et dfendre avec autant de talent que d'nergie toutes les grandes questions de la vie pratique - qu'elles soient favorables la dmocratie ou l'aristocratie, la proprit ou l'galit, la coopration ou la comptition, au luxe ou l'abstinence, la sociabilit ou l'individualisme, la libert ou la discipline -, il n'y a aucune raison que les deux lments obtiennent leur d: il est invitable que l'un des plateaux ne monte au dtriment de l'autre. Dans les grandes questions pratiques de la vie, la vrit
John Stuart Mill (1859), De la libert
38
est surtout affaire de conciliation et de combinaison des extrmes ; aussi trs peu d'esprits sont-ils assez vastes et impartiaux pour raliser cet accommodement le plus correctement possible, c'est--dire brutalement, par une lutte entre des combattants enrls sous des bannires opposes. Pour toutes les grandes questions numres cidessus, si une opinion a davantage de droit que l'autre tre, non seulement tolre, mais encore encourage et soutenue, c'est celle qui, a un moment ou dans un lieu donn, se trouve minoritaire. C'est l'opinion qui, pour l'instant, reprsente les intrts ngligs, l'aspect du bien-tre humain qui court le risque d'obtenir moins que sa part. Je suis conscient qu'il n'y a dans ce pays aucune intolrance en matire de diffrences d'opinions sur la plupart de ces sujets. Je les ai cits pour montrer, l'aide d'exemples nombreux et significatifs, l'universalit du fait que, dans l'tat actuel de l'esprit humain, seule la diversit donne une chance quitable toutes les facettes de la vrit. Lorsqu'on trouve des gens qui ne partagent point l'apparente unanimit du monde sur un sujet, il est toujours probable - mme si le monde est dans le vrai - que ces dissidents ont quelque chose de personnel dire qui mrite d'tre entendu, et que la vrit perdrait quelque chose leur silence.
Mais , objectera-t-on, certains des principes gnralement admis, spcialement sur les sujets les plus nobles et les plus vitaux, sont davantage que des demivrits. La morale chrtienne, par exemple, contient toute la vrit sur ce sujet, et si quelqu'un enseigne une morale diffrente, il est compltement dans l'erreur. Comme il s'agit l d'un des cas pratiques les plus importants, aucun n'est mieux appropri pour mettre l'preuve la maxime gnrale. Mais avant de dcider ce que la morale chrtienne est ou n'est pas, il serait souhaitable de dcider ce qu'on entend par morale chrtienne. Si cela signifie la morale du Nouveau Testament, je m'tonne que quelqu'un qui tire son savoir du livre lui-mme puisse supposer que cette morale ait t prsente ou voulue comme une doctrine morale complte. L'vangile se rfre toujours une morale prexistante et limite ses prceptes aux points particuliers sur lesquels cette morale devait tre corrige ou remplace par une autre morale plus tolrante et plus leve; en outre elle s'exprime toujours en termes gnraux, souvent impossibles interprter littralement, sans compter que ces textes possdent davantage l'onction de la posie ou de l'loquence que la prcision de la lgislation. Jamais on n'a pu en extraire un corps de doctrine thique sans le complter par des lments de l'Ancien Testament - systme certes labor, mais barbare bien des gards et destin uniquement un peuple barbare. Saint Paul - ennemi dclar de l'interprtation judaque de la doctrine et de cette faon de complter l'esquisse de son matre admet galement une morale prexistante, savoir celle des Grecs et des Romains; et ce qu'il conseille aux chrtiens dans une large mesure, c'est d'en faire un systme d'accommodement, au point de n'accorder qu'un semblant de condamnation l'esclavage. Ce qu'on appelle la morale chrtienne -mais qu'on devrait plutt qualifier de thologique - n'est luvre ni du Christ ni des aptres ; elle est d'une origine plus tardive, puisqu'elle a t labore graduellement par l'glise chrtienne des cinq premiers sicles; et, mme si les modernes et les protestants ne l'ont pas adopte sans rserve, ils l'ont beaucoup moins modifie qu'on aurait pu s'y attendre. vrai dire, ils
John Stuart Mill (1859), De la libert
39
se sont contents, pour la plupart, de retrancher les additions faites au moyen ge, chaque secte remplissant le vide laiss par de nouvelles additions plus conformes son caractre et ses tendances. Je ne prtends nullement nier que l'humanit soit extrmement redevable envers cette morale et ses premiers matres ; mais je me permets de dire qu'elle est, sur nombre de points importants, incomplte et partiale, et que si des ides et des sentiments qu'elle ne sanctionne pas n'avaient pas contribu la formation du mode de vie et du caractre europens, les affaires humaines seraient actuellement bien pires qu'elles ne le sont. La morale chrtienne, comme on l'appelle, possde toutes les caractristiques d'une raction : c'est en grande partie une protestation contre le paganisme. Son idal est ngatif plus que positif, passif plus qu'actif ; c'est l'innocence plus que la noblesse, l'abstinence du mal plus que la qute nergique du bien; dans ses commandements (comme on l'a justement fait remarquer) le tu ne dois pas prdomine indment sur le tu dois . Dans son horreur de la sensualit, elle a fait de l'asctisme une idole, laquelle est devenue son tour, force de compromis, celle de la lgalit. Elle tient l'espoir du ciel et la crainte de l'enfer pour les motifs convenus et appropries d'une vie vertueuse - ce en quoi elle reste loin derrire certains des plus grands sages de l'Antiquit -, et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour imprimer sur la morale humaine un caractre essentiellement goste, dconnectant pour ainsi dire le sens du devoir prsent en chaque homme des intrts de ses semblables, except lorsqu'on lui suggre un motif intress pour les consulter. C'est essentiellement une doctrine d'obissance passive; elle inculque la soumission toutes les autorits tablies - lesquelles ne sont d'ailleurs pas activement obies lorsqu'elles commandent ce que la religion interdit, mais cela sans qu'il soit pour autant possible de leur rsister ou de se rvolter contre elles, quel que soit le tort qu'elles nous fassent. Et, alors que dans la morale des grandes nations paennes, le devoir du citoyen envers l'tat tient une place disproportionne et empite sur la libert individuelle, cette grande part de notre devoir est peine mentionne ou reconnue dans la morale chrtienne. C'est dans le Coran, non dans le Nouveau Testament, que nous trouvons cette maxime : Tout gouvernant qui dsigne un homme un poste quand il existe dans ses territoires un autre homme mieux qualifi pour celui-ci pche contre Dieu et contre l'tat. Le peu de reconnaissance que reoit l'ide d'obligation envers le public dans la morale moderne ne nous vient mme pas des chrtiens, mais des Grecs et des Romains. De mme, ce qu'il y a dans la morale prive de magnanimit, de grandeur d'me, de dignit personnelle, voire de sens de l'honneur, ne nous vient pas du versant religieux, mais du versant purement humain de notre ducation ; et jamais ces qualits n'auraient pu tre le fruit d'une doctrine morale qui n'accorde de valeur qu' l'obissance. Je suis bien loin de prtendre que ces dfauts sont ncessairement inhrents la morale chrtienne de quelque manire qu'on la conoive, ou bien que tout ce qui lui manque pour devenir une doctrine morale complte ne saurait se concilier avec elle; et je l'insinue encore bien moins des doctrines et des prceptes du Christ lui-mme. Je crois que les paroles du Christ sont devenues, l'vidence, tout ce qu'elles ont voulu tre, qu'elles ne sont inconciliables avec rien de ce qu'exige une morale complte, qu'on peut y faire entrer tout ce qu'il y a d'excellent en morale, et cela sans faire
John Stuart Mill (1859), De la libert
40
davantage de violence leur lettre que tous ceux qui ont tent d'en dduire un quelconque systme pratique de conduite. Mais je crois par ailleurs que cela n'entre nullement en contradiction avec le fait de croire qu'elles ne contiennent et ne voulaient contenir qu'une partie de la vrit. Je crois que dans ses instructions, le fondateur du christianisme a nglig dessein beaucoup d'lments essentiels de haute morale, que l'glise chrtienne, elle, a compltement rejets dans le systme moral qu'elle a rig sur la base de cet enseignement. Cela tant, je considre comme une grande erreur le fait de vouloir toute force trouver dans la doctrine chrtienne cette rgle complte de conduite que son auteur n'entendait pas dtailler tout entire, mais seulement sanctionner et mettre en vigueur. Je crois aussi que cette thorie est en train de causer grand tort dans la pratique, en diminuant beaucoup la valeur de l'ducation et de l'instruction morales que tant de personnes bien intentionnes s'efforcent enfin d'encourager. Je crains fort qu'en essayant de former l'esprit et les sentiments sur un modle exclusivement religieux, et en vacuant ces normes sculires (comme on les appelle faute d'un meilleur terme) qui coexistaient jusqu'ici avec la morale chrtienne et la compltaient, mlant leur esprit au sien, il n'en rsulte - comme c'est le cas de plus en plus - un type de caractre bas, abject, servile, qui se soumet comme il peut ce qu'il prend pour la Volont suprme, mais qui est incapable de s'lever la conception de la Bont suprme ou de s'y ouvrir. Je crois que des morales diffrentes d'une morale exclusivement issue de sources chrtiennes doivent exister paralllement elle pour produire la rgnration morale de l'humanit; et, selon moi, le systme chrtien ne fait pas exception cette rgle selon laquelle, dans un tat imparfait de l'esprit humain, les intrts de la vrit exigent la diversit d'opinions. Il n'est pas dit qu'en cessant d'ignorer les vrits morales qui ne sont pas contenues dans le christianisme, les hommes doivent se mettre ignorer aucune de celles qu'il contient. Un tel prjug, une telle erreur, quand elle se produit, est un mal absolu; mais c'est aussi un mal dont on ne peut esprer tre toujours exempts, et qui doit tre considr comme le prix payer pour un bien inestimable. Il faut s'lever contre la prtention exclusive d'une partie de la vrit d'tre la vrit tout entire ; et si un mouvement de raction devait rendre ces rebelles injustes leur tour, cette partialit serait dplorable au mme titre que l'autre, mais devrait pourtant tre tolre. Si les chrtiens voulaient apprendre aux infidles tre justes envers le christianisme, il leur faudrait tre justes eux-mmes envers leurs croyances. C'est mal servir la vrit que de passer sous silence ce fait - bien connu de tous ceux qui ont la moindre notion d'histoire littraire -qu'une grande part des enseignements moraux les plus nobles et les plus estimables sont luvre d'hommes qui non seulement ne connaissaient pas la foi chrtienne, mais encore la rejetaient en toute connaissance de cause. Je ne prtends pas que l'usage le plus illimit de la libert d'noncer toutes les opinions possibles mettrait fin au sectarisme religieux ou philosophique. Toutes les fois que des hommes de faible stature intellectuelle prennent une vrit au srieux, ils se mettent aussitt la proclamer, la transmettre, et mme agir d'aprs elle, comme s'il n'y avait pas au monde d'autre vrit, ou du moins aucune autre susceptible de la limiter ou de la modifier. Je reconnais que la plus libre discussion ne saurait empcher le sectarisme en matire d'opinions, et que souvent, au contraire, c'est elle qui
John Stuart Mill (1859), De la libert
41
l'accrot et l'exaspre ; car on repousse la vrit d'autant plus violemment qu'on a manqu l'apercevoir jusque-l et qu'elle est proclame par des gens en qui l'on voit des adversaires. Ce n'est pas sur le partisan passionn, mais sur le spectateur calme et dsintress que cette confrontation d'opinions produit un effet salutaire. Ce n'est pas la lutte violente entre les parties de la vrit qu'il faut redouter, mais la suppression silencieuse d'une partie de la vrit; il y a toujours de l'espoir tant que les hommes sont contraints couter les deux cts ; c'est lorsqu'ils ne se proccupent que d'un seul que leurs erreurs s'enracinent pour devenir des prjugs, et que la vrit, caricature, cesse d'avoir les effets de la vrit. Et puisque rien chez un juge n'est plus rare que la facult de rendre un jugement sens sur une cause o il n'a entendu plaider qu'un seul avocat, la vrit n'a de chance de se faire jour que dans la mesure o chacune de ses facettes, chacune des opinions incarnant une fraction de vrit, trouve des avocats et les moyens de se faire entendre. Nous avons maintenant affirm la ncessit - pour le bien-tre intellectuel de l'humanit (dont dpend son bien-tre gnral) - de la libert de pense et d'expression l'aide de quatre raisons distinctes que nous allons rcapituler ici. Premirement, une opinion qu'on rduirait au silence peut trs bien tre vraie : le nier, c'est affirmer sa propre infaillibilit. Deuximement, mme si l'opinion rduite au silence est fausse, elle peut contenir - ce qui arrive trs souvent - une part de vrit; et puisque l'opinion gnrale ou dominante sur n'importe quel sujet n'est que rarement ou jamais toute la vrit, ce n'est que par la confrontation des opinions adverses qu'on a une chance de dcouvrir le reste de la vrit. Troisimement, si l'opinion reue est non seulement vraie, mais toute la vrit, on la professera comme une sorte de prjug, sans comprendre ou sentir ses principes rationnels, si elle ne peut tre discute vigoureusement et loyalement. Et cela n'est pas tout Car, quatrimement, le sens de la doctrine elle-mme sera en danger d'tre perdu, affaibli ou priv de son effet vital sur le caractre et la conduite: le dogme deviendra une simple profession formelle, inefficace au bien, mais encombrant le terrain et empchant la naissance de toute conviction authentique et sincre fonde sur la raison ou l'exprience personnelle. Avant de clore ce sujet de la libert d'opinion, il convient de se tourner un instant vers ceux qui disent qu'on peut permettre d'exprimer librement toute opinion, pourvu qu'on le fasse avec mesure, et qu'on ne dpasse pas les bornes de la discussion loyale. On pourrait en dire long sur l'impossibilit de fixer avec certitude ces bornes supposes; car si le critre est le degr d'offense prouv par ceux dont les opinions sont attaques, l'exprience me parat dmontrer que l'offense existe ds que l'attaque est loquente et puissante: ils accuseront donc de manquer de modration tout adversaire qui les mettra dans l'embarras. Mais bien que cette considration soit importante sur
John Stuart Mill (1859), De la libert
42
le plan pratique, elle disparat devant une objection plus fondamentale. Certes, la manire de dfendre une opinion, mme vraie, peut tre blmable et encourir une censure svre et lgitime. Mais la plupart des offenses de ce genre sont telles qu'elles sont le plus souvent impossibles prouver, sauf si le responsable en vient l'avouer accidentellement. La plus grave de ces offenses est le sophisme, la suppression de certains faits ou arguments, la dformation des lments du cas en question ou la dnaturation de l'opinion adverse. Pourtant tout cela est fait continuellement - mme outrance - en toute bonne foi par des personnes qui ne mritent par ailleurs pas d'tre considres comme ignorantes ou incomptentes, au point qu'on trouve rarement les raisons adquates d'accuser un expos fallacieux d'immoralit ; la loi elle-mme peut encore moins prtendre interfrer dans ce genre d'inconduite controverse. Quant ce que l'on entend communment par le manque de retenue en discussion, savoir les invectives, les sarcasmes, les attaques personnelles, etc., la dnonciation de ces armes mriterait plus de sympathie si l'on proposait un jour de les interdire galement des deux cts ; mais ce qu'on souhaite, c'est uniquement en restreindre l'emploi au profit de l'opinion dominante. Qu'un homme les emploie contre les opinions minoritaires, et il est sr non seulement de n'tre pas blm, mais d'tre lou pour son zle honnte et sa juste indignation. Cependant, le tort que peuvent causer ces procds n'est jamais si grand que lorsqu'on les emploie contre les plus faibles, et les avantages dloyaux qu'une opinion peut tirer de ce type d'argumentation choient presque exclusivement aux opinions reues. La pire offense de cette espce qu'on puisse commettre dans une polmique est de stigmatiser comme des hommes dangereux et immoraux les partisans de l'opinion adverse. Ceux qui professent des opinions impopulaires sont particulirement exposs de telles calomnies, et cela parce qu'ils sont en gnral peu nombreux et sans influence, et que personne ne s'intresse leur voir rendre justice. Mais tant donn la situation, cette arme est refuse ceux qui attaquent l'opinion dominante ; ils courraient un danger personnel s'en servir, et s'ils s'en servaient malgr tout, ils ne russiraient qu' exposer par contrecoup leur propre cause. En gnral, les opinions contraires celles communment reues ne parviennent se faire entendre qu'en modrant scrupuleusement leur langage et en mettant le plus grand soin viter toute offense inutile: elles ne sauraient dvier d'un pouce de cette ligne de conduite sans perdre de terrain. En revanche, de la part de l'opinion dominante, les injures les plus outres finissent toujours par dissuader les gens de professer une opinion contraire, voire mme d'couter ceux qui la professent. C'est pourquoi dans l'intrt de la vrit et de la justice, il est bien plus important de rfrner l'usage du langage injurieux dans ce cas prcis que dans le premier; et par exemple, s'il fallait choisir, il serait bien plus ncessaire de dcourager les attaques injurieuses contre l'incroyance que contre la religion. Il est vident toutefois que ni la loi ni l'autorit n'ont se mler de rprimer l'une ou l'autre, et que le jugement de l'opinion devrait tre dtermin, dans chaque occasion, par les circonstances du cas particulier. D'un ct ou de l'autre, on doit condamner tout homme dans la plaidoirie duquel percerait la mauvaise foi, la malveillance, la bigoterie ou encore l'intolrance, mais cela sans infrer ses vices du parti qu'il prend, mme s'il s'agit du parti adverse. Il faut rendre chacun l'honneur qu'il mrite, quelle que soit son opinion, s'il possde assez de calme et d'honntet
John Stuart Mill (1859), De la libert
43
pour voir et exposer - sans rien exagrer pour les discrditer, sans rien dissimuler de ce qui peut leur tre favorable - ce que sont ses adversaires et leurs opinions. Telle est la vraie moralit de la discussion publique ; et, si elle est souvent viole, je suis heureux de penser qu'il y a de nombreux polmistes qui en tudient de trs prs les raisons, et un plus grand nombre encore qui s'efforce de la respecter.
John Stuart Mill (1859), De la libert
44
Chapitre III
De l'individualit comme l'un des lments du bien-tre
Retour la table des matires
On vient de voir les raisons pour lesquelles il est impratif de laisser les hommes libres de former leurs opinions et de les exprimer sans rserve ; on a vu galement que si cette libert n'est pas accorde, ou du moins revendique, en dpit de l'interdiction, les consquences en sont funestes pour l'intelligence et la nature morale de l'homme. Examinons prsent si ce ne sont pas les mmes raisons qui exigent que les hommes soient libres d'agir selon leurs opinions - c'est--dire libres de les appliquer leur vie sans que leurs semblables les en empchent physiquement ou moralement, tant que leur libert ne s'exerce qu' leurs seuls risques et prils. Cette dernire condition est naturellement indispensable. Personne ne soutient que les actions doivent tre aussi libres que les opinions. Au contraire, mme les opinons perdent leur immunit lorsqu'on les exprime dans des circonstances telles que leur expression devient une instigation manifeste quelque mfait. L'ide que ce sont les marchands de bl qui affament les pauvres ou que la proprit prive est un vol ne devrait pas tre inquite tant qu'elle ne fait que circuler dans la presse ; mais elle peut encourir une juste
John Stuart Mill (1859), De la libert
45
punition si on l'exprime oralement, au milieu d'un rassemblement de furieux attroups devant la porte d'un marchand de bl, ou si on la rpand dans ce mme rassemblement sous forme de placard. Les actes de toute nature qui sans cause justifiable nuisent autrui peuvent tre contrls - et dans les cas les plus graves, ils le doivent par la rprobation et, si ncessaire, par une intervention active des gens. La libert de l'individu doit tre contenue dans cette limite: il ne doit pas nuire autrui. Et ds lors qu'il s'abstient d'importuner les autres et qu'il se contente d'agir suivant son inclination et son jugement dans ce qui ne concerne que lui, les mmes raisons qui montrent que l'opinion doit tre libre prouvent galement qu'on devrait pouvoir, sans vexations, mettre son opinion en pratique ses propres dpens. Que les hommes ne soient pas infaillibles, que ses vrits ne soient, pour la plupart, que des demi-vrits, que l'unit d'opinions ne soit pas souhaitable si elle ne rsulte pas de la comparaison la plus libre et la plus totale des opinions contraires, et enfin que la diversit d'opinions ne soit pas un mal mais un bien tant que l'humanit n'est pas mieux mme de reconnatre toutes les facettes de la vrit : voil des principes applicables tant la manire d'agir des hommes qu' leurs opinions. De mme qu'il est utile, tant que l'humanit est imparfaite, qu'il y ait des opinions diffrentes, il est bon qu'il y ait diffrentes faons de vivre et que toute latitude soit donne aux divers caractres, tant qu'ils ne nuisent pas aux autres, et qu'il est donn chacun d'prouver la valeur des diffrents genres de vie. Bref, il est souhaitable que l'individualit puisse s'affirmer dans tout ce qui ne touche pas directement les autres. Si ce n'est pas le caractre propre de la personne, mais les traditions et les murs des autres qui dictent les rgles de conduite, c'est qu'il manque l'un des principaux ingrdients du bonheur humain, et en tout cas l'ingrdient le plus essentiel du progrs individuel ou social. Lorsqu'on soutient ce principe, Ia plus grande difficult ne rside pas tant dans l'apprciation des moyens qui conduisent un but reconnu que dans l'indiffrence gnrale des gens envers le but lui-mme. Si l'on considrait le libre dveloppement de l'individualit comme l'un des principes essentiels du bien-tre, si on le voyait non pas comme accessoire coordonn tout ce qu'on dsigne par civilisation, instruction, ducation, culture, mais comme un lment et une condition ncessaires de toutes ces choses, il n'y aurait pas de danger que la libert ft sous-estime, et il n'y aurait pas de difficult extraordinaire tracer la frontire entre elle et le contrle social. Mais malheureusement, les modes de pense habituels ne reconnaissent que rarement une valeur intrinsque ou un mrite spcifique la spontanit individuelle. La majorit, satisfaite des coutumes habituelles de l'humanit (parce que c'est elle qui les a faites ce qu'elles sont), ne voit pas pourquoi ces coutumes ne satisferaient pas tout le monde. Plus encore, la spontanit n'entre pas dans l'idal de la plupart des rformateurs moraux et sociaux: on la considre avec jalousie, comme un obstacle gnant, voire rebelle l'acceptation gnrale de ce qu'ils jugent tre le mieux pour l'humanit. Rares sont ceux qui, en dehors de l'Allemagne, comprennent cette doctrine l'origine du trait de l'minent savant et politicien Wilhelm von Humboldt: La fin de l'homme, non pas telle que la suggrent de vagues et fugitifs dsirs, mais telle que la prescrivent les dcrets ternels ou immuables de la raison, est le dveloppement le plus large et le plus harmonieux de toutes ses facults en un tout complet et cohrent ; de
John Stuart Mill (1859), De la libert
46
sorte que l'objet vers lequel doit tendre constamment tout tre humain, et en particulier ceux qui ont l'ambition d'influencer leurs semblables, est l'individualit de la puissance et du dveloppement. Il y a pour cela deux conditions remplir: la libert et la varit des situations , de l'union desquelles naissent la vigueur individuelle et la diversit , lesquelles fusionnent enfin dans l'originalit 1 . Cependant, si neuve et si surprenante que puisse paratre une doctrine telle que celle de Humboldt qui attache tant de prix l'individualit, il faut nanmoins pouvoir l'valuer. Personne n'estime que la perfection en matire de conduite humaine consiste se copier tout simplement les uns les autres. Personne n'estime non plus que le jugement ou le caractre particulier d'un homme ne doit compter pour rien dans sa manire de vivre et de soigner ses intrts. D'un autre ct, il serait absurde de prtendre que les hommes doivent vivre comme si on ne connaissait rien dans le monde avant leur naissance, comme si jamais encore l'exprience n'avait montr que certaines faons de vivre taient prfrables d'autres. Nul ne conteste qu'on doive lever et instruire la jeunesse de faon lui faire profiter des acquis de l'exprience humaine. Mais c'est l le privilge et la condition propre d'un tre humain dans la maturit de ses facults que de se servir de l'exprience et de l'interprter sa faon. C'est lui de dcouvrir ce qui, dans l'exprience transmise, est applicable sa situation et son caractre. Les traditions et les coutumes des autres sont, jusqu' un certain point, des tmoignages de ce que leur exprience leur a appris, et elles justifient une prsomption qui, comme telle, est digne de respect. Mais il se peut en premier lieu que l'exprience des autres soit trop troite, ou qu'il l'ait mal interprte; il se peut deuximement que leur interprtation soit juste sans toutefois convenir un individu particulier. Les coutumes sont faites pour les vies et les caractres ordinaires ; mais un individu peut avoir une vie et un caractre extraordinaires. Troisimement, mme si les coutumes sont la fois bonnes en soi et adaptes l'individu, il se peut que se conformer la coutume uniquement en tant que telle n'entretienne ni ne dveloppe en lui aucune des qualits qui sont l'attribut distinctif d'un tre humain. Les facults humaines de la perception, du jugement, du discernement, de l'activit intellectuelle, et mme la prfrence morale, ne s'exercent qu'en faisant un choix. Celui qui n'agit jamais que suivant la coutume ne fait pas de choix. Il n'apprend nullement discerner ou dsirer ce qui vaut mieux. La force intellectuelle et la force morale, tout comme la force physique, ne s'amliorent qu'avec l'exercice. On n'exerce pas ses facults en faisant ou en croyant une chose simplement parce que d'autres la font ou qu'ils y croient. Si une personne adopte une opinion sans que les principes de celle-ci lui paraissent concluants, sa raison n'en sortira pas renforce, mais probablement affaiblie ; et si elle fait une action (qui n'affecte ni les affections ni les droits d'autrui) dont les motifs ne sont pas conformes ses opinions et son caractre, ceux-ci tomberont dans l'inertie et la torpeur au lieu d'tre stimuls. Celui qui laisse le monde, ou du moins son entourage, tracer pour lui le plan de sa vie, n'a besoin que de la facult d'imitation des singes. Celui qui choisit lui-mme sa
1
De la sphre et des devoirs du Gouvernement, par le baron Wilhelm von Humboldt.
John Stuart Mill (1859), De la libert
47
faon de vivre utilise toutes ses facults : l'observation pour voir, le raisonnement et le jugement pour prvoir, l'activit pour recueillir les matriaux en vue d'une dcision, le discernement pour dcider et, quand il a dcid, la fermet et la matrise de soi pour s'en tenir sa dcision dlibre. Il lui faut avoir et exercer ces qualits dans l'exacte mesure o il dtermine sa conduite par son jugement et ses sentiments personnels. Il est possible qu'il soit sur une bonne voie et prserv de toute influence nuisible sans aucune de ces choses. Mais quelle sera sa valeur relative en tant qu'tre humain ? Ce qui importe rellement, ce n'est pas seulement ce que font les hommes, mais le genre d'homme qu'ils sont en le faisant. Parmi les uvres de l'homme que la vie s'ingnie perfectionner et embellir, la plus importante est srement l'homme lui-mme. A supposer que ce soit des machines - des automates d'apparence humaine - qui construisent les maisons, cultivent le bl, se battent la guerre, jugent les causes, lvent des glises et disent les prires, ce serait encore une perte considrable d'changer ces automates contre les hommes et les femmes qui peuplent aujourd'hui les parties les plus civilises du monde, car ils ne sont que de tristes chantillons de ce que la nature peut et veut produire. La nature humaine n'est pas une machine qui se construit d'aprs un modle et qui se programme pour faire exactement le travail qu'on lui prescrit, c'est un arbre qui doit crotre et se dvelopper de tous cts, selon la tendance des forces intrieures qui en font un tre vivant. On concdera probablement qu'il est prfrable que les hommes cultivent leur intelligence et qu'il vaut mieux suivre intelligemment la coutume - quitte dvier l'occasion - que de s'y conformer aveuglment et mcaniquement. Jusqu' un certain point, il est admis que notre intelligence doit nous appartenir; mais on n'admet pas aussi volontiers qu'il doit en tre de mme pour nos dsirs et nos impulsions, et qu'en possder de forts puisse tre autre chose qu'un pril et un pige. Et pourtant, dsirs et impulsions font partie de la perfection de l'tre humain, au mme titre que les croyances et les contraintes ; et de fortes impulsions ne sont dangereuses que lorsqu'elles sont mal quilibres: lorsqu'un ensemble de buts et d'inclinations s'est fortement dvelopp au dtriment d'autres avec qui il aurait d coexister. Ce n'est pas parce que les dsirs des hommes sont forts qu'ils agissent mal, mais parce que leurs consciences sont faibles. Il n'y a pas de lien naturel entre des impulsions fortes et une conscience faible : le lien naturel s'tablit en sens inverse. Dire que les dsirs et les sentiments d'une personne sont plus forts et plus varis que ceux d'une autre, c'est dire simplement qu'il y a en elle davantage de matire brute de la nature humaine; ce qui signifie que si elle est capable de plus de mal, elle est aussi capable de plus de bien. De fortes impulsions, c'est simplement une autre faon de nommer l'nergie. L'nergie a beau pouvoir tre employe de mauvaises fins, on tirera toujours davantage d'une nature nergique que d'une nature indolente et apathique. Ceux qui ont le plus de sensibilit naturelle sont aussi ceux qui peuvent dvelopper les sentiments les plus cultivs. Cette ardente sensibilit qui rend les impulsions personnelles vives et puissantes peut aussi bien engendrer l'amour le plus passionn de la vertu que la matrise de soi la plus svre. C'est en cultivant ces deux tendances que la socit fait son devoir et protge ses intrts, et non en rejetant l'toffe qui fait les hros, parce qu'elle n'en fabrique justement pas. On dit d'une personne qu'elle a du caractre lorsqu'elle a des
John Stuart Mill (1859), De la libert
48
dsirs et des impulsions personnels qui sont l'expression de sa propre nature telle que l'a dveloppe et modifie sa propre culture. Celui qui n'a ni dsirs ni impulsions personnels n'a pas davantage de caractre qu'une machine vapeur. Si un individu a des impulsions non seulement personnelles, mais fortes et domines par une volont puissante, il a ce qu'on appelle un caractre nergique. Penser qu'il ne faut pas encourager le dveloppement de l'individualit en matire de dsirs et d'impulsions, c'est soutenir que la socit n'a nul besoin de natures fortes - qu'elle ne s'en trouve pas mieux pour contenir un grand nombre de personnes de caractre - et qu'il n'est pas souhaitable de voir la moyenne des hommes possder trop d'nergie. Dans les socits naissantes, ces nergies taient peut-tre trop dveloppes, et la socit n'avait pas le pouvoir de les discipliner et de les contrler. C'tait un temps o l'lment de spontanit et d'individualit dominait l'excs, et o le principe social avait lui livrer de rudes combats. La difficult tait alors d'amener les hommes puissants de corps ou d'esprit obir des rgles qui prtendaient contrler leurs impulsions. Pour vaincre cette difficult, la loi et la discipline, l'instar des papes dans leur lutte contre les empereurs, proclamrent leur pouvoir sur l'homme tout entier, revendiquant le droit de contrler sa vie tout entire afin de pouvoir contrler aussi son caractre, que la socit n'tait pas parvenue contenir jusque-l. Mais, aujourd'hui, alors que la socit a largement raison de l'individu, le danger qui guette la nature humaine n'est plus l'excs, mais la dficience des impulsions et des inclinations. Les choses ont bien chang depuis que les passions des puissants, forts de leur position ou de leurs talents personnels, taient en rbellion constante contre les lois et les rglements et devaient tre troitement brides pour que leur voisinage pt jouir de quelque scurit. A notre poque, de la classe la plus haute la plus basse, tout le monde vit sous le regard d'une censure hostile et redoute. Non seulement en ce qui concerne les autres, mais en ce que ne concerne qu'eux-mmes, jamais les individus et les familles ne se demandent : Qu'est-ce que je prfre ? Qu'est-ce qui conviendrait mon caractre et mes dispositions ? Qu'est-ce qui permettrait ce qu'il y a de plus lev et de meilleur en moi d'avoir libre jeu, de se dvelopper et de prosprer ? Mais au contraire, ils se demandent: Qu'est-ce qui convient ma situation ? ou Que font ordinairement les personnes de ma position et de ma fortune ? ou pire encore Que font ordinairement les personnes d'une position et d'une fortune suprieures la mienne ? Je ne veux pas dire qu'ils prfrent l'usage leurs inclinations, car jamais il ne leur vient l'ide qu'ils puissent avoir d'aspirations autres que la coutume. Ainsi l'esprit lui-mme plie sous le joug, et mme dans ce que les gens font pour leur plaisir, leur premire pense va la conformit: ils aiment en masse; ils ne portent leur choix que sur les choses qu'on fait en gnral ; ils vitent comme un crime toute singularit de got, toute excentricit de conduite, si bien qu' force de ne pas suivre leur naturel, ils n'ont plus de naturel suivre. Leurs capacits humaines sont atrophies et inertes ; ils deviennent incapables du moindre dsir vif, du moindre plaisir spontan; ils n'ont gnralement ni opinions ni sentiments de leur cru, ou vraiment leurs. Maintenant, est-ce l la condition idale de la. nature humaine ?
John Stuart Mill (1859), De la libert
49
Oui, si l'on en croit la thorie calviniste. Selon elle, le plus grand pch de l'homme, c'est d'avoir une volont propre. Tout le bien dont l'humanit est capable tient dans l'obissance. Vous n'avez pas le choix; vous devez agir ainsi et non autrement: Tout ce qui n'est pas un devoir est pch. La nature humaine tant compltement corrompue, il n'y a de rachat pour quiconque n'a pas tu en lui la nature humaine. Pour celui qui accepte semblable thorie, ce n'est pas un mal que de rprimer toutes les facults, toutes les capacits et tous les sentiments humains: l'homme n'a besoin d'aucune aptitude si ce n'est celle de s'abandonner la volont de Dieu; et s'il se sert de ses facults dans un but autre que d'accomplir cette volont plus efficacement, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne les possde pas. Voil la thorie du calvinisme, et nombre de ceux qui ne se considrent pas calvinistes la professent sous une autre forme plus modre; l'adoucissement consiste donner une interprtation moins asctique de la volont suppose de Dieu, en affirmant qu'il veut que les hommes satisfassent certaines de leurs inclinations, non pas leur manire, mais par l'obissance, c'est--dire d'une certaine manire prescrite par l'autorit, et qui doit tre la mme pour tous. Sous l'une ou l'autre de ces formes, on tend maintenant fortement vers cette thorie troite de la vie, et vers ce type de caractre humain triqu et born qu'elle favorise. Sans aucun doute, nombreux sont ceux qui croient sincrement que les hommes ainsi torturs et rabougris sont tels que les a voulus leur crateur, tout comme beaucoup croient que les arbres sont bien plus beaux taills en boule ou en formes d'animaux que laisss dans leur tat naturel. Mais si cela fait partie de la religion de croire que l'homme a t cr par un tre bon, il est alors plus logique de croire que cet tre a donn l'homme ses facults pour qu'il les cultive et les dveloppe, et non pour qu'elles soient extirpes et rduites nant, et qu'Il se rjouit chaque fois que ses cratures font un pas vers l'idal qu'elles portent en elles, qu'elles accroissent une de leurs facults, de comprhension, d'action ou de jouissance. Il existe un modle d'excellence humaine bien diffrent du calvinisme, savoir que l'humanit n'a pas reu sa nature seulement pour en faire l'abngation. L'affirmation paenne de soi est un des lments de la valeur humaine, au mme titre que l'abngation chrtienne de soi 1 . Il y a un idal grec de dveloppement personnel, auquel se mle, sans s'y substituer, l'idal platonicien et chrtien de matrise de soi. Peut-tre vaut-il mieux tre un John Knox qu'un Alcibiade, mais mieux vaut encore tre un Pricls ; et s'il existait un Pricls aujourd'hui, aucune des bonnes qualits de John Knox ne lui ferait sans doute dfaut. Ce n'est pas en noyant dans l'uniformit tout ce qu'il y a d'individuel chez les hommes, mais en le cultivant et en le dveloppant dans les limites imposes par les droits et les intrts d'autrui, qu'ils deviennent un noble et bel objet de contemplation; et de mme que luvre prend le caractre de son auteur, de mme la vie humaine devient riche, diversifie, anime, apte nourrir plus abondamment les nobles penses et les sentiments levs ; elle renforce le lien entre les individus et l'espce, en
1
Sterling: Essais.
John Stuart Mill (1859), De la libert
50
accroissant infiniment la valeur de leur appartenance a celle-ci. mesure que se dveloppe son individualit, chacun acquiert plus de valeur ses propres yeux et devient par consquent mieux mme d'en acqurir davantage aux yeux des autres. On atteint alors une plus grande plnitude dans son existence, et lorsqu'il y a davantage de vie dans les units, il y en a galement davantage dans la masse qu'elles composent. On ne peut pas se dispenser de comprimer les spcimens les plus vigoureux de la nature humaine autant que ncessaire pour les empcher d'empiter sur les droits des autres ; mais a cela, on trouve ample compensation, mme du point de vue du dveloppement humain. Les moyens de dveloppement que l'individu perd par l'interdiction de satisfaire des penchants nuisibles aux autres s'obtiennent surtout aux dpens du dveloppement d'autrui. Et lui-mme y trouve une compensation, car la contrainte impose son gosme autorise du mme coup le meilleur dveloppement possible de l'aspect social de sa nature. tre astreint pour le bien des autres aux strictes rgles de la justice dveloppe les sentiments et les facults qui ont pour objet le bien des autres. Mais d'tre ainsi contraint par le seul dplaisir des autres ne pas commettre d'actions susceptibles de leur nuire ne dveloppe par ailleurs rien de bon, sinon une force de caractre qui se manifestera peut-tre par une rsistance la contrainte. Si l'on se soumet, c'est une contrainte qui mousse et ternit le caractre. Pour donner une chance quitable la nature de chacun, il faut que diffrentes personnes puissent mener diffrents genres de vie. Les poques o une telle latitude a t laisse sont celles qui se signalent le plus l'attention de la postrit. Le despotisme lui-mme ne produit pas ses pires effets tant qu'il laisse subsister l'individualit ; et tout ce qui opprime l'individualit est un despotisme, quel que soit le nom qu'on lui donne, qu'il prtende imposer la volont de Dieu ou les injonctions des hommes. Aprs avoir identifi individualit et dveloppement et dmontr que seul l'entretien de l'individualit produit et peut produire des tres humains bien dvelopps, je pourrais clore ici mon argumentation; en effet, que dire de plus ou de mieux en faveur d'un certain tat des affaires humaines, si ce n'est qu'il rapproche de la perfection laquelle les hommes peuvent aspirer. Ou alors, que dire de pire d'un obstacle au bien, si ce n'est qu'il empche ce progrs ? Il se peut cependant que ces considrations ne suffisent point convaincre ceux qui ont le plus besoin d'tre convaincus; aussi est-il ncessaire de montrer en outre que ces tres humains dvelopps peuvent tre de quelque utilit aux non-dvelopps. Il faut montrer ceux qui ne souhaitent pas la libert et qui n'en auraient pas l'usage qu'ils peuvent tre rcompenss de permettre aux autres d'en user sans entrave. Tout d'abord, j'aimerais suggrer qu'il est possible pour eux d'apprendre quelque chose des hommes qui gotent cette libert. Personne ne niera que l'originalit ne soit un lment prcieux dans les affaires humaines. On a toujours besoin de gens non seulement pour dcouvrir des vrits nouvelles et signaler le moment o ce qui fut autrefois une vrit cesse de l'tre, mais encore pour initier des pratiques nouvelles et donner l'exemple d'une conduite plus claire, montrant davantage de got et de bon sens dans les affaires humaines. Ceci ne saurait tre contredit par quiconque ne croit pas que le monde ait dj atteint la perfection dans toutes ses coutumes et pratiques.
John Stuart Mill (1859), De la libert
51
Il est vrai que n'importe qui peut rendre ce service, mais rares sont ceux dans l'espce humaine dont les expriences seraient un progrs sur l'usage tabli si les autres les adoptaient. Mais ces rares personnes sont le sel de la terre ; sans elles, la vie humaine deviendrait une mare stagnante. Car non seulement ce sont elles qui introduisent les bonnes choses inconnues jusque-l, mais ce sont elles encore qui gardent en vie celles qui existent dj. S'il n'y avait plus rien de nouveau faire, l'intelligence humaine cesserait-elle pour autant d'tre ncessaire ? Serait-ce une raison pour ceux qui pratiquent des coutumes anciennes d'oublier pourquoi ils les pratiquent ou de les pratiquer comme du btail, et non comme des tres humains ? Il y a dans les croyances et les pratiques les meilleures une trop grande tendance dgnrer en action mcanique ; et, sans cette succession de personnes dont l'originalit perptuellement renouvele entretient la vie de ces croyances et de ces pratiques, une telle matire morte ne rsisterait gure au choc caus par une matire rellement vivante; aussi n'y aurait-il alors aucune raison pour que la civilisation ne prisse pas, comme ce fut le cas de l'Empire byzantin. la vrit, les hommes de gnie sont et demeureront probablement toujours une faible minorit; mais pour qu'il y en ait, encore faut-il entretenir le terreau dans lequel ils croissent. Le gnie ne peut respirer librement que dans une atmosphre de libert. Les hommes de gnie sont, ex vi termini, plus individuels que les autres, et donc moins capables de se couler, sans que cette compression ne leur soit dommageable, dans les quelques moules que la socit fournit ses membres pour leur viter la peine de se former un caractre. Si, par timidit, les hommes de gnie se rsignent entrer dans un de ces moules, et laisser s'atrophier cette partie d'eux-mmes qui ne peut s'panouir sous une telle pression, la socit ne profitera gure de leur gnie. Si en revanche, ils sont dous d'une grand force de caractre et brisent leurs chanes, ils deviennent une cible pour la socit qui, parce qu'elle n'a pas russi les rduire au lieu commun, se met alors les montrer du doigt et les traiter de sauvages , de fous ou autres qualificatifs de ce genre - un peu comme si on se plaignait que le Niagara n'ait pas le flot paisible d'un canal hollandais. Si j'insiste avec autant de force sur l'importance du gnie et sur la ncessit de le laisser se dvelopper librement, tant en pense que dans la vie, c'est que, bien que je sache que nul ne refuse cette position en thorie, je sais aussi que le monde y est en ralit totalement indiffrent. Les gens pensent que le gnie est une belle chose si elle permet un homme d'crire un pome mouvant ou de peindre un tableau. Mais bien que le gnie, dans son sens vrai d'originalit de pense et d'action, soit pour les hommes un objet d'admiration, ils n'en pensent pas moins dans leur for intrieur qu'on peut trs bien s'en passer. Malheureusement, cette attitude est trop naturelle pour qu'on puisse s'en tonner. S'il y a une chose dont les esprits peu originaux ne ressentent aucun besoin, c'est bien de l'originalit. Ils sont incapables de voir quoi elle pourrait leur servir; et d'ailleurs, comment le pourraient-ils ? S'ils le pouvaient, ils ne manqueraient pas d'originalit. Le premier service que l'originalit doive leur rendre, c'est de leur ouvrir les yeux; aprs quoi, seulement, ils auraient quelque chance de devenir eux-mmes originaux. Mais en attendant, qu'ils se souviennent que rien n'a jamais t fait sans que quelqu'un le fasse en premier, et que toutes les bonnes choses qui existent sont le fruit de l'originalit ; et qu'ils soient alors assez modestes pour
John Stuart Mill (1859), De la libert
52
croire que l'originalit a encore bien des choses accomplir et pour se persuader que moins ils en ressentent le besoin, plus elle leur est ncessaire. En vrit, quels que soient les hommages qu'on veuille bien rendre la supriorit d'esprit, relle ou suppose, la tendance gnrale dans le monde est d'accorder la place dominante la mdiocrit. Dans l'histoire ancienne, au moyen ge - et un degr moindre durant la longue transition entre la fodalit et l'poque actuelle -, l'individu reprsentait une puissance en soi ; et s'il avait de grands talents ou une position sociale leve, cette puissance tait considrable. prsent, les individus sont perdus dans la foule. En politique, c'est presque un lieu commun de dire que c'est l'opinion qui, aujourd'hui, dirige le monde. Le seul pouvoir digne de ce nom est celui des masses et celui des gouvernements en tant qu'ils se font les organes des tendances et des instincts des masses. Et cela vaut aussi bien pour les relations morales et sociales de la vie prive que pour les affaires publiques. Ceux dont les opinions passent pour l'opinion publique diffrent selon les pays : en Amrique, c'est toute la population blanche; en Angleterre, c'est principalement la classe moyenne. Mais toujours ils forment une masse : une mdiocrit collective. Et, nouveaut plus grande encore, les gens de la masse n'empruntent plus leurs opinions aux dignitaires de l'glise ou de l'tat, mais quelques chefs notoires et des livres. Leurs avis sont forms par des hommes trs semblables eux qui, par l'intermdiaire des journaux, s'adressent eux ou parlent en leur nom dans l'inspiration du moment. Je ne me plains pas de cet tat de choses. Je n'affirme pas que rien de mieux soit compatible en rgle gnrale avec la mdiocrit actuelle de l'esprit humain. Mais cela n'empche pas le gouvernement de la mdiocrit d'tre un gouvernement mdiocre. Jamais gouvernement d'une dmocratie ou d'une aristocratie nombreuse ne s'est lev et n'aurait pu s'lever au-dessus de la mdiocrit, que ce soit dans ses actes politiques, les opinions, les talents, la mentalit qu'il produit, si la multitude souveraine ne s'tait pas laisse guide (comme elle l'a toujours fait ses meilleurs moments) par les conseils et l'influence d'un homme ou d'une minorit plus dou et plus instruit. L'initiation aux choses sages et nobles vient et doit venir des individus, et d'abord gnralement d'un individu isol. L'honneur et la gloire de l'homme du commun est de pouvoir suivre cette initiative, d'avoir le sens de ce qui est sage et noble et de s'y laisser conduire les yeux ouverts. Je n'encourage pas ici cette sorte de culte du hros qui applaudit l'homme fort et gnial quand il s'empare du gouvernement du monde et le rduit ses ordres contre son gr. Tout ce quoi un tel homme peut prtendre, c'est la libert de montrer la voie. Le pouvoir de forcer les autres l'emprunter est non seulement contraire la libert et aux dveloppement du reste de la population, mais corrupteur pour l'homme de gnie lui-mme. il semble bien cependant que partout o les masses composes d'hommes ordinaires deviennent le pouvoir dominant, le contre-poids et le correctif de cette tendance se traduise par l'individualit toujours plus marque des penseurs les plus minents. C'est surtout dans de telles circonstances qu'au lieu de rprimer les individus exceptionnels, il faudrait les encourager agir diffremment de la masse. Autrefois, il n'y avait aucun avantage ce qu'ils agissent diffremment, si ce n'tait pas pour agir mieux. Aujourd'hui, le simple exemple de la non-conformit, le simple refus de plier le genou devant la coutume est en soi un vritable service.
John Stuart Mill (1859), De la libert
53
Justement parce que la tyrannie de l'opinion est telle qu'elle fait de l'excentricit une honte, il est souhaitable, pour ouvrir une brche dans cette tyrannie, que les gens soient excentriques. L'excentricit et la force de caractre vont toujours de paire, et le niveau d'excentricit d'une socit se mesure gnralement son niveau de gnie, de vigueur intellectuelle et de courage moral. Que si peu de gens osent maintenant tre excentriques, voil qui rvle le principal danger de notre poque. J'ai dit qu'il tait important de laisser le plus de champ possible aux choses contraires l'usage, afin qu'on puisse voir en temps voulu lesquelles mritent de passer dans l'usage. Mais l'indpendance d'action et le ddain de l'usage ne mritent pas seulement d'tre encourags pour la chance qu'ils donnent de dcouvrir de meilleures faons d'agir et des coutumes plus dignes d'tre adoptes par tous. Il n'y a pas que les gens dots d'un esprit suprieur qui puissent prtendre mener la vie qui leur plat. Il n'y a pas de raison pour que toute existence humaine doive se construire sur un modle unique ou sur un petit nombre de modles. Il suffit d'avoir une dose suffisante de sens commun et d'exprience pour tracer le plan de vie le meilleur, non pas parce qu'il est le meilleur en soi, mais parce qu'il est personnel. Les tres humains ne sont pas des moutons; et mme les moutons ne se ressemblent pas au point qu'on ne puisse pas les distinguer. Un homme ne trouve un habit ou une paire de souliers qui lui vont que s'ils sont faits sur mesure ou s'il dispose d'un magasin entier pour faire son choix. Trouve-t-on plus facilement chaussure son pied que vie sa convenance ? Ou se peut-il qu'il y ait moins de diversit dans la conformation physique et intellectuelle des hommes que dans la forme de leurs pieds ? Ne serait-ce que parce que les hommes n'ont pas tous les mmes gots, il ne faut pas tenter de les fabriquer tous sur le mme modle. Il y a autant d'hommes que d'itinraires intellectuels : de mme que les plantes ne peuvent pas toutes vivre sous le mme climat, les hommes ne peuvent pas tous prosprer dans la mme atmosphre morale. Les mmes choses qui aident une personne cultiver sa nature suprieure peuvent tre des obstacles pour une autre. Le mme mode de vie est pour l'une une stimulation salutaire qui entretient au mieux ses facults d'action et de jouissance, tandis que pour l'autre il est un fardeau gnant qui suspend ou dtruit la vie intrieure. Il y a de telles diffrences entre les hommes, dans leurs sources de plaisir, dans leurs faons de souffrir et de ressentir l'effet des diverses influences physiques et morales que, sans diffrence correspondante dans leurs modes de vie, jamais ils ne pourront prtendre leur part de bonheur ni s'lever la stature intellectuelle dont leur nature est capable. Pourquoi donc la tolrance devrait-elle seulement se limiter, dans le sentiment du publie, aux gots et aux modes de vie qui arrachent l'assentiment par le nombre de leurs adhrents ? il n'y a personne (si ce n'est dans les institutions monastiques) pour nier compltement la diversit des gots. Une personne peut, sans encourir de blme, aimer ou ne pas aimer le canotage, le cigare, la musique, la gymnastique, les checs, les cartes ou l'tude, et cela parce que les partisans et les ennemis de toutes ces choses sont trop nombreux pour tre rduits au silence. Mais les hommes - et plus encore les femmes - qui peuvent tre accuss soit de faire ce que personne ne fait , soit de ne pas faire ce que tout le monde fait ,
John Stuart Mill (1859), De la libert
54
peuvent se voir autant dnigrs que s'ils avaient commis quelque grave dlit moral. Il faut que les gens aient un titre ou quelqu'autre insigne qui les lve dans l'opinion de leurs concitoyens au niveau de gens de qualit, pour qu'ils puissent se permettre tant soi peu le luxe de faire ce qui leur plat, sans nuire leur rputation. Se le permettre tant soi peu, je le rpte, car quiconque se permet trop ce luxe risque bien pire que l'injure, savoir d'tre traduit devant une commission de lunatico et de se voir enlever ses biens au profit de sa famille 1 .
Il y a une caractristique dans l'orientation actuelle de l'opinion publique qui est singulirement de nature la rendre intolrante envers toute dmonstration marque d'individualisme. En moyenne, les hommes ne sont pas seulement modrs dans leur intelligence, mais encore modrs dans leurs inclinations. Ils n'ont pas de gots ou de dsirs assez vifs qui les incitent faire quoi que ce soit d'extraordinaire, si bien qu'ils ne comprennent pas ceux qui en ont et qu'ils les classent parmi les fous et les agits qu'ils ont coutume de mpriser. Maintenant, pour savoir quoi nous attendre, supposons que, outre ce fait gnral, s'amorce un fort mouvement en faveur du progrs moral. De nos jours, un tel mouvement s'est amorc : on a beaucoup fait pour promouvoir la rgularit de la conduite et dcourager les excs ; et il y a dans l'air un esprit philanthropique qui ne trouve pas pour S'exercer terrain plus propice que l'amlioration de ses semblables en fait de morale et de prudence. Ces tendances rendent le public plus dispos qu'autrefois prescrire des rgles de conduite gnrales et s'efforcer de ramener tout le monde la norme reue. Et cette norme, expresse ou tacite, est de ne rien dsirer vivement. Son idal de caractre est de n'avoir pas de caractre marqu - d'estropier, force de compression, comme le pied d'une dame chinoise, toute partie saillante de la nature humaine qui tend rendre une personne franchement dissemblable du commun des hommes.
Il y a quelque chose de mprisable et de terrifiant la fois dans le genre de tmoignage sur lequel on peut, depuis quelques annes, dclarer toute personne judiciairement incapable de diriger ses affaires et, aprs sa mort, tenir pour non-avenue la disposition qu'elle a faite de ses biens, si l'on trouve de quoi payer les frais qui sont prlevs sur les biens eux-mmes. On fouille dans tous les menus dtails de sa vie quotidienne, et tout ce qu'on trouve qui, vu a travers les facults perceptives et descriptives des derniers des derniers, semble diffrer un peu de la banalit la plus stricte, est prsent au jury comme preuve de folie ; et cela russit souvent, les jurs tant peine moins vulgaires et ignorants que les tmoins, tandis que les juges, avec cette extraordinaire ignorance de la nature humaine et de la vie qui ne laisse de nous tonner chez les juristes anglais, contribuent souvent les induire en erreur. Ces procs en disent long sur l'tat des sentiments et des opinions du vulgaire sur la libert humaine. Loin de valoriser l'individualit, loin de respecter le droit de tout individu d'agir dans les choses indiffrentes comme son jugement et ses inclinations l'y portent, les juges et les jurs ne peuvent mme pas concevoir qu'une personne saine d'esprit puisse dsirer une telle libr. Jadis, quand on proposait de brler des athes, des gens charitables suggraient de les mettre plutt dans une maison de fous. On ne s'tonnerait pas de voir faire la mme chose aujourd'hui et de voir les acteurs s'applaudir d'avoir adopt une manire si humaine et si chrtienne de traiter ces infortuns au lieu de les perscuter pour raisons religieuses, non sans une satisfaction secrte de leur avoir fait un sort selon leur mrite.
John Stuart Mill (1859), De la libert
55
Comme il en va gnralement des idaux qui excluent la moiti de ce qui est dsirable, la norme actuelle d'approbation ne produit qu'une imitation infrieure de l'autre moiti. Au lieu de grandes nergies guides par une raison vigoureuse et de forts sentiments puissamment contrls par une volont scrupuleuse, elle produit de faibles sentiments et de faible nergies qui, pour cette raison, peuvent se conformer la rgle, du moins extrieurement, sans grand effort de la part de la volont ou de la raison. Dj, les caractres nergiques et d'envergure appartiennent de plus en plus au pass. Aujourd'hui, dans notre pays, cette nergie ne s'exprime gure plus que dans les affaires. L'nergie qu'on y dpense peut encore tre juge considrable. Le peu qu'il en reste aprs cet emploi est utilis quelque passe-temps, peut-tre utile, voire philanthropique, mais qui est toujours une chose unique, et gnralement sans envergure. La grandeur de l'Angleterre est maintenant toute collective: petits individuellement, nous ne semblons capables de rien de grand que par notre habitude de nous associer; et cela suffit amplement contenter nos philanthropes moraux et religieux. Mais ce sont des hommes d'une autre trempe qui ont fait de l'Angleterre ce qu'elle est; et des hommes d'une autre trempe seront ncessaires pour empcher son dclin. Le despotisme de la coutume est partout l'obstacle qui dfie le progrs humain, parce qu'il livre une dispute incessante cette disposition de viser mieux que l'ordinaire, et qu'on appelle, suivant les circonstances, esprit de libert, esprit de progrs et d'amlioration. L'esprit de progrs n'est pas toujours un esprit de libert, car il peut chercher imposer le progrs un peuple rticent ; et l'esprit de libert, quand il rsiste de tels efforts, peut s'allier localement et temporairement aux adversaires du progrs ; mais la seule source d'amlioration intarissable et permanente du progrs est la libert, puisque grce elle, il peut y avoir autant de foyers de progrs que d'individus. Quoi qu'il en soit, le principe progressif, sous ses deux formes d'amour de la libert et d'amour de l'amlioration, s'oppose l'empire de la Coutume, car il implique au moins l'affranchissement de ce joug; et la lutte entre ces deux forces constitue le principal intrt de l'histoire de l'humanit. La plus grande partie du monde n'a, proprement parler, pas d'histoire, parce que le despotisme de la Coutume y est total. C'est le cas de tout l'Orient. La coutume est l, souverain arbitre de toutes choses : justice et droit signifient conformit la coutume ; et personne, si ce n'est quelques tyrans enivrs de pouvoir, ne songe lui rsister. Et nous en voyons le rsultat. Ces nations doivent avoir eu autrefois de l'originalit ; elles ne sont pas sorties de terre peuples, lettres et profondment verses dans de nombreux arts de vivre; sous tous ces rapports, elles se sont faites elles-mmes, et elles taient alors les plus grandes et les plus puissantes nations du monde. Que sont-elles maintenant ? Elles sont asservies des tribus dont les anctres erraient dans les forts, tandis que les leurs avaient de magnifiques palais et des temples fastueux, une poque o la coutume se dpartageait le pouvoir avec la libert et le progrs. Un peuple, semble-t-il, peut progresser pendant un certain temps, puis s'arrter: quand s'arrte-t-il ? Quand il perd l'Individualit. Si un tel changement devait affecter les nations de l'Europe, ce ne serait pas exactement sous la mme forme: le despotisme de la coutume qui menace ces nations n'est pas prcisment l'immobilisme. C'est un despotisme qui proscrit la singularit, mais qui n'exclut pas le changement, pourvu que tout change en mme temps. Nous
John Stuart Mill (1859), De la libert
56
en avons fini avec les costumes traditionnels de nos aeux. Chacun doit encore s'habiller comme les autres mais la mode peut changer une ou deux fois par an. Nous prenons alors soin de changer pour l'amour du changement, et non par une quelconque ide de beaut ou de commodit; car la mme ide de beaut ou de commodit ne frapperait pas tout le monde au mme moment, et ne serait pas abandonne par tous simultanment. Mais nous sommes tous progressistes comme nous sommes tous versatiles; nous inventons continuellement de nouvelles choses en mcanique, et nous les conservons jusqu' ce qu'elles soient remplaces par de meilleures; nous sommes avides d'amlioration en politique, en ducation et mme en morale, quoiqu'ici notre ide d'amlioration consiste surtout persuader ou forcer les autres d'tre aussi bons que nous-mme. Ce n'est pas au progrs que nous nous opposons; au contraire, nous nous flattons d'tre le peuple le plus progressiste qui vct jamais. C'est contre l'individualit que nous sommes en guerre ; nous croirions avoir fait merveille si nous nous tions rendus tous semblables, oubliant que la dissemblance d'une personne l'autre est la premire chose qui attire l'attention, soit sur l'imperfection de l'un de ces types et la supriorit de l'autre, soit sur la possibilit de produire quelque chose de meilleur que chacun d'eux, en combinant les avantages des deux. L'exemple de la Chine peut nous servir d'avertissement : c'est une nation fort ingnieuse, et certains gards, doue de beaucoup de sagesse, grce l'insigne bonne fortune d'avoir reu de bonne heure un ensemble de coutumes particulirement justes, oeuvre dans une certaine mesure d'hommes auxquels les europens les plus clairs doivent accorder, dans certaines limites, le titre de sages et de philosophes. Ces coutumes sont remarquables aussi par l'excellence de leur mthode pour imprimer autant que possible leurs meilleurs prceptes dans tous les esprits de la communaut, et pour s'assurer que ceux qui en sont le mieux pntrs occuperont le poste honorifique et les fonctions de commandement. Assurment le peuple qui avait cr cette mthode avait dcouvert le secret du progrs humain, et il devait se maintenir a la tte du progrs universel ! Or, au contraire, les Chinois se sont immobiliss; ils sont depuis des milliers d'annes tels que nous les voyons, et, s'ils doivent s'amliorer encore, ce sera ncessairement grce des trangers. Ils ont russi au-del de toute esprance l'entreprise laquelle les philanthropes anglais s'adonnent avec zle : uniformiser un peuple en faisant adopter par tous les mmes maximes et les mmes rgles pour les mmes penses et les mmes conduites. Voil le fruit. Le rgime moderne de l'opinion publique est, sous une forme non organise, ce que sont les systmes ducatif et politique chinois sous une forme organise. Et, si l'individualit n'est pas capable de s'affirmer contre ce joug, l'Europe, malgr ses nobles antcdents et le christianisme qu'elle professe, tendra devenir une autre Chine. Et, jusqu' prsent, qu'est-ce qui a prserv l'Europe de ce sort ? Pourquoi la famille des nations europennes continue-t-elle de progresser ? Pourquoi n'est-elle pas une partie stationnaire de l'humanit ? Ce n'est certes pas grce leurs prtendues qualits suprieures, car l o elles existent, c'est titre d'effet, et non de cause ; mais c'est plutt grce leur remarquable diversit de caractre et de culture. En Europe, les individus, les classes, les nations sont extrmement dissemblables : ils se sont fray une grande varit de chemins, chacun conduisant quelque chose de prcieux;
John Stuart Mill (1859), De la libert
57
et bien qu' chaque poque ceux qui empruntaient ces diffrents chemins aient t intolrants les uns envers les autres, et que chacun et prfr obliger tous les autres suivre sa route, leurs efforts mutuels pour freiner leur dveloppement ont rarement eu un succs dfinitif. Et, peu peu, chacun en est venu accepter bon gr mal gr, le bien qu'apportaient les autres. Selon moi, c'est cette pluralit de voies que l'Europe doit son dveloppement vari. Mais dj elle commence perdre considrablement cet avantage. Elle avance dcidment vers l'idal chinois de l'uniformisation des personnes. Dans sa dernire oeuvre importante, M. de Tocqueville remarque combien les Franais d'aujourd'hui se ressemblent plus que ceux de la gnration prcdente. La remarque vaudrait encore bien davantage pour les Anglais. Dans un passage dj cit, Wilhelm von Humboldt dsigne deux conditions ncessaires au dveloppement humain - ncessaires pour rendre les hommes dissemblables - savoir la libert et la varit des situations. La seconde de ces deux conditions se perd chaque jour en Angleterre. Les circonstances qui entourent les diffrentes classes et les diffrents individus et qui forment leurs caractres, s'uniformisent chaque jour davantage. Autrefois, diffrents rangs sociaux, diffrents voisinages, diffrents mtiers et professions vivaient pour ainsi dire dans des mondes diffrents ; prsent ils vivent tous largement dans le mme monde. Aujourd'hui ils lisent plus ou moins les mmes choses, coutent les mmes choses, regardent les mmes choses ; ils vont aux mmes endroits ; leurs esprances et leurs craintes ont les mmes objets ; ils ont les mmes droits, les mmes liberts et les mmes moyens de les revendiquer. Si grandes que soient les diffrences de positions qui subsistent, elles ne sont rien auprs de celles qui ont disparu. Et l'assimilation continue. Tous les changements politiques de l'poque la favorisent, puisqu'ils tendent tous lever les classes infrieures et abaisser les classes suprieures. Toute extension de l'ducation la favorise, parce que l'ducation runit les hommes sous des influences communes et leur donne accs au stock gnral de faits et de sentiments. Le progrs des moyens de communication la favorise en mettant en contact personnel les habitants de contres loignes et en entretenant une succession rapide de changements de rsidence d'un lieu l'autre. Le dveloppement du commerce et des manufactures favorise encore cette uniformisation en diffusant plus largement les avantages du confort et en offrant tous les plus hauts objets d'ambition la comptition gnrale, d'o il s'ensuit que le dsir de s'lever n'appartient plus exclusivement une classe, mais toutes. Un moyen d'uniformisation gnrale plus efficace encore que tous ceux-ci, c'est l'tablissement complet, dans ce pays et dans d'autres, de l'ascendant de l'opinion publique dans l'tat. A mesure que se nivellent les diffrents rangs hirarchiques suprieurs de la socit, qui permettaient aux personnes retranches derrire elles de mpriser l'opinion de la multitude, mesure que l'ide mme de rsister la volont du public, lorsque cette volont est manifeste, disparat de l'esprit des politiciens, il cesse d'y avoir aucun soutien social pour la non-conformit savoir aucun pouvoir indpendant dans la socit, lui mme oppos l'ascendant des masses, qui a intrt prendre sous sa protection les opinions et les tendances opposes celles du public. La runion de toutes ces causes forme une si grande masse d'influences hostiles l'Individualit qu'on ne voit gure comment elle conservera son terrain. Elle le
John Stuart Mill (1859), De la libert
58
gardera avec une difficult croissante, moins que les plus intelligents n'apprennent en sentir la valeur - tenir pour bnfiques les diffrences, mme si elles ne vont pas dans le sens d'une amlioration et mme si certaines leur semblent apporter une dgradation. Si jamais les droits de l'individualit doivent tre revendiqus, le temps est venu de le faire, car l'uniformisation n'est pas termine. C'est seulement au dbut du processus qu'on peut ragir avec succs contre l'empitement. L'uniformisation des caractres est une exigence qui crot par ce dont elle se nourrit. Si on attend pour y rsister que la vie soit presque rduite un type uniforme, alors tout ce qui s'cartera de ce type sera considr comme impie, immoral, voire monstrueux, et contre nature. L'humanit devient rapidement incapable de concevoir la diversit lorsqu'elle s'en est dshabitue un temps.
John Stuart Mill (1859), De la libert
59
Chapitre IV
Des limites de l'autorit de la socit sur l'individu
Retour la table des matires
Quelle est donc la juste limite de la souverainet de l'individu sur lui-mme ? O commence l'autorit de la socit ? Quelle part de la vie humaine revient-elle l'individualit, quelle part, la Socit ? Chacune des deux recevra ce qui lui revient si chacune se proccupe de ce qui la concerne plus particulirement. l'individualit devrait appartenir cette partie de la vie qui intresse d'abord d'individu; la socit, celle qui intresse d'abord la socit. Bien que la socit ne soit pas fonde sur un contrat, et bien qu'il ne serve rien de l'inventer pour en dduire les obligations sociales, tous ceux qui reoivent protection de la socit lui sont nanmoins redevables de ce bienfait. Le fait seul de vivre en socit impose chacun une certaine ligne de conduite envers autrui. Cette conduite consiste premirement, ne pas nuire aux intrts d'autrui, ou plutt cer-
John Stuart Mill (1859), De la libert
60
tains de ces intrts qui, soit par disposition expresse lgale, soit par accord tacite, doivent tre considrs comme des droits; deuximement, assumer sa propre part ( fixer selon un principe quitable) de travail et de sacrifices ncessaires pour dfendre la socit ou ses membres contre les prjudices et les vexations. Mais ce n'est pas l tout ce que la socit peut faire. Les actes d'un individu peuvent tre nuisibles aux autres, ou ne pas suffisamment prendre en compte leur bien-tre, sans pour autant violer aucun de leurs droits constitus. Le coupable peut alors tre justement puni par l'opinion, mais non par la loi. Ds que la conduite d'une personne devient prjudiciable aux intrts d'autrui, la socit a le droit de la juger, et la question de savoir si cette intervention favorisera ou non le bien-tre gnral est alors ouverte la discussion. Mais cette question n'a pas lieu d'tre tant que la conduite de quelqu'un n'affecte que ses propres intrts, ou tant qu'elle n'affecte les autres que s'ils le veulent bien, si tant est que les personnes concernes sont adultes et en possession de toutes leurs facults. Dans tous les cas, on devrait avoir libert complte - lgale et sociale d'entreprendre n'importe quelle action et d'en supporter les consquences. Ce serait grandement se mprendre sur cette doctrine que d'y voir une dfense de l'indiffrence goste, selon laquelle un homme ne s'intresserait nullement la conduite des autres, et qu'il ne devrait s'inquiter de leur bien-agir et de leur bientre que lorsque que son propre intrt est en jeu. Il ne faut pas moins, mais bien davantage d'efforts dsintresss pour promouvoir le bien d'autrui. Mais la bienveillance dsintresse peut trouver d'autres instruments de persuasion que le fouet et la cravache, au propre comme au figur. Je suis le dernier sous-estimer les vertus prives ; mais elles ne viennent qu'aprs les vertus sociales. C'est le rle de l'ducation que de les cultiver galement toutes deux. Mais l'ducation elle-mme agit par la conviction et la persuasion, aussi bien que par la contrainte, et ce n'est que par le premier moyen qu'une fois l'ducation acheve, les vertus prives devraient tre inculques. Les hommes doivent s'aider les uns les autres distinguer le meilleur du pire, et s'encourager prfrer l'un et viter l'autre. Ils ne devraient avoir de cesse que de se stimuler mutuellement exercer leurs plus nobles facults et orienter davantage leurs sentiments et leurs desseins vers la sagesse, et non la folie, vers des objets de contemplation difiants, et non dgradants. Mais personne n'est autoris dire un homme d'ge mr que, dans son intrt, il ne doit pas faire de sa vie ce qu'il a choisi d'en faire. Il est celui que son bien-tre proccupe le plus: l'intrt que peut y prendre un tranger est insignifiant - moins d'un vif attachement personnel - compar au sien mme. L'intrt que la socit lui porte individuellement (sauf dans sa conduite envers les autres) est partiel et proprement indirect ; tandis qu'en matire de sentiments et de situation, l'homme et la femme les plus ordinaires savent infiniment mieux quoi s'en tenir que n'importe qui d'autre. L'intervention de la socit pour diriger le jugement et les desseins d'un homme dans ce qui ne regarde que lui, se fonde toujours sur des prsomptions gnrales ; or, celles-ci peuvent tre compltement errones ; et si elles taient justes, elles risqueraient encore d'tre fort mal appliques par des personnes peu familires des circonstances particulires, des observateurs extrieurs par exemple. C'est pourquoi cette partie des affaires humaines est le champ d'action privilgi de l'individualit. Pour ce qui est de la conduite des
John Stuart Mill (1859), De la libert
61
hommes les uns envers les autres, l'observance des rgles gnrales est ncessaire afin que chacun puisse savoir quoi s'attendre; mais dans les affaires personnelles, la spontanit individuelle a le droit de s'exercer librement. On peut offrir quelqu'un, voire le forcer entendre, des conseils pour l'aider juger, des exhortations pour raffermir sa volont; mais il demeure le juge suprme. Il peut se tromper en dpit des conseils et des avertissements ; mais c'est l un moindre mal que de laisser les autres le contraindre faire ce qu'ils estiment tre son bien. Je ne veux pas dire que les sentiments qu'on prouve pour quelqu'un ne doivent nullement tre affects par ses qualits ou ses dfauts individuels ; cela n'est ni possible ni souhaitable. S'il possde au plus haut point les qualits qui le mnent son lvation, il est par l mme digne d'admiration. Si en revanche, ces qualits lui font manifestement dfaut, on prouvera pour lui un sentiment contraire l'admiration. Il y a un degr de btise et un degr de ce qu'on pourrait nommer (bien que le terme soit contestable) mdiocrit ou dpravation du got qui, s'il ne mrite pas qu'on maltraite celui qui en est afflig, en fait ncessairement et naturellement un objet de rpulsion, voire dans les cas extrmes, de mpris. Il serait impossible quiconque possde pleinement les qualits opposes de ne pas prouver ces sentiments. Sans nuire personne, un homme peut faire en sorte de nous forcer le tenir pour sot ou pour une nature infrieure ; et comme cette faon de le juger ne lui plairait pas, c'est lui rendre service que de l'en avertir d'avance, ainsi que des autres consquences dsagrables auxquelles il s'expose. Il vaudrait mieux en vrit que la politesse actuelle permt de rendre plus souvent ce service, et qu'une personne pt dire franchement son voisin qu'il est en faute sans passer pour grossire ou prtentieuse. Nous avons galement le droit d'agir de diffrentes faons, en fonction de notre opinion dfavorable sur quelqu'un, et cela sans la moindre atteinte son individualit, mais simplement dans l'exercice de la ntre. Rien ne nous oblige, par exemple, rechercher la compagnie d'une personne; nous sommes en droit de l'viter (quoique sans ostentation), car nous sommes en droit de choisir la compagnie qui nous convient le mieux. Nous avons galement le droit, et parfois le devoir, de mettre les autres en garde contre quelqu'un, si nous jugeons son exemple ou sa conversation nuisible ceux qu'il frquente. Nous pouvons lui prfrer d'autres personnes quand il s'agit de rendre des services non obligatoires, except lorsqu'ils visent son amlioration. C'est ainsi que quelqu'un peut recevoir de trs svres punitions de la part d'autrui pour des fautes qui, directement, le concernent seul ; mais il ne subit ces sanctions que dans la mesure o elles sont les consquences naturelles, et pour ainsi dire spontanes, de ses dfauts eux-mmes ; on ne les lui inflige pas intentionnellement, dans le but de le punir. Une personne qui montre de la prcipitation, de l'obstination, de la vanit, qui ne peut vivre dans des conditions modestes, renoncer aux divertissements nocifs, et qui recherche les plaisirs primaires, sacrifiant ainsi le sentiment et l'intelligence - une telle personne doit s'attendre baisser dans l'opinion des autres et mriter moins d'estime de leur part. Mais elle n'a aucun droit de s'en plaindre, moins d'avoir gagn leurs faveurs par des relations sociales particulirement excellentes qui lui aient acquis un droit la reconnaissance l'preuve de ses dmrites personnels.
John Stuart Mill (1859), De la libert
62
Ce que je soutiens, c'est que les inconvnients strictement lis au jugement dfavorable d'autrui sont les seuls auxquels une personne devrait jamais tre soumise pour les aspects de sa conduite et de son caractre qui ne concernent que son propre bien, sans qu'ils affectent par ailleurs les intrts de ceux avec qui elle est lie. En revanche, les actes nuisibles aux autres requirent un traitement totalement diffrent. Empiter sur leurs droits, leur infliger une perte ou un prjudice que ne justifient pas ses propres droits, user de fausset ou de duplicit leur gard, profiter leurs dpens d'avantages dloyaux ou simplement peu gnreux, voire mme s'abstenir par gosme de les prserver de quelque tort, c'est encourir juste titre la rprobation morale et, dans les cas graves, les sanctions ou punitions morales. Mais ce ne sont pas seulement ces actes, mais les dispositions qui y conduisent, qui sont proprement immoraux et dignes d'une rprobation pouvant aller jusqu' l'horreur. La disposition la cruaut, la mchancet, l'envie - passion antisociale et odieuse entre toutes -, la dissimulation et l'hypocrisie, l'irascibilit gratuite, le ressentiment disproportionn, l'amour de la domination, le dsir d'accaparer plus que sa part d'avantages (la pleonexia des Grecs), l'orgueil qui se nourrit de l'abaissement des autres, l'gosme qui favorise sa personne et ses intrts avant tout et tranche toute question douteuse en sa faveur - autant de vices moraux qui tmoignent d'une moralit dfaillante et odieuse, la diffrence des dfauts personnels mentionns prcdemment, qui ne sont pas proprement parler de l'immoralit ou de la mchancet, quel qu'en soit l'excs. Ces vices peuvent tre une marque de btise, de manque de dignit personnelle et de respect de soi, mais ils ne deviennent des sujets de rprobation morale que lorsqu'ils entranent le mpris des devoirs envers les autres, pour le bien desquels l'individu se doit de veiller sur lui-mme. Ce qu'on appelle devoirs envers soi-mme ne constituent pas une obligation sociale, moins que les circonstances n'en fassent simultanment des devoirs envers autrui. Le terme devoir envers soi-mme, lorsqu'il va au-del de la prudence, signifie respect de soi ou dveloppement personnel ; or, de ces qualits nul n'est responsable devant ses semblables, puisqu'on ne saurait tre rendu responsable du bien qu'on fait l'humanit. La distinction entre le discrdit justifi que s'attire une personne par son manque de prudence ou de dignit personnelle, et la rprobation qui lui revient pour atteinte au droit d'autrui, n'est pas une distinction purement nominale. Il y a une grande diffrence tant dans nos sentiments que dans notre conduite envers une personne, selon qu'elle nous dplat dans les choses o nous estimons tre en droit de la contrler, ou dans celles o nous savons ne pas avoir ce droit. Nous pouvons exprimer notre aversion et nous tenir distance d'une personne ou d'une chose qui nous dplat; mais que cela ne nous incite pas lui rendre la vie difficile. Il faut penser qu'elle porte dj ou portera l'entire responsabilit de son erreur. Si elle gche sa vie en la dirigeant mal, ce n'est pas une raison de dsirer la lui gcher davantage : au lieu de vouloir la punir, il faut plutt s'efforcer d'allger sa punition en lui montrant comment viter ou gurir les maux auxquels sa conduite l'expose. Cette personne sera pour nous un objet de piti, voire d'aversion, mais non de courroux ou de ressentiment ; nous ne devons pas la traiter en ennemi de la socit: le pire que
John Stuart Mill (1859), De la libert
63
nous puissions nous estimer en droit de faire, c'est de l'abandonner elle-mme si nous ne voulons pas intervenir avec bienveillance en montrant de l'intrt pour sa personne. Il en va tout autrement si cette personne a enfreint les rgles ncessaires la protection de ses semblables, individuellement ou collectivement. Car dans ce cas, les consquences funestes de ses actes ne retombent pas sur elle, mais sur d'autres ; et la socit, en tant que protectrice de tous ses membres, doit user de reprsailles contre elle, lui infliger un chtiment suffisamment svre, dans l'intention expresse de punir. Dans le premier cas, le coupable comparat devant nous et nous sommes appels non seulement dlibrer sur son cas, mais encore excuter d'une faon ou d'une autre notre propre sentence. Dans l'autre cas, il ne nous appartient pas de lui infliger des souffrances, sauf si elles proviennent incidemment du fait que nous usons, dans la direction de nos propres affaires, de la mme libert que nous lui reconnaissons dans les siennes. Beaucoup refuseront d'admettre la distinction tablie ici entre la partie de la vie qui ne concerne que l'individu et celle qui concerne les autres. Comment, demanderat-on, une partie quelconque de la conduite d'un membre de la socit peut-elle rester indiffrente aux autres ? Personne n'est entirement isol: il est impossible un homme de se nuire considrablement et durablement sans que le dommage ne se rpercute au moins sur ses proches, et souvent un cercle bien plus large. S'il compromet sa fortune, il nuit ceux qui directement ou indirectement en tiraient leurs moyens d'existence, et d'ordinaire, il diminue plus ou moins les ressources gnrales de la communaut. S'il dtriore ses facults physiques ou morales, il fait non seulement du tort tous ceux dont le bonheur dpendait de lui, mais il se rend incapable de rendre les services qu'il doit gnralement ses semblables; il tombe peut-tre la charge de leur affection et de leur bienveillance; et si une telle conduite tait trs frquente, il n'y aurait gure de faute plus susceptible de porter atteinte au bien gnral. Enfin, dira-t-on encore, si une personne ne nuit pas directement aux autres par ses vices ou ses folies, elle n'en est pas moins pernicieuse par son exemple, et il faudrait la forcer se contrler par gard pour ceux que la vue ou la connaissance de sa conduite pourrait corrompre ou garer. Et mme, ajoutera-t-on, si les consquences de l'inconduite pouvaient se limiter l'individu vicieux et irrflchi, la socit doit-elle pour autant abandonner des gens manifestement incapables de se conduire ? Si l'on reconnat que les enfants et les mineurs doivent tre protgs contre eux-mmes, la socit n'en doit-elle pas autant aux adultes aussi peu capables de se gouverner seuls ? Si le jeu, la boisson, l'incontinence l'oisivet ou la salet sont un obstacle au bonheur et au progrs au mme titre que la plupart des actes interdits par la loi, pourquoi, demandera-ton, la loi ne s'efforcerait-elle, dans la mesure o cela est praticable et opportun socialement, de rprimer galement ces abus ? Et pour remdier aux imperfections invitables de la loi, l'opinion ne devrait-elle pas au moins organiser une police puissante contre ces vices, et infliger ceux connus pour les pratiquer toute la rigueur des pnalits sociales ? Il n'est pas question ici, dira-t-on, de restreindre l'individualit ni d'empcher quiconque de tenter des expriences de vie nouvelles et originales. Tout ce qu'on
John Stuart Mill (1859), De la libert
64
cherche viter, ce sont les expriences tentes et condamnes depuis le dbut des temps jusqu' nos jours - les choses qui, avec l'exprience, ne se sont avres ni utiles ni convenables pour l'individualit de personne. Il faut une somme considrable de temps et d'exprience pour qu'une vrit dicte par la morale ou la prudence soit tenue pour tablie; et l'on souhaite simplement viter que les gnrations ne se prcipitent les unes aprs les autres dans ces mmes abmes qui ont t fatals leurs prdcesseurs. J'admets parfaitement que le tort qu'une personne se fait, puisse srieusement affecter les sentiments et les intrts de ses proches et, un degr moindre, la socit tout entire. Quand, par une telle conduite, un homme est amen violer une obligation distincte et assignable envers une ou plusieurs personnes, le cas cesse d'tre priv et tombe sous le coup de la dsapprobation morale au sens propre du terme. Si, par exemple, de par son intemprance ou son extravagance, un homme se trouve incapable de payer ses dettes, ou si, s'tant charg de la responsabilit morale d'une famille, les mmes raisons le rendent incapable de la nourrir et de l'lever, il mrite la rprobation et peut tre justement puni, non pas pour son extravagance, mais simplement pour avoir manqu son devoir envers sa famille ou ses cranciers. Mme si les ressources qui leur taient destines avaient t dtournes en vue du placement le plus prudent, la culpabilit morale aurait t la mme. George Barnwell assassina son oncle afin d'obtenir de l'argent pour sa matresse, mais s'il l'avait fait pour s'tablir dans le commerce, on l'aurait pendu galement. Mais dans le cas frquent o un homme cause le malheur de sa famille en s'adonnant de mauvaises habitudes, on peut juste titre lui reprocher sa cruaut ou son ingratitude; mais le reproche serait le mme s'il cultivait des habitudes non point vicieuses en elles-mmes, mais pnibles pour ceux avec lesquels il passe sa vie ou qui, par des liens personnels, dpendent de lui pour leur bien-tre. Quiconque n'accorde pas la considration gnralement due aux intrts et aux sentiments d'autrui, sans y tre contraint par un devoir plus imprieux, ou sans pouvoir le justifier par quelque inclination permise, mrite la rprobation morale pour ce manquement, mais non pour la cause de celui-ci, ni pour les erreurs purement prives dont cette faute peut tre la consquence loigne. De mme, si une personne, par une conduite purement goste, se rend incapable d'accomplir un devoir prcis envers le public, elle est coupable d'un crime contre la socit. Personne ne devrait tre puni uniquement pour ivresse; mais un soldat ou un policier doivent tre punis s'ils sont ivres dans l'exercice de leurs fonctions. Bref, partout o il y a un dommage dfini, ou un risque dfini de dommage, soit pour un individu, soit pour la socit, le cas sort du domaine de la libert pour tomber sous le coup de la morale ou de la loi. Mais quant au prjudice purement contingent ou, pour ainsi dire, constructif qu'une personne cause la socit par une conduite qui ne viole aucun devoir spcifique envers le public, ni n'occasionne de dommage perceptible nul autre qu'ellemme, l'inconvnient est alors de ceux que la socit peut supporter, pour l'amour de ce bien suprieur qu'est la libert humaine. S'il fallait punir les adultes parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux-mmes, je voudrais que ce ft pour leur bien, et non pas sous
John Stuart Mill (1859), De la libert
65
prtexte de compromettre leur capacit de rendre la socit des services que celle-ci ne prtend par ailleurs pas avoir le droit de leur imposer. Mais je ne saurais dbattre cette question comme si la socit n'avait pas d'autres moyens de ramener ses membres les plus faibles un niveau ordinaire de conduite raisonnable, que d'attendre qu'ils fassent une btise pour les punir, lgalement ou moralement. La socit a eu tout pouvoir sur eux pendant la premire partie de leur existence ; elle a eu toute la priode de l'enfance et de la minorit pour essayer de les rendre capables de se conduire raisonnablement dans la vie. La gnration prsente est matresse la fois de l'ducation et du sort de la gnration venir. Il est vrai qu'elle ne peut la rendre parfaitement sage et bonne, parce qu'elle manque elle-mme si lamentablement de sagesse et de bont ; et ses plus grands efforts ne sont pas toujours, dans les cas individuels, les mieux rcompenss; mais dans l'ensemble, elle est parfaitement capable de rendre la gnration montante aussi bonne, voire meilleure, qu'elle-mme. Si la socit laisse un grand nombre de ses membres dans un tat d'enfance prolonge, sourds l'influence de la considration rationnelle des motifs gnraux, c'est la socit seule qui est blmer pour les consquences. Forte non seulement de tous les pouvoirs de l'ducation, mais de l'ascendant constant de l'opinion reue sur les esprits les moins autonomes en matire de jugement, aide de surcrot par les sanctions naturelles qui tombent invitablement sur ceux qui s'exposent au dgot et au mpris de leur entourage - que la socit n'aille pas rclamer en outre le pouvoir de lgifrer et de punir dans le domaine des intrts personnels des individus, dans lequel, selon tous les principes de justice et de politique, la dcision devrait appartenir ceux qui doivent en supporter les consquences. Il n'y a rien qui tende davantage discrditer ou annuler les bons moyens d'influencer la conduite humaine que d'avoir recours aux pires. Si, parmi ceux qu'on essaie de contraindre la prudence ou la temprance, certains ont l'toffe d'un caractre vigoureux et indpendant, ils se rvolteront immanquablement contre le joug. Aucun homme de cette trempe n'admettra jamais que les autres aient le droit de le contrler dans ses affaires prives, comme ils ont le droit de l'empcher de nuire aux leurs. Et on en vient vite considrer comme une marque de caractre et de courage le fait de tenir tte une autorit ce point usurpe, et de faire ostensiblement exactement le contraire de ce qu'elle prescrit. C'est ainsi qu'on vit, au temps de Charles Il, la mode de l'indcence succder l'intolrance morale ne du fanatisme puritain. Quant ce qu'on dit de la ncessit de protger la socit contre le mauvais exemple que sont les hommes vicieux et intemprants, il est vrai que le mauvais exemple - surtout le fait de nuire aux autres impunment - peut avoir un effet pernicieux. Mais nous parlons maintenant de la conduite qui, sans nuire autrui, est cense faire grand tort l'agent lui-mme; et dans ce cas, comment ne pas trouver l'exemple plus salutaire que nuisible, puisqu'en montrant l'inconduite au grand jour, il montre aussi les consquences pnibles ou dgradantes qui rsultent gnralement d'une conduite justement censure. Mais l'argument le plus fort contre l'intervention du public dans la conduite purement personnelle, c'est que lorsqu'il intervient, il y a fort parier que ce soit tort et travers. Dans les questions de morale sociale, de devoir envers autrui, l'opinion du public - c'est--dire d'une majorit dominante - peut tre aussi souvent fausse
John Stuart Mill (1859), De la libert
66
que vraie ; car en effet, dans de telles questions, on ne demande aux gens que de juger de leurs propres intrts, et de la faon dont certaines conduites les affecteraient si elles taient autorises. Mais l'opinion d'une telle majorit, impose comme loi une telle minorit, aura autant de chance d'tre fausse que vraie; car, ici, l'opinion publique signifie tout au plus l'opinion de certaines gens sur ce qui est bon ou mauvais pour d'autres, et trs souvent elle ne signifie mme pas cela, puisque le public passe en toute indiffrence au-dessus du plaisir ou du bien-tre de ceux dont il censure la conduite pour ne tenir compte que de sa propre inclination. Beaucoup de gens considrent comme un prjudice personnel les conduites qu'ils n'aiment pas, et les ressentent comme un outrage leurs sentiments : comme ce bigot qui, accus de mpriser les sentiments religieux des autres, rpliqua que c'tait eux qui mprisaient les siens en persistant dans leur culte ou leur croyance abominable. Mais il n'y a aucune commune mesure entre le sentiment d'un homme envers sa propre opinion et celui d'un autre qui s'offense de ce qu'on la dtienne, pas plus qu'entre le dsir qu'prouve un voleur de prendre une bourse et celui qu'prouve son propritaire lgitime de la garder. Et le got d'une personne est son affaire, au mme titre que son opinion ou sa bourse. On peut aisment imaginer un public idal qui n'entrave pas la libert de choix des individus dans les questions incertaines, et qui leur demanderait simplement de renoncer aux modes de conduite que l'exprience universelle a condamns. Mais a-t-on jamais vu un public imposer de telles limites sa censure ? Depuis quand le public se soucie-t-il de l'exprience universelle ? Lorsqu'il se mle de la conduite personnelle, il pense rarement autre chose qu' l'normit que reprsente pour lui le fait d'agir et de sentir diffremment de lui. Et ce critre de jugement, peine dguis, est prsent l'humanit comme le prcepte de religion et de philosophie par les neuf diximes des moralistes et des auteurs spculatifs. Ils nous enseignent que les choses sont justes parce qu'elles sont justes : parce que nous sentons qu'elles le sont. Ils nous disent de chercher dans notre esprit ou notre cur les lois de conduite obligatoires pour nous mmes et pour les autres. Et que peut faire le pauvre public, si ce n'est d'appliquer ces instructions et, en cas de relative unanimit, d'imposer ses sentiments personnels de bien et de mal au monde entier ? Le mal mentionn ici n'est pas de ceux qui n'existent qu'en thorie; et on s'attendra peut-tre ce que je cite les cas particuliers o le public de cette poque et de ce pays investit tort ses prfrences du titre de lois morales. Je n'cris pas un essai sur les aberrations du sentiment moral actuel. C'est un sujet trop grave pour tre discut entre parenthse et sous forme d'illustration. Toutefois, des exemples sont ncessaires pour montrer que le principe que je dfends a une grande importance pratique et que je ne m'efforce pas d'lever une barrire contre des maux imaginaires. Il y a d'abondants exemples qui montrent que cette volont d'tendre les limites de ce qu'on peut appeler la police morale jusqu' ce qu'elle empite sur la libert la plus incontestablement lgitime de l'individu, est de tous les penchants humains l'un des plus universels. Comme premier exemple, considrez les antipathies que les hommes conoivent du simple fait que des personnes d'opinions religieuses diffrentes ne pratiquent pas leurs observances - et surtout leurs abstinences - religieuses. Pour prendre un exemple
John Stuart Mill (1859), De la libert
67
un peu trivial, rien dans la croyance ou dans la pratique des chrtiens n'attise plus la haine des musulmans que de les voir manger du porc. Il y a peu d'actes qui inspirent plus franc dgot aux chrtiens et aux Europens que n'en inspire aux musulmans cette manire particulire de satisfaire sa faim. C'est d'abord une offense leur religion ; mais cette circonstance n'explique nullement le degr ou la forme de leur rpugnance; car le vin est galement interdit par leur religion, et si les musulmans jugent mal d'en boire, ils ne trouvent pas cela dgotant. Leur aversion pour la chair de la bte impure a ceci de particulier qu'elle ressemble une antipathie instinctive, que l'ide d'impuret, une fois qu'elle a imprgn les sentiments, semble toujours inspirer la rpulsion - et cela, mme chez ceux dont les habitudes personnelles sont loin d'tre scrupuleusement pures -, et dont le sentiment d'impuret religieuse chez les Hindous est un exemple remarquable. Supposez maintenant que dans un peuple majorit musulmane, celle-ci veuille interdire de manger du porc dans tout le pays. Il n'y aurait l rien de bien neuf pour les pays musulmans 1 . Serait-ce l exercer lgitimement l'autorit morale de l'opinion publique ? Et sinon, pourquoi ? Cette coutume est rellement rvoltante pour un tel public ; il croit sincrement que Dieu l'interdit et l'abhorre. On ne pourrait pas davantage censurer cette interdiction comme une perscution religieuse. Mme religieuse d'origine, elle ne serait pas une perscution religieuse, tant donn qu'aucune religion ne fait un devoir de manger du porc. Le seul motif de condamnation possible serait que le public n'a pas se mler des gots personnels et des intrts privs du public. Un peu plus prs de nous, la majorit des Espagnols considrent comme une marque grossire d'impit, et comme l'offense la plus grave envers l'tre suprme, de lui vouer un culte diffrent de celui des catholiques romains ; et aucun autre culte public n'est permis sur le sol espagnol. Pour tous les peuples d'Europe mridionale, un clerg mari est non seulement irrligieux, mais impudique, indcent, grossier, dgotant. Que pensent les protestants de ces sentiments parfaitement sincres et de la tentative de les imposer aux non-catholiques ? Cependant si les hommes peuvent lgitimement interfrer dans leur libert rciproque dans ce qui n'affecte pas les intrts d'autrui, sur quel principe cohrent exclure ces cas ? Ou qui peu blmer des gens pour leur dsir de dtruire ce qu'ils considrent comme un scandale aux yeux de Dieu et des hommes ? Il n'y a pas d'arguments plus puissants pour interdire ce qu'on considre comme une immoralit personnelle que supprimer ces pratiques telles qu'elles apparaissent aux yeux de ceux qui les jugent impies; et moins de vouloir adopter la logique des perscuteurs, et dire que nous pouvons perscuter les autres parce que nous avons raison, et qu'ils ne doivent pas nous perscuter parce qu'ils ont
1
Le cas des Parsis de Bombay est un curieux exemple cet gard. Quand les membres de cette tribu industrieuse et entreprenante, descendante des adorateurs du feu perses, fuirent leur pays natal devant les Califes et arrivrent en Inde occidentale, les souverains hindous acceptrent de les tolrer condition de ne pas manger de buf. Quand plus tard ces contres tombrent sous la domination des conqurants, les Parsis obtinrent la prolongation de cette indulgence condition de renoncer au porc. Ce qui ne fut d'abord que soumission l'autorit devint une seconde nature, si bien que les Parsis d'aujourd'hui s'abstiennent la fois de buf et de porc. Bien que leur religion ne l'exige pas, cette double abstinence s'est impose avec le temps comme une coutume de leur tribu ; et en Orient, la coutume est une religion.
John Stuart Mill (1859), De la libert
68
tort, il faut bien nous garder d'admettre un principe qui, impos chez nous, nous paratrait une injustice flagrante. On peut objecter, quoiqu' tort, aux exemples prcdents, qu'ils sont tirs de circonstances impossibles chez nous - puisqu'il est peu vraisemblable dans ce pays que l'opinion se mette imposer l'abstinence de certaines viandes, ou empcher les gens de rendre leur culte, de se marier ou non, selon leur croyance ou leur inclination. En revanche, l'exemple suivant sera tir d'une atteinte la libert dont la menace est loin d'tre carte. Partout o les puritains sont devenus suffisamment puissants comme en Nouvelle-Angleterre et en Grande-Bretagne au temps de la Rpublique ils se sont efforcs avec un succs considrable de rprimer les amusements publics et privs, particulirement la musique, la danse, le thtre, les jeux publics ou tout autre runion en vue de divertissements. Il y a toujours dans notre pays un grand nombre de gens dont les notions de morale et de religion condamnent ces divertissements; et comme ces personnes appartiennent surtout la classe moyenne - devenue aujourd'hui la puissance sociale et politique dominante du royaume - il est fort possible que cette opinion jouisse un jour d'une majorit au parlement. Comment ragira le reste de la communaut en voyant rglementer ses divertissements selon les sentiments moraux et religieux des stricts calvinistes et mthodistes ? Ne prierait-elle instamment ces hommes d'une pit si importune de s'occuper de leurs affaires ? C'est l prcisment ce qu'il faut dire tout gouvernement ou tout public qui a la prtention de priver tout le monde des plaisirs qu'il condamne. Mais si le principe de la prtention est admis, on ne peut objecter raisonnablement ce que la majorit ou tout autre pouvoir dominant dans le pays l'applique selon ses vues ; et tout le monde doit tre prt se conformer l'ide d'une rpublique chrtienne, telle que la comprenait les premiers colons de la Nouvelle-Angleterre, qui craignaient qu'une secte religieuse semblable la leur ne parvienne un jour regagner le terrain perdu, comme ce fut souvent le cas des religions qu'on croyait en dcadence. Supposons maintenant une autre situation peut-tre plus susceptible de se raliser que la prcdente. Il y a, de l'aveu de chacun, une forte tendance dans le monde se diriger vers une constitution dmocratique de la socit, accompagne ou non par des institutions politiques populaires. On affirme que dans le pays o cette tendance s'est manifeste le plus compltement -les tats-Unis, qui ont la socit et le gouvernement les plus dmocratiques - le sentiment de la majorit, auquel dplat le moindre signe d'un train de vie trop luxueux pour qu'elle puisse jamais l'galer, agit comme. une loi somptuaire assez efficace, et que dans maintes parties de l'Union, il est rellement difficile une personne disposant d'un revenu trs important de le dpenser sans encourir la rprobation populaire. Bien que de telles affirmations soient sans doute des reprsentations trs exagres des faits existants, l'tat de choses qu'elles dcrivent est non seulement concevable et possible, mais le rsultat probable de l'union du sentiment dmocratique et de la notion que le public a un droit de veto sur la manire dont les gens dpensent leurs revenus. Maintenant nous n'avons plus qu' supposer une diffusion considrable d'opinions socialistes pour voir qu'il peut devenir infme aux yeux de la majorit de possder davantage qu'une quantit trs limite de
John Stuart Mill (1859), De la libert
69
biens ou qu'un revenu quelconque non acquis par un travail manuel. Des opinions semblables celles-ci dans leur principe dominent dj parmi la classe ouvrire et psent d'une faon oppressive sur ceux qui dpendent avant tout de l'opinion de cette classe, savoir ses propres membres. Il est notoire que les mauvais ouvriers - majoritaires dans beaucoup de branches de l'industrie - croient fermement qu'ils devraient recevoir le mme salaire que les bons, et que nul ne devrait tre autoris, sous prtexte de travailler la pice ou autrement, gagner plus en faisant montre de plus d'habilet et de zle que les autres. Et ils utilisent une police morale, et physique l'occasion, pour intimider les bons ouvriers et les empcher de recevoir une rmunration plus importante pour de meilleurs services, ainsi que pour dcourager les patrons de la leur donner. Si le public a la moindre juridiction sur les affaires prives, je ne vois pas pourquoi ces gens auraient tort ni pourquoi il faudrait blmer le public particulier d'un individu de prtendre la mme autorit sur sa conduite individuelle que celle que l'opinion publique impose aux gens en gnral. Mais trve de suppositions : de grossires usurpations sont perptres aujourd'hui dans le domaine de la libert prive, et d'autres, plus grandes encore, avec l'aide de ces opinions qui revendiquent le droit illimit du public non seulement d'interdire par la loi tout ce qu'il juge mauvais, mais encore, pour mieux atteindre ce but, d'interdire un certain nombre de choses qu'il juge innocentes. Sous prtexte de lutter contre l'intemprance, les habitants d'une colonie anglaise et de presque la moiti des tats-Unis se sont vu interdire par la loi tout usage de boissons alcoolises autre que mdical; car interdire la vente d'alcool - du reste, on l'entendait bien ainsi -, c'est en interdire l'usage. Et bien que l'impossibilit matrielle d'appliquer cette loi ait caus son abrogation dans plusieurs tats qui l'avaient adopte, y compris celui qui lui avait donn son nom, nombre de philanthropes dclars mnent une campagne active pour promouvoir une loi similaire dans notre pays. L'association forme dans ce but, l'Alliance , comme ils l'appellent, a acquis quelque notorit par la publicit donne une correspondance entre son secrtaire et l'un des trs rares hommes publics anglais maintenir que les opinions d'un politicien devraient se fonder sur des principes. La part de lord Stanley dans cette correspondance est propre renforcer les espoirs qu'avaient dj placs en lui ceux qui savent combien sont rares, parmi les acteurs de la vie politique, ces qualits qu'il a parfois manifestes en public. Le porte-parole de l'Alliance qui dplorerait profondment la reconnaissance de tout principe susceptible d'tre dtourn pour justifier le sectarisme et la perscution entreprend de nous montrer la large et infranchissable barrire qui spare de tels principes de ceux de l'association. Toutes les questions relatives la pense, l'opinion, la conscience, me semblent , dit-il, se situer hors de la sphre lgislative. En revanche, tout ce qui appartient au domaine des actes sociaux, des habitudes, des relations, me parat uniquement du ressort d'un pouvoir discrtionnaire de l'tat, et non de l'individu, de sorte que cela tombe dans la sphre de la lgislation. Nulle mention n'est faite ici d'une troisime classe d'actes, diffrente des deux cites ci-dessus, savoir les actions et les habitudes qui ne sont pas sociales, mais individuelles, bien que ce soit dans celles-ci que se classe la consommation de
John Stuart Mill (1859), De la libert
70
boissons alcoolises. Il est pourtant vrai que la vente des boissons alcoolises est un commerce, et que le commerce est un acte social. Or, l'infraction reproche n'est pas la libert du vendeur, mais celle de l'acheteur et du consommateur, puisque ]'tat pourrait tout autant lui interdire de boire du vin que de le mettre dans l'impossibilit de s'en procurer. Le secrtaire dclare pourtant : En tant que citoyen, je revendique le droit de lgifrer partout o mes droits sociaux subissent l'assaut de l'acte social d'un autre. Voici maintenant la dfinition de ces droits sociaux : S'il y a une chose qui empite sur mes droits sociaux, c'est bien le commerce des boissons alcoolises. il dtruit mon droit lmentaire la scurit en crant et en stimulant constamment le dsordre social. Il empite sur mon droit l'galit en tirant profit de la cration d'une misre que je paye par mes impts. Il infirme mon droit un libre dveloppement moral et intellectuel en parsemant ma route de dangers et en affaiblissant et dmoralisant la socit, dont j'ai le droit d'attendre aide et secours mutuels. Cette thorie des droits sociaux telle que jamais sans doute on ne l'avait distinctement formule, se rduit ceci : tout individu a un droit social absolu d'exiger que tout autre individu agisse en tout exactement comme il le devrait; quiconque manque tant soi peu son devoir viole mon droit social et m'autorise demander la lgislature rparation de ce grief. Un principe aussi monstrueux est infiniment plus dangereux que tout empitement isol sur la libert: il n'est pas de violation de la libert qu'il ne puisse justifier. Il ne reconnat aucun droit une libert quelconque, sauf peut-tre celle de nourrir des opinions secrtes sans jamais les rvler, car ds qu'une opinion que je juge nuisible franchit les lvres de quelqu'un, elle viole tous les droit sociaux que m'attribue l'Alliance. Cette doctrine accorde tous les hommes un droit acquis mutuel sur la perfection morale, intellectuelle et mme physique de l'autre, que chaque plaignant peut dfinir selon son propre critre. Un autre exemple important d'empitement illgitime sur la libert lgitime de l'individu, qui n'est pas une simple menace, mais qui a depuis longtemps pris triomphalement effet, est celui de la lgislation du Sabbat. Sans doute, la coutume de s'abstenir des occupations ordinaires un jour par semaine, autant que le permettent les exigences de la vie, est hautement salutaire, bien que ce ne soit un devoir religieux que pour les Juifs. Et comme cette coutume ne peut tre observe sans le consentement gnral des classes ouvrires - dans la mesure o il suffit que quelques-uns travaillent pour imposer aux autres la mme ncessit -, il est peut-tre juste d'admettre que la loi garantisse chacun l'observation gnrale de la coutume en suspendant un jour donn les principales oprations de l'industrie. Mais cette justification, fonde sur l'intrt direct qu'ont les autres ce que chacun observe cet usage, ne s'applique pas ces occupations prives auxquelles une personne juge bon de consacrer son temps de loisir; par ailleurs, elle ne s'applique pas non plus le moins du monde aux restrictions lgales visant les divertissements. Il est vrai que l'amusement des uns est le travail des autres ; mais le plaisir, pour ne pas dire l'utile rcration, d'une majorit de gens vaut bien le travail d'une minorit, pourvu que leur occupation soit choisie librement et puisse tre librement abandonne. Les ouvriers ont parfaitement raison de penser que si tout le monde travaillait le dimanche, on donnerait le travail de sept jours pour le salaire de six; mais tant que la majorit des oprations est suspendue, le
John Stuart Mill (1859), De la libert
71
petit nombre de ceux qui doit continuer de travailler pour le plaisir des autres obtient un surcrot de salaire proportionnel ; et nul n'est oblig de continuer de travailler ainsi s'il prfre le loisir au gain. Si l'on cherche un autre remde, on pourrait le trouver dans l'tablissement d'un jour de cong dans la semaine pour cette classe particulire de personnes. Par consquent, la seule raison qui reste pour justifier les restrictions sur les amusements du dimanche, c'est dire qu'ils sont rprhensibles du point de vue religieux, motif de lgislation contre lequel on ne saurait protester trop nergiquement. Deorum injuriae Diis curae. Il reste prouver que la socit ou l'un de ses fonctionnaires a reu d'en haut la mission de venger toute offense suppose envers le Tout-puissant, qui ne soit pas aussi un tort inflig nos semblables. L'ide qu'il est du devoir d'un homme de veiller ce qu'un autre soit religieux est la cause de toutes les perscutions religieuses jamais perptres; et si on l'admettait, elle les justifierait pleinement. Quoique le sentiment qui transparat dans les frquentes tentatives d'arrter le trafic des trains le dimanche, de fermer les muses, etc., n'ait pas la cruaut des anciens perscuteurs, l'tat d'esprit qu'elles signalent est fondamentalement le mme. C'est une dtermination ne pas tolrer que les autres fassent ce que leur permet leur religion, et cela parce que ce n'est pas permis par la religion du perscuteur. C'est croire que non seulement Dieu dteste l'acte du mcrant, mais qu'il ne nous tiendra pas non plus pour innocents si nous le laissons agir en paix. Je ne puis m'empcher d'ajouter ces preuves du peu de cas qu'on fait gnralement de libert humaine celle du langage de franche perscution qui explose dans la presse de ce pays partout o elle prte attention au phnomne remarquable du mormonisme. On pourrait en dire long sur ce fait inattendu et instructif, qu'une prtendue rvlation et une religion reposant sur cette base, fruit d'une imposture palpable, qui n'est pas mme soutenue par le prestige des qualits extraordinaires chez son fondateur, soit partage par des centaines de milliers de personnes et devenue le fondement d'une socit dans le sicle des journaux, du chemin de fer et du tlgraphe lectrique. Ce qui nous concerne ici, c'est que cette religion, comme beaucoup d'autres et de meilleures, ait ses martyrs : que son prophte et son fondateur, cause de sa doctrine, ait t mis mort par la populace, que plusieurs de ses partisans aient perdu la vie pour les mmes violences illgales, que leur secte ait t bannie de leur pays d'origine, et que, maintenant qu'elle est bien isole au milieu du dsert, beaucoup de nos compatriotes dclarent ouvertement qu'il serait juste (mais peu commode) d'envoyer une expdition contre les Mormons et de les contraindre par la force se conformer aux opinions des autres. L'article de la doctrine mormone qui inspire le plus l'antipathie, laquelle passe outre les barrires ordinaires de la tolrance, est l'autorisation de la polygamie. Bien que celle-ci soit permise aux musulmans, aux Hindous et aux Chinois, elle semble exciter une animosit implacable lorsqu'elle est pratique par des gens qui parlent anglais et qui se disent chrtiens. Personne ne dsapprouve plus profondment que moi cette institution mormone, pour ces mmes raisons et aussi parce que, loin d'tre comprise dans le principe de libert, elle constitue une infraction directe celui-ci, rivant simplement les chanes d'une moiti de la communaut, et dispensant l'autre moiti de toute rciprocit d'obligation envers la premire. Quoi qu'il en soit, il faut rappeler que, de la part des femmes concernes
John Stuart Mill (1859), De la libert
72
qui en paraissent les victimes, cette relation est tout aussi volontaire que dans toute autre forme d'institution matrimoniale. Et aussi surprenant que ce fait puisse paratre, il s'explique par les ides communes et les habitudes du monde: on apprend aux femmes que le mariage est la seule chose ncessaire pour elles ; ce qui explique ds lors que beaucoup d'entre elles prfrent pouser un homme qui a beaucoup d'autres femmes ne pas se marier du tout. D'autres pays n'ont pas reconnatre de telles unions ou dispenser une partie de leurs citoyens de suivre leurs propres lois en faveur des opinions mormones. Mais quand les dissidents ont concd aux sentiments hostiles des autres bien plus qu'on ne pouvait en toute justice l'exiger, quand ils ont quitt leur pays o leurs doctrines taient inacceptables pour s'tablir dans un coin perdu de la terre qu'ils ont t les premiers rendre habitable, il est difficile de voir au nom de quels principes, si ce n'est ceux de la tyrannie, on peut les empcher d'y vivre leur guise, pourvu qu'ils n'agressent pas les autres nations et qu'ils laissent toute libert de partir aux mcontents.
Un crivain moderne, de grand mrite certains gards, proposait rcemment (pour reprendre ses propres termes) non pas une croisade, mais une civilisade contre cette communaut polygame, et cela pour mettre fin ce qui lui semblait tre un pas en arrire dans la marche de la civilisation. Je vois la chose de mme; mais je ne sache pas qu'aucune communaut ait le droit d'en forcer une autre tre civilise. Tant que les victimes de la mauvaise loi ne demandent pas l'aide des autres communauts, je ne puis admettre que des personnes sans rapport aucun avec elles puissent intervenir et exiger la cessation d'un tat de choses qui semble satisfaire toutes les parties intresses, sous prtexte que c'est un scandale pour des gens vivant quelques milliers de miles de l, et qui n'y ont aucune part et aucun intrt. Qu'ils envoient des missionnaires, si bon leur semble, pour prcher contre elle; et qu'ils opposent au progrs de telles doctrines dans leur propre pays des moyens quitables (or, imposer le silence aux novateurs n'en est pas un). Si la civilisation a vaincu la barbarie quand la barbarie dominait le monde, il est excessif de craindre qu'elle puisse revivre et conqurir la civilisation aprs avoir t dfaite. Pour qu'une civilisation succombe ainsi son ennemi vaincu, elle doit d'abord avoir dgnr au point que ni ses prtres, ni ses matres officiels, ni personne n'aient la capacit ou ne veuillent prendre la peine de la dfendre. Si tel est le cas, plus vite on se dbarrassera d'une telle civilisation, mieux ce sera. Elle ne pourra aller que de mal en pis, jusqu' ce qu'elle soit dtruite et rgnre (comme l'Empire romain d'Occident) par d'nergiques Barbares.
John Stuart Mill (1859), De la libert
73
Chapitre V
Applications
Retour la table des matires
Les principes affirms dans ces pages doivent tre plus gnralement admis comme base en vue d'une discussion des dtails, avant qu'une application systmatique puisse tre tente avec quelque chance de succs dans les diffrents champs de la politique et de la morale. Les quelques observations que je me propose de faire sur des questions de dtails visent illustrer les principes plutt que d'en dduire les consquences. Je n'offre pas tant des applications que des chantillons d'applications susceptibles d'clairer davantage le sens et les limites des deux maximes qui constituent toute la doctrine de cet essai, et d'aider le jugement maintenir l'quilibre entre elles dans les cas o l'on hsite appliquer l'une ou l'autre. Ces maximes sont les suivantes : premirement, l'individu n'est pas responsable de ses actions envers la socit, dans la mesure o elles n'affectent les intrts de personne d'autre que lui-mme. Pour leur propre bien, les autres peuvent avoir recours aux conseils, l'instruction, la persuasion et la mise l'cart: c'est l la seule faon pour la socit d'exprimer lgitimement son aversion ou sa dsapprobation de la
John Stuart Mill (1859), De la libert
74
conduite d'un individu. Deuximement, pour les actions portant prjudice aux intrts d'autrui, l'individu est responsable et peut tre soumis aux punitions sociale et lgale, si la socit juge l'une ou l'autre ncessaire sa propre protection. En premier lieu, il ne faut surtout pas croire que, parce qu'il peut seul la justifier dans certains cas, un risque de dommage aux intrts d'autrui puisse toujours justifier l'intervention de la socit. Dans de nombreux cas, un individu, en poursuivant un but lgitime, cause ncessairement et donc lgitimement de la peine ou des pertes d'autres, ou alors il intercepte un bien qu'ils pouvaient raisonnablement esprer obtenir. De telles oppositions d'intrts entre individus proviennent souvent de mauvaises institutions, mais elles sont invitables tant que celles-ci perdurent ; et certaines d'entre elles seraient invitables sous n'importe quelles institutions. Quiconque russit dans une profession o abondent les concurrents, ou bien un concours, quiconque est prfr l'autre dans une lutte pour un objet qu'ils dsirent tous deux, celui-l tire profit de l'chec des autres, de la vanit de leurs efforts et de leur dception. Mais on admet communment qu'il vaut mieux dans l'intrt gnral de l'humanit que les hommes poursuivent leurs buts sans s'arrter ce genre de consquences. En d'autres termes, la socit ne reconnat aux comptiteurs dus aucun droit lgal ou moral l'immunit devant ce type de souffrance, et elle ne se sent appele intervenir que lorsque les moyens de succs employs sont de ceux que l'intrt gnral ne saurait permettre, savoir: la fraude, la duperie et la violence. Ainsi le commerce est acte social. Quiconque met en vente quoi que ce soit se lance dans une activit qui affecte les intrts d'autrui et de la socit en gnral ; et par suite, sa conduite tombe en principe sous la juridiction de la socit. C'est pourquoi on estimait autrefois qu'il tait du devoir des gouvernements, dans tous les cas importants, de fixer les prix et de rglementer les procds de fabrication. Mais c'est seulement aujourd'hui, aprs une longue lutte, qu'on reconnat que le seul moyen de garantir la fois des prix bas et des produits de bonne qualit, c'est de laisser les producteurs et les vendeurs parfaitement libres, sans autre contrle que l'gale libert pour les acheteurs de se fournir ailleurs. Telle est la doctrine dite de libre-change , qui repose sur des bases diffrentes, mais non moins solides que le principe de libert individuelle dfendu dans cet essai. Les restrictions imposes au commerce ou la production commerciale sont en effet des contraintes ; et toute contrainte, en tant que contrainte, est un mal. Mais les contraintes en question affectent seulement cet aspect de la conduite humaine que la socit a le droit de contraindre, et si elles sont condamnables, c'est uniquement parce qu'elles ne produisent pas vraiment les rsultats escompts. Le principe de la libert n'tant pas impliqu dans la doctrine du librechange, il ne l'est pas davantage dans les questions qui se posent sur les limites de cette doctrine, telles que, par exemple, la part de contrle public susceptible d'tre admise pour empcher la fraude par falsification des marchandises, ou les prcautions sanitaires ou les mesures de protection imposer pour les ouvriers employs des travaux dangereux. De telles questions n'impliquent des considrations de libert que dans la mesure o il vaut toujours mieux laisser les gens livrs eux-mmes, caeteris paribus, que de les contrler; mais il est indniable qu'en principe, ils peuvent tre
John Stuart Mill (1859), De la libert
75
lgitimement contrls ces fins. D'autre part, il y a les questions relatives l'intervention dans le commerce, qui sont essentiellement, elles, des questions de libert, telles que la loi du Maine mentionne plus haut, l'interdiction d'importer de l'opium en Chine, la restriction sur la vente des toxiques - bref, tous les cas o le but de l'intervention est de rendre certains produits difficiles ou impossibles obtenir. Ces interventions sont contestables non pas tant parce qu'elles empitent sur la libert du producteur ou du vendeur, mais parce qu'elles empitent sur la libert de l'acheteur. L'un de ces exemples, celui de la vente des toxiques, pose une nouvelle question: celle des justes limites de ce qu'on peut appeler les fonctions de la police. Jusqu'o peut-on lgitimement empiter sur la libert pour prvenir des crimes ou des accidents ? C'est l'une des fonctions incontestes du gouvernement que de prendre des prcautions contre le crime avant qu'il ne soit perptr, au mme titre que de le dcouvrir et de le punir aprs coup. Toutefois, il est beaucoup plus ais d'abuser de la fonction prventive du gouvernement au dtriment de la libert que d'abuser de sa fonction punitive ; car il n'est gure d'aspect de la libert d'action lgitime d'un tre humain dont on ne puisse pas dire, et cela honntement, qu'il favorise davantage une forme ou une autre de dlinquance. Nanmoins, si une autorit publique, ou mme une personne prive, voient quelqu'un se prparer videmment commettre un crime, rien ne la force observer sans rien faire et d'attendre que le crime soit commis, mais elle peut intervenir pour l'empcher. Si l'on n'achetait de poison ou si l'on ne s'en servait jamais que pour empoisonner, il serait juste d'en interdire la fabrication et la vente. On peut cependant en avoir besoin des fins non seulement inoffensives, mais utiles, et des restrictions ne peuvent tre imposes dans un cas sans oprer dans l'autre. De plus, c'est le rle de l'autorit publique que de prvenir les accidents. Si un fonctionnaire ou quelqu'un d'autre voyait une personne sur le point de traverser un pont reconnu dangereux et qu'il soit trop tard pour la prvenir du risque qu'elle court, il pourrait alors l'empoigner et la faire reculer de force, et cela sans rellement violer sa libert, car la libert consiste faire ce qu'on dsire, et cette personne ne dsire pas tomber dans la rivire. Nanmoins, quand il n'y a pas de certitude, mais un simple risque de danger, seule la personne elle-mme peut juger de la valeur du motif qui la pousse courir ce risque. Dans ce cas, par consquent ( moins qu'il ne s'agisse d'un enfant, d'une personne dlirante ou dans un tat d'excitation ou de distraction l'empchant de rflchir normalement), on devrait se contenter, selon moi, de l'avertir du danger et ne pas l'empcher par la force de s'y exposer. De telles considrations, appliques une question comme la vente des toxiques, peuvent nous aider dcider lequel des divers modes de rgulation possibles est contraire ou non au principe. Par exemple, on peut imposer sans violation de libert une prcaution telle que d'tiqueter la drogue de faon en spcifier le caractre dangereux: l'acheteur ne peut dsirer ignorer les qualits toxiques du produit qu'il achte. Mais exiger dans tous les cas le certificat d'un mdecin, rendrait parfois impossible et toujours chre l'obtention de l'article pour des usages lgitimes. Selon moi, le seul moyen de prvenir les empoisonnements, et cela sans violer la libert de ceux qui ont besoin de substances toxiques dans d'autres buts, consiste fournir ce que Bentham appelle fort justement une preuve pralable . Rien n'est plus commun dans les contrats. Il est courant et
John Stuart Mill (1859), De la libert
76
justifi, lorsqu'on conclut un contrat, que la loi requiert, comme condition de sa valeur lgale, l'observance de certaines formalits telles que les signatures, l'attestation des tmoins, etc., afin qu'en cas de dispute ultrieure, on puisse avoir la preuve que le contrat a t rellement conclu, et que rien dans les circonstances ne l'invalidait. L'effet de ce dispositif est de mettre de grands obstacles aux contrats fictifs, ou aux contrats faits dans des conditions qui, si elles taient connues, les rendraient caducs. On pourrait imposer semblables prcautions sur la vente des articles propres servir d'instruments criminels. Par exemple, on pourrait exiger du vendeur qu'il inscrivt dans un registre la date exacte de la vente, le nom et l'adresse de l'acheteur, la qualit et la quantit prcises vendues, ainsi que l'usage prvu de l'objet. Quand il n'y a pas de prescription mdicale, on pourrait exiger la prsence d'un tiers afin de prouver le fait contre l'acheteur s'il s'avrait par la suite que l'article ait t utilis des fins criminelles. De tels rglements ne constitueraient en gnral aucun obstacle matriel l'obtention de l'article, mais un obstacle trs considrable en faire un usage illicite sans tre dcouvert. Le droit inhrent la socit d'opposer aux crimes qui la visent des mesures prventives, suggre les limites videntes de cette ide que la mauvaise conduite purement prive n'offre pas matire prvention ou punition. L'ivresse, par exemple, n'est pas ordinairement un sujet normal d'intervention lgislative ; mais je trouverais parfaitement lgitime qu'on impose une restriction spciale, personnelle un homme convaincu de quelque violence envers autrui sous l'influence de la boisson, et telle que si on le trouve ivre ensuite, il soit passible d'une amende, et que s'il commet un nouveau dlit dans cet tat, la punition reue soit plus svre. S'enivrer, pour une personne que l'ivresse pousse nuire autrui, est un crime envers les autres. De mme l'oisivet - sauf si la personne est la charge du public, ou si son oisivet constitue une rupture de contrat - ne peut sans tyrannie faire l'objet de punitions lgales. Mais si par oisivet, ou par une autre raison facilement vitable, un homme manque ses devoirs lgaux envers autrui, comme d'entretenir ses enfants, ce n'est pas un acte de tyrannie que le forcer remplir ses obligations en travaillant si on ne trouve pas d'autres moyens. En outre, il y a beaucoup d'actes directement dommageables leurs auteurs qui ne devraient pas tre lgalement interdits, mais qui, commis en publie, deviennent une violation des bonnes murs sociales, tombent ainsi dans la catgorie des offenses envers autrui et peuvent tre justement interdits. C'est le cas des atteintes la dcence, sur lesquelles il est inutile de s'appesantir, d'autant moins qu'elles n'ont qu'un rapport indirect avec notre sujet, puisqu'on peut objecter la publicit d'un acte, mme si celui-ci n'est blmable en lui-mme pour personne. Il y a une autre question laquelle il faut trouver une rponse en accord avec les principes poss ici. Dans les cas de conduite personnelle tenus pour blmables, mais que le respect de la libert empche de prvenir ou de punir, parce qu'alors le mal qui en rsulte retombe entirement sur l'agent - doit-on avoir la mme libert de conseiller ou d'inciter faire ce que fait librement l'agent ? La question n'est pas sans
John Stuart Mill (1859), De la libert
77
difficult. Le cas d'une personne qui en incite une autre accomplir un acte n'est pas strictement un cas de conduite personnelle. Prodiguer des conseils quelqu'un ou le pousser agir est un acte social et peut par consquent, comme toute action qui affecte autrui en gnral, tre estim soumis au contrle social. Mais un peu de rflexion corrige cette premire impression en montrant que, si le cas n'entre pas strictement dans la dfinition de la libert individuelle, on peut nanmoins lui appliquer les raisons sur lesquelles se fonde le principe de la libert. Si l'on doit permettre aux gens, dans ce qui les concerne seuls, d'agir comme bon leur semble leurs risques et prils, c'est qu'ils doivent galement tre libres de se consulter l'un l'autre sur ce qu'il convient de faire, d'changer des opinions ainsi que de donner et recevoir des suggestions. Il faut pouvoir conseiller tout ce qu'il est permis de faire. Mais la question devient douteuse lorsque l'instigateur tire un profit personnel de son conseil, lorsqu'il en fait mtier pour vivre ou s'enrichir, pour promouvoir ce que la socit et l'tat considrent comme un mal. Alors, effectivement, un lment de complication intervient, savoir l'existence d'une classe de personnes dont l'intrt est contraire ce qui est considr comme le bien public, et dont le mode de vie est bas sur l'opposition ce bien. Est-ce ou non un cas d'intervention ? Ainsi la fornication et le jeu doivent tre tolrs : mais est-on libre pour autant d'tre souteneur ou tenancier d'une maison de jeu ? Le cas est un de ceux qui se situent la frontire des deux principes, et l'on ne voit pas immdiatement duquel des deux il dpend. il y a des arguments de part et d'autre. Du ct de la tolrance, on peut dire qu'il ne peut pas tre criminel de choisir pour mtier, pour en vivre et s'enrichir, une activit qui serait admissible autrement ; que cet acte devrait tre soit toujours permis, soit toujours interdit; que si les principes que nous avons dfendus jusqu'ici sont vrais, la socit, en tant que socit, n'a pas dclarer mauvais ce qui ne concerne que l'individu; qu'elle ne peut aller au-del de la dissuasion; et qu'enfin une personne devrait tre aussi libre de persuader qu'une autre de dissuader. En opposition cela, on peut dfendre l'ide que - quoique le public ou l'tat ne puisse dcider de manire autoritaire, en vue de rprimer ou de punir, que telle ou telle conduite purement personnelle est bonne ou mauvaise - ils sont parfaitement en droit de supposer que, s'ils jugent mauvais certains actes, alors le fait qu'ils le soient ou non est ouvert la discussion ; ceci tant admis, le public et l'tat ne peuvent faire mal en s'efforant d'liminer l'influence de sollicitations qui ne sont pas dsintresses, d'instigateurs qui ne sauraient tre impartiaux, qui ont un intrt personnel direct orient d'un ct (le mauvais du point de vue de l'tat), et qui avouent le promouvoir des fins personnelles uniquement. On pourra avancer que rien ne sera perdu assurment, qu'aucun bien ne sera sacrifi, si l'on fait en sorte que les gens fassent spontanment leur choix, sagement ou sottement, mais autant que possible l'abri des artifices de ceux qui stimulent leurs inclinations par intrt personnel. Alors, dira-t-on, bien que le statut des jeux illicites soit absolument indfendable - bien que tout le monde doive tre libre de jouer chez soi, chez les autres, ou dans un lieu de rencontre fonctionnant sur cotisation et accessible aux seuls membres et leurs invits -nanmoins, les maisons de jeu publiques ne devraient pas tre autorises. Il est vrai que l'interdiction n'est jamais efficace, et que, aussi tyrannique que soit la police, les maisons de jeu parviennent toujours se maintenir sous d'autres prtextes ; mais on peut les contraindre entourer leurs
John Stuart Mill (1859), De la libert
78
affaires d'un certain degr de secret et de mystre, afin que personne ne les connaisse, hormis ceux qui les recherchent ; et la socit devrait se contenter de ce rsultat. Ces arguments ont une force considrable. Je ne me risquerai pas dcider s'ils sont suffisants pour justifier l'anomalie morale consistant punir le complice, quand l'instigateur est laiss en libert (et qu'on doit le laisser libre), mettre l'amende ou en prison le souteneur, mais non le fornicateur -le tenancier de la maison de jeu, mais non le joueur. Et de tels motifs devraient encore moins entrer en ligne de compte dans les transactions commerciales courantes. Tout article achet ou vendu peut donner lieu des excs que les vendeurs ont un intrt pcuniaire encourager. Mais ce fait ne peut supporter aucun argument en faveur de la loi du Maine, par exemple, et cela parce que les marchands de boissons alcoolises, malgr leur intrt ce qu'on en abuse, restent indispensables pour l'usage lgitime de ces boissons. Cependant, l'intrt de ces commerants favoriser l'intemprance est un mal rel qui justifie l'imposition de restrictions par l'tat, ainsi que l'exigence de garanties qui, sans cette justification, seraient des violations de la libert lgitime. Ce qui fait encore question, c'est de savoir si l'tat, tout en tolrant une conduite qu'il estime contraire aux intrts les plus prcieux de l'agent, ne devrait pas nanmoins la dcourager indirectement. Ne devrait-il pas lutter contre l'ivresse, par exemple, en augmentant le prix des alcools ou en limitant le nombre des points de vente pour qu'il soit plus difficile de s'en procurer ? Ici, comme dans la plupart des questions pratiques, il y a une foule de distinctions faire. Taxer les alcools, dans le seul but de rendre leur obtention plus difficile, est une mesure qui diffre fort peu de leur interdiction totale, et qui ne se justifierait que si elle tait justifiable. Toute augmentation est une interdiction pour ceux qui ne peuvent payer le nouveau prix; et pour ceux qui ont les moyens, c'est une faon de pnaliser leur volont de satisfaire un got particulier. Le choix de leurs plaisirs et leur manire de dpenser leurs revenus une fois qu'ils ont rempli leurs obligations lgales et morales envers l'tat et les individus, ne regardent qu'eux-mmes et ne doivent dpendre que de leur seul jugement. premire vue, ces considrations semblent condamner le choix des alcools en tant que source particulire de revenus fiscaux. Mais il faut rappeler que la taxation cette fin est absolument invitable, que dans nombre de pays, cet impt oit tre en grande partie indirect, et que par consquent l'tat ne peut pas viter de pnaliser l'usage de certains articles de consommation par des taxes qui, pour certains, peuvent tre prohibitives. Il est donc du devoir de l'tat de considrer, avant d'imposer des taxes, quelles sont les denres dont les consommateurs peuvent le mieux se passer et, a fortiori, de choisir de prfrence celles qui, selon lui, peuvent devenir nuisibles audel d'une quantit trs modre. C'est pourquoi on peut admettre autant qu'approuver que les alcools fassent l'objet de l'imposition maximum ( supposer que l'tat ait besoin de tous les revenus ainsi obtenus). La question de savoir s'il faut faire de la vente de ces denres un privilge plus ou moins exclusif, doit tre rsolue diffremment selon les motifs auxquels est subordonne la restriction. Dans tous les lieux publics, il faut la contrainte d'une police, et particulirement dans les lieux de ce genre qui deviennent facilement le thtre de
John Stuart Mill (1859), De la libert
79
dlits contre la socit. Il est donc opportun de limiter le droit de vente de ces marchandises (du moins pour la consommation sur place) des personnes dont la respectabilit est connue ou garantie ; on doit, en outre, rglementer les heures d'ouverture et de fermeture en fonction des exigences de la surveillance publique, et retirer sa licence au tenancier si des troubles se produisent plusieurs reprises avec sa complicit ou cause de son incapacit, ou si son tablissement devient un lieu de rendezvous pour comploter et prparer des infractions la loi. Je ne vois pas d'autre restriction justifiable en principe. Par exemple, la limitation du nombre des brasseries et des dbits de boisson dans le but express d'en diminuer les tentations, est non seulement un inconvnient pour tout le monde, sous prtexte que certains abuseraient de cette facilit, mais encore une mesure qui ne convient qu' un tat de socit dans lequel les classes ouvrires sont traites ouvertement comme des enfants ou des sauvages, et soumises une ducation contraignante afin de prparer leur future admission aux privilges de la libert. Tel n'est pas le principe selon lequel les classes ouvrires sont gouvernes dans un pays libre, et quiconque estime la libert sa juste valeur ne consentira jamais ce qu'elles soient gouvernes ainsi, moins qu'aprs avoir tout fait pour les initier la libert et les gouverner comme des hommes libres, il s'avre en fin de compte qu'ils ne peuvent tre gouverns que comme des enfants. Le simple nonc de l'alternative montre combien il est absurde de supposer que de tels efforts aient t faits dans tous les cas qui nous intressent ici. C'est seulement parce que les institutions de ce pays forment un tissu de contradictions qu'on voit mettre en pratique des mesures propres au systme despotique ou paternaliste, comme on l'appelle, tandis que la libert gnrale de nos institutions ne permet pas d'exercer le contrle ncessaire pour imposer la contrainte comme systme moral. Nous avons signal dans un chapitre prcdent de cet essai que la libert de l'individu dans les choses qui ne concernent que lui implique une libert correspondante pour un groupe d'individus de rgler par consentement mutuel les choses qui les concernent ensemble et ne regardent personne d'autre. La question ne prsente aucune difficult tant que la volont des personnes intresses ne change pas ; mais comme elle peut changer, il est souvent ncessaire, mme dans les choses o elles sont seules concernes, qu'elles prennent des engagements mutuels; et quand elles le font, il convient en rgle gnrale que ces engagements soient tenus. Pourtant, il est probable que dans les lois de tous les pays, cette rgle gnrale connaisse des exceptions. Non seulement les gens ne sont pas tenus de respecter des engagements qui violent les droits d'un tiers, mais on estime parfois qu'il suffit qu'un engagement leur soit dommageable eux-mmes pour les en dgager. Par exemple, dans ce pays et dans la plupart des pays civiliss, un engagement par lequel quelqu'un se vendrait ou consentirait tre vendu comme esclave serait nul et sans valeur sans appui de la loi ou de l'opinion. Le motif pour limiter ainsi le pouvoir d'un individu sur lui-mme est vident, et on le peroit trs clairement dans ce cas extrme. La raison de ne pas intervenir ( moins que d'autres ne soient menacs) dans les actes volontaires d'une personne, c'est le respect pour sa libert. Le choix volontaire d'un homme est la preuve que ce qu'il choisit ainsi est dsirable, ou du moins supportable pour lui, et en fin de compte, on ne peut mieux pourvoir son bien qu'en lui permettant de choisir
John Stuart Mill (1859), De la libert
80
ses propres moyens pour l'atteindre. Mais en se vendant comme esclave, un homme abdique sa libert; aprs cet acte unique, il renonce tout usage futur de sa libert. Il dtruit donc dans son propre cas le but mme qui justifie la permission de disposer de lui-mme. Il n'est plus libre, mais il est dsormais dans une position telle qu'on ne peut plus prsumer qu'il ait dlibrment choisi d'y rester. Le principe de libert ne peut exiger qu'il soit libre de n'tre pas libre. Ce n'est pas la libert que d'avoir la permission d'aliner sa libert. Ces raisons, dont la force est vidente dans ces cas particuliers, ont naturellement une application bien plus large ; cependant les ncessits de la vie leur imposent constamment des limites, car il nous faut toujours, non pas renoncer notre libert, mais consentir la limiter d'une faon ou d'une autre. Toutefois, le principe qui requiert la libert d'action la plus complte pour tout ce qui ne concerne que les agents, exige que ceux qui, lis l'un l'autre pour des choses qui ne concernent aucun tiers parti, puissent se dgager de leur engagement. Et mme sans cette libration volontaire, il n'y a peut-tre aucun contrat, except un engagement financier, dont on puisse oser dire qu'on ne devrait jamais tre libre de s'en rtracter. Le baron Wilhelm von Humboldt, dans l'excellent essai que j'ai dj cit, affirme que selon lui, les engagements qui impliquent des relations ou des services personnels ne devraient jamais lier lgalement au-del d'un temps limit, et que le plus important de ces engagements, le mariage - dont la particularit est de manquer son but ds lors que les sentiments des deux partis ne s'accordent pas avec celui-ci devrait pouvoir tre dissout par la simple volont dclare d'un des partenaires. Ce sujet est trop important et trop compliqu pour tre discut entre parenthses, et je ne fais que l'effleurer des fins d'illustration. Si la concision et la gnralit de l'essai de Humboldt ne l'avaient pas oblig se contenter d'noncer sa conclusion sans en discuter les prmisses, nul doute qu'il et reconnu qu'on ne peut trancher cette question sur des principes aussi simples que ceux auxquels il se confine. Quand quelqu'un, soit par une promesse expresse, soit par -sa conduite, en a encourag une autre compter qu'elle agira d'une certaine faon - fonder des esprances, 4 faire des prvisions et hasarder une part de sa vie sur cette supposition -, celui-ci s'est cr envers l'autre une nouvelle srie d'obligations morales, lesquelles peuvent ventuellement tre annules, mais non pas ignores. En outre, si la relation entre les deux parties contractantes a t suivie de consquences pour d'autres - si elle a plac un tiers dans une position particulire, ou si comme dans le mariage, elle a donn naissance des tiers -, les deux parties contractantes se sont cr des obligations envers ceux-ci, dont l'accomplissement sera grandement affect par la continuation ou la rupture de la relation entre les parties originales du contrat. Il ne s'ensuit pas - et je ne saurais l'admettre que ces obligations aillent jusqu' exiger l'accomplissement du contrat au prix du bonheur de la partie rticente ; mais elles sont un lment ncessaire de la question ; et mme si, comme Humboldt le soutient, elles ne doivent faire aucune diffrence dans la libert lgale qu'ont les parties de se dfaire de l'engagement (et je prtends qu'elles ne devraient pas en faire beaucoup), ces obligations font ncessairement une grande diffrence en ce qui concerne la libert morale. L'individu doit tenir compte de toutes ces circonstances avant de se rsoudre franchir un pas qui peut tant affecter les intrts d'autrui ; et s'il n'accorde pas la considration voulue celles-ci, il est moralement responsable du tort caus. J'ai fait ces remarques videntes afin de
John Stuart Mill (1859), De la libert
81
mieux illustrer le principe gnral de la libert, et non parce qu'elles en disent davantage sur cette question qui, au contraire, est toujours discute comme si l'intrt des enfants tait tout, et celui des adultes, rien. J'ai dj pu observer qu' cause de l'absence de principes gnraux reconnus, la libert est souvent accorde l o elle devrait tre refuse, et refuse l o elle devrait tre accorde ; et l'un des cas o le sentiment de libert est le plus fort dans le monde europen moderne, est de ceux o, selon moi, il est totalement dplac. Une personne devrait tre libre de mener ses propres affaires son gr ; mais elle ne devrait pas tre libre de faire ce qu'elle veut lorsqu'elle agit pour un autre, sous prtexte que ses affaires sont aussi les siennes. Tout en respectant la libert de chacun dans ce qui le concerne prioritairement l'tat est oblig de surveiller de prs la faon dont l'individu use du pouvoir qu'on lui a octroy sur d'autres. Cette obligation est presqu'entirement nglige dans le cas des relations familiales - cas qui, par son influence directe sur le bonheur humain est plus important que tous les autres pris ensemble. Point n'est besoin de s'tendre ici sur le pouvoir peu prs despotique des maris sur les femmes, parce qu'il ne faudrait rien moins, pour extirper ce mal, qu'accorder aux femmes les mmes droits et la mme protection lgale qu' tout autre personne, et puis parce que, sur ce sujet, les dfenseurs de l'injustice rgnante ne se prvalent pas de l'excuse de la libert, mais se posent ouvertement comme des champions du pouvoir. C'est dans le cas des enfants que le mauvais usage de l'ide de libert empche rellement l'tat de remplir ses devoirs. On croirait presque que les enfants font littralement partie d'un homme (et ce n'est pas seulement une mtaphore), tant l'opinion est jalouse de la moindre intervention de la loi dans le contrle absolu qu'il exerce sur eux, plus jalouse encore que du moindre empitement sur sa libert d'action prive, tant il est vrai que l'humanit attache gnralement plus de prix au pouvoir qu' la libert. Prenons l'exemple de l'ducation. N'est-il pas axiomatique que l'tat doive exiger et imposer l'ducation de ses jeunes citoyens, au moins jusqu' un certain niveau ? Pourtant qui ne craint pas de reconnatre et de dfendre cette vrit ? Presque personne ne niera en effet que l'un des devoirs les plus sacrs des parents (ou plutt, selon la loi et l'usage, du pre), c'est de donner l'tre humain qu'ils ont mis au monde une ducation qui lui permette de bien tenir son rle dans la vie tant envers les autres qu'envers lui-mme. Mais, tandis que l'on dclare unanimement que tel est le devoir du pre, presque personne dans ce pays ne supportera l'ide qu'on l'oblige remplir ce devoir. Au lieu d'exiger d'un homme qu'il fasse des efforts et des sacrifices pour assurer l'ducation de son enfant, on le laisse libre de refuser ou d'accepter cette ducation offerte gratuitement ! On ne reconnat toujours pas que mettre un enfant au monde sans tre certain de pouvoir lui fournir non seulement la nourriture ncessaire son corps, mais encore l'instruction et l'exercice ncessaires son esprit, on ne reconnat pas que cela est un crime la fois envers le malheureux rejeton et envers la socit, et que si les parents ne satisfont pas cette obligation, c'est l'tat qui devrait veiller ce qu'il en soit pourvu, et cela autant que possible la charge des parents. Si l'on admettait un jour le devoir d'imposer l'ducation universelle, il n'y aurait plus de difficults quant ce que l'tat doit enseigner et sur la faon de l'enseigner -
John Stuart Mill (1859), De la libert
82
difficults qui, pour le moment, constituent un vritable champ de bataille pour les sectes et les partis ; c'est ainsi qu'on perd du temps et de l'nergie se quereller autour de l'ducation, au lieu de s'y consacrer. Si le gouvernement prenait la dcision d'exiger une bonne ducation pour tous les enfants, il s'viterait la peine de leur en fournir une. Il pourrait laisser aux parents le soin de faire duquer leurs enfants o et comme ils le souhaitent, suivant les besoins de chacun, et se contenter de payer une partie des frais de scolarit des enfants les plus pauvres et de s'en charger compltement pour ceux qui n'ont personne d'autre pour y pourvoir. Les objections qu'on oppose avec raison l'ducation publique ne portent pas sur le fait que l'tat impose l'ducation, mais sur ce qu'il se charge de la diriger, ce qui est tout diffrent. Je rprouve autant que quiconque l'ide de laisser partiellement ou totalement l'ducation aux mains de l'tat. Tout ce que j'ai dit de l'importance de l'individualit du caractre, ainsi que de la diversit des opinions et des modes de vie, implique tout autant la diversit de l'ducation. Une ducation gnrale dispense par l'tat ne peut tre qu'un dispositif visant fabriquer des gens sur le mme modle; et comme le moule dans lequel on les coulerait serait celui qui satisfait le pouvoir dominant au sein du gouvernement - prtres, aristocratie ou majorit de la gnration actuelle -, plus cette ducation serait efficace, plus elle tablirait un despotisme sur l'esprit, qui ne manquerait pas de gagner le corps. Une ducation institue et contrle par l'tat ne devrait figurer tout au plus qu' titre d'exprience parmi d'autres, qu' titre d'exemple et de stimulant propre maintenir les autres expriences un bon niveau. moins, bien sr, que la socit soit dans son ensemble si arrire qu'elle ne puisse ou ne veuille se donner des institutions scolaires convenables sans que le gouvernement ne s'en charge. Dans ce cas seulement, pour choisir le moindre de ces deux grands maux, le gouvernement pourrait alors se charger des coles et des universits, comme de constituer des socits par action dans un pays o les entreprises prives ne sont pas de taille entreprendre de grands travaux industriels. Mais en gnral, si le pays dispose d'assez de personnes qualifies pour enseigner sous les auspices du gouvernement, ces mmes personnes pourraient tout autant enseigner dans un systme priv, puisque leur rmunration serait garantie par une loi rendant l'ducation obligatoire, double d'une aide de ]'tat destine ceux qui seraient incapables de prendre la dpense leur charge. Le seul moyen de faire respecter la loi serait d'imposer des examens publics tous les enfants ds le plus jeune ge. On pourrait fixer un ge auquel tout enfant serait examin pour vrifier qu'il (ou elle) sait lire. Si un enfant s'en montrait incapable, le pre, moins d'une excuse valable, pourrait recevoir une amende modre, acquitter au besoin sur son salaire, et l'enfant pourrait alors tre envoy l'cole ses frais. L'examen pourrait avoir lieu une fois par an, sur un ventail de matires toujours plus large, afin de rendre obligatoire l'acquisition et (surtout) la mmorisation d'un minimum de connaissances gnrales. Au-del de ce minimum, on instaurerait des examens facultatifs dans toutes les matires, en vertu desquels tous ceux qui seraient parvenus un certain niveau de comptence auraient droit un certificat. Pour empcher l'tat d'exercer ainsi trop d'influence sur l'opinion, la connaissance exige pour passer un examen, mme de haut niveau (au-del des domaines purement instrumen-
John Stuart Mill (1859), De la libert
83
taux du savoir tels que les langues et leur pratique), on devrait se limiter exclusivement aux faits et la science positive. Les examens sur la religion, la politique ou tout autre matire controverse ne porteraient pas sur la vrit ou la fausset des opinions, mais sur le fait que telle ou telle opinion est dfendue par tels arguments, par tels auteurs, coles ou glises. Grce ce systme, la gnration montante ne serait pas plus mal pourvue qu'aujourd'hui face aux vrits controverses : les jeunes se rangeraient toujours parmi les anglicans ou parmi les membres d'une autre secte ; seulement, l'tat veillerait ce que dans les deux cas, ils fussent instruits. Rien n'empcherait de leur enseigner la religion avec l'accord des parents, dans les coles mmes o ils reoivent le reste de leur ducation. Toutes les tentatives de l'tat pour fausser les conclusions de ses citoyens sur les questions controverses sont mauvaises ; mais l'tat peut parfaitement proposer de garantir et de certifier qu'une personne possde le savoir requis pour tirer elle-mme des conclusions dignes d'intrt. Un tudiant en philosophie gagnerait pouvoir passer un examen portant la fois sur Locke et Kant, quel que soit celui qu'il prfre, et mme s'il n'adhre aucun des deux ; et il n'y a raisonnablement rien redire ce qu'on examine un athe sur les preuves du christianisme, pourvu qu'on ne l'oblige pas d'en faire profession de foi. Toutefois, il me semble que les examens dans les domaines suprieurs de la connaissance devraient tre entirement facultatifs. Ce serait accorder un pouvoir trop dangereux aux gouvernements que de leur permettre d'exclure qui bon leur semble de certaines professions - mme de l'enseignement - sous prtexte d'un manque de qualifications. Et je pense avec Wilhelm von Humboldt que les grades ou les certificats publics de connaissances scientifiques ou professionnelles devraient tre accords tous ceux qui se prsentent l'examen et le russissent, mais qu'ils ne devraient donner sur les autres concurrents aucun autre avantage que la valeur qu'attache l'opinion publique leur tmoignage. Ce n'est pas dans le seul domaine de l'ducation que des ides de libert mal utilises occultent les obligations morales des parents et l'imposition d'obligations lgales quand on aurait toujours les meilleures raisons de le faire. Le fait mme de donner naissance un tre humain est l'une des actions qui entrane le plus de responsabilits dans la vie. Prendre cette responsabilit - donner une vie qui peut s'avrer une bndiction ou une maldiction - est un crime envers l'tre qui on la donne s'il n'a pas les chances ordinaires de mener une vie dsirable. Et dans un pays trop peupl ou en voie de le devenir, mettre au monde trop d'enfants, dvaluer ainsi le prix du travail par leur entre en comptition, c'est faire grand tort tous ceux qui vivent de leur travail. Ces lois qui, dans nombre de pays du Continent, interdisent le mariage aux couples qui ne peuvent pas prouver qu'ils ont les moyens de nourrir une famille, n'outrepassent pas le pouvoir lgitime de l'tat ; et par ailleurs, que de telles lois soient ou non bienvenues (question qui dpend principalement des circonstances et des sentiments locaux), on ne peut leur reprocher d'tre des violations de la libert. C'est grce de telles lois que l'tat peut prvenir un acte funeste un acte dommageable pour autrui - qu'il faut soumettre la rprobation ou au blme social, mme si l'on juge inopportun de le doubler d'une punition lgale. Pourtant, les ides courantes de libert, lesquelles se prtent si aisment aux violations relles de la libert de l'individu dans les affaires qui ne concernent que lui, rsisteraient presque toute tentative de restreindre tant soi peu ses inclinations, et cela mme lorsque leur
John Stuart Mill (1859), De la libert
84
satisfaction condamne sa progniture une vie de misre et de dpravation et cause leur entourage de nombreuses souffrances. Si l'on compare ce mlange d'trange respect et d'irrespect de l'humanit envers la libert, on croirait presque que les hommes ont ncessairement le droit de nuire aux autres, et aucun droit de se satisfaire sans faire souffrir quelqu'un. J'ai rserv pour la fin toute une srie de questions sur les limites de l'intervention du gouvernement qui, quoiqu'troitement lies au sujet de cet essai, n'en font pas rigoureusement partie. Ce sont les cas o les raisons contre cette intervention ne se fondent pas sur le principe de libert ; la question ne porte plus sur la restriction des actions des individus, mais sur leur encouragement: on se demande si le gouvernement devrait faire ou donner les moyens de faire quelque chose pour leur bien, au lieu de les laisser s'en occuper individuellement ou en s'associant. Les objections contre l'intervention du gouvernement, quand elle n'implique pas une violation de la libert, peuvent tre de trois sortes. La premire s'applique quand la chose faire est susceptible d'tre mieux faite par les individus que par le gouvernement. En gnral, personne n'est mieux mme de diriger une affaire, ou de dcider par qui ou comment elle doit tre conduite, que ceux qui y sont personnellement intresss. Ce principe condamne les interventions, autrefois si frquentes, des lgislateurs ou des fonctionnaires dans les oprations ordinaires de l'industrie. Mais cette aspect du sujet a t suffisamment dvelopp par les conomistes politiques et n'est pas particulirement li aux principes de cet essai. La seconde objection se rattache plus troitement notre sujet. Dans de nombreux cas, bien que la moyenne des individus ne puissent pas faire certaines choses aussi bien que les fonctionnaires, il est nanmoins souhaitable que ce soit eux qui les fassent, et non pas le gouvernement, afin de contribuer leur ducation intellectuelle, de fortifier leurs facults actives, d'exercer leur jugement et de les familiariser avec les sujets dont on les laisse ainsi s'occuper. C'est l la principale, mais non l'unique recommandation du jugement par jury (pour les cas non politiques) des institutions libres et populaires l'chelon local et municipal, d'entreprises industrielles et philanthropiques par des associations volontaires. Ce ne sont pas l des questions de libert, et elles ne se rapportent que de loin ce sujet ; mais ce sont davantage des questions de dveloppement. Il ne nous appartient pas ici de nous tendre sur l'utilit de toutes ces choses en tant qu'aspects de l'ducation de la nation, puisqu'elles font partie en vrit de l'ducation particulire du citoyen, la partie pratique de l'ducation politique d'un peuple libre. Elles tirent l'homme du cercle troit de l'gosme personnel et familial pour le familiariser avec les intrts communs et la direction des affaires communes ; elles l'habituent agir sur des motifs publics et semi-publics, et orienter sa conduite des fins qui le rapprochent des autres au lieu de l'en isoler. Sans ces habitudes et ces facults, une constitution libre ne peut ni fonctionner ni se perptuer, comme le montre trop souvent la nature transitoire de la libert politique dans les pays o elle ne se fonde pas sur une base assez solide de liberts locales. La direction
John Stuart Mill (1859), De la libert
85
des affaires purement locales par les localits, et celle des grandes entreprises industrielles par l'union de ceux qui les financent volontairement se recommandent en outre par tous les avantages qui, comme nous l'avons montr dans cet essai, sont inhrents au dveloppement individuel et la diversit des faons d'agir. Les oprations du gouvernement tendent tre partout les mmes. En revanche, les individus et les associations volontaires produisent une immense et constante varit de tentatives et d'expriences. Ce que l'tat peut faire utilement, c'est de faire office de dpositaire et diffuseur actif des expriences rsultant des nombreux essais. Sa tche est de permettre tout exprimentateur de bnficier des expriences d'autrui, au lieu de ne tolrer que les siennes. La dernire et la plus forte raison de restreindre l'intervention du gouvernement est le mal extrme que cause l'largissement sans ncessit de son pouvoir. Toute fonction ajoute celle qu'exerce dj le gouvernement diffuse plus largement son influence sur les espoirs et les craintes, et transforme davantage les lments actifs et ambitieux du public en parasites ou en comploteurs. Si les routes, les chemins de fer, les banques, les compagnies d'assurances, les grandes compagnies capital social, les universits et les tablissements de bienfaisance taient autant de branches du gouvernement; si, de plus, les corporations municipales et les conseils locaux, avec tout ce qui leur incombe aujourd'hui, devenaient autant de dpartements de l'administration centrale; si les employs de toutes ces diverses entreprises taient nomms et pays par le gouvernement et n'attendaient que de lui leur avancement, toute la libert de la presse et toute la constitution dmocratique n'empcheraient pas ce pays ni aucun autre de n'tre libre que de nom. Et le mal serait d'autant plus grand que la machine administrative serait construite plus efficacement et savamment, et qu'on aurait recours aux procds les plus habiles pour se procurer les mains et les cerveaux les plus qualifis pour la faire fonctionner. En Angleterre, on a propos dernirement de slectionner tous les membres de l'administration gouvernementale sur concours, afin de placer ces postes les personnes les plus intelligentes et les plus instruites parmi les candidats; et on a beaucoup dit et crit pour et contre cette proposition. L'un des arguments sur lesquels ses adversaires ont le plus insist, c'est que l'emploi de fonctionnaire permanent de l'tat n'offre pas de perspective de recevoir une rmunration suffisante et de jouer un rle assez important pour attirer les meilleurs talents, lesquels trouveront toujours des carrires plus attrayantes dans les professions librales, au service de compagnies ou d'autres corps publics. On n'aurait pas t surpris que cet argument vnt de partisans de la proposition comme une rponse sa difficult principale. Venant de ses adversaires, elle est pour le moins curieuse. Ce qu'on avance comme une objection est la soupape de scurit du systme en question. Car si tous les meilleurs talents du pays pouvaient tre attirs au service du gouvernement, une proposition visant ce rsultat aurait assurment de quoi inquiter. Si toutes les affaires de la socit qui ncessitent une organisation concerte, ou des vues larges et englobantes, taient entre les mains de l'tat, et si toutes les fonctions gouvernementales taient universellement remplies par les hommes les plus capables, alors toute la culture au sens large, toute l'intelligence pratique du pays ( l'exception de l'intelligence purement spculative), seraient concentres en une bureaucratie nombreuse,
John Stuart Mill (1859), De la libert
86
bureaucratie dont le reste de la communaut attendrait tout: les conseils et les ordres pour les masses, l'avancement personnel pour les intelligents et les ambitieux. tre admis dans les rangs de cette bureaucratie, et en gravir les chelons une fois admis, tels seraient les seuls objets d'ambition. Sous ce rgime, non seulement le public extrieur est mal qualifi par manque d'exprience pratique pour contrler et critiquer, le systme bureaucratique, mais, mme si les hasards du fonctionnement naturel d'institutions despotiques ou dmocratiques portent au sommet un ou plusieurs dirigeants rformateurs, aucune rforme contraire aux intrts de la bureaucratie ne peut tre adopte. Telle est la triste condition de l'empire russe, comme le montrent les compte rendus de ceux qui ont pu l'observer. Le Tsar lui-mme est impuissant contre le corps bureaucratique; il peut envoyer chacun de ses membres en Sibrie, mais il ne peut gouverner sans eux ni contre leur volont. Ils peuvent mettre un veto tacite sur tous les dcrets, simplement en s'abstenant de les appliquer. Dans des pays d'une civilisation plus avance et d'un esprit plus insurrectionnel, les gens, habitus attendre que l'tat fasse tout pour eux - ou du moins ne rien faire par eux-mmes sans que l'tat leur en ait non seulement accord la permission, mais indiqu la marche suivre -, ces gens tiennent naturellement l'tat pour responsable de tout ce qui leur arrive de fcheux, et lorsque les maux excdent leur patience, ils se soulvent contre le gouvernement et font ce qu'on appelle une rvolution; aprs quoi, quelqu'un d'autre, avec ou sans l'autorit lgitime de la nation, saute sur le trne, donne ses ordres la bureaucratie, et tout reprend comme avant, sans que la bureaucratie ait chang et que personne soit capable de la remplacer. Un peuple habitu mener ses propres affaires offre un spectacle tout diffrent. En France, o une grande partie des gens ont fait leur service militaire et o beaucoup d'entre eux ont eu au moins le grade de sous-officier, il se trouve dans toutes les insurrections populaires quelques personnes comptentes pour en prendre le commandement et improviser un plan d'action passable. Ce que sont les Franais dans les affaires militaires, les Amricains le sont dans toute sorte d'affaires civiles : laissezles sans gouvernement, et n'importe quel groupe d'Amricains est capable d'en improviser un et de mener cette affaire ou tout autre affaire civile, avec assez d'intelligence, d'ordre et de dcision. Voil comment devrait tre tout peuple libre : il ne se laissera jamais asservir par aucun homme ou groupe d'hommes parce qu'il est capable de s'emparer et de tenir les rnes de l'administration centrale. Aucune bureaucratie ne peut esprer contraindre un tel peuple faire ou subir ce qui ne lui plat pas. Mais l o la bureaucratie fait tout, rien de ce quoi elle est rellement hostile ne peut tre fait. La constitution de tels pays est une combinaison de l'exprience et des talents pratiques concentre en un corps disciplin, destin gouverner les autres ; et plus l'organisation est parfaite en elle-mme, mieux elle russit attirer et duquer dans son sens les gens les plus brillants de toutes les classes de la socit, plus l'asservissement de tous, y compris des membres de la bureaucratie, est complet. Car les gouvernants sont autant les esclaves de leur organisation et de leur discipline que les gouverns ne le sont des gouvernants. Un mandarin chinois est tout autant l'outil et la crature du despotisme que le plus humble cultivateur. Un Jsuite est l'esclave de son
John Stuart Mill (1859), De la libert
87
ordre au plus haut point d'avilissement, bien que l'ordre lui-mme existe de par le pouvoir collectif et l'importance de ses membres. Il ne faut pas oublier non plus que l'absorption de toutes les grandes intelligences du pays par la classe gouvernante est fatale tt ou tard l'activit et au progrs intellectuel de cette classe elle-mme. Lis comme le sont ses membres faire fonctionner un systme qui, comme tous les systmes, procde dans une large mesure par des rgles fixes, le corps des fonctionnaires est continuellement tent de sombrer dans une indolente routine ; ou s'ils sortent de temps autre du systme, c'est pour se lancer dans quelque embryon de projet qui a frapp l'imagination d'un des membres influents de ce corps ; et le seul moyen de contrler ces tendances trs proches, bien qu'apparemment opposes, le seul moyen de maintenir les intelligences de ce corps un bon niveau, c'est de rester ouvert la critique vigilante, indpendante et forme elle aussi de grandes intelligences. C'est pourquoi il faut pouvoir former de telles comptences en dehors du gouvernement et leur fournir les occasions et l'exprience ncessaires pour concevoir un jugement correct dans les affaires pratiques. Si nous voulons avoir en permanence un corps de fonctionnaires habile et efficace - et pardessus tout susceptible de crer le progrs et dispos l'adopter - et si nous ne voulons pas que notre bureaucratie dgnre en pdantocratie , il ne faut pas que ce corps absorbe les emplois qui forment et cultivent les facults requises pour gouverner les hommes. Savoir o commencent ces maux si redoutables pour la libert et le progrs humain, ou plutt savoir o ils commencent l'emporter sur les bienfaits, lesquels naissent de l'usage collectif de la force sociale et des directives de ses chefs officiels et visent supprimer les obstacles notre bien-tre ; bref, garantir autant que possible les avantages de la centralisation politique et intellectuelle, sans pour autant dtourner dans les voies officielles une trop grande proportion de l'activit gnrale - voil une des questions les plus difficiles de l'art de gouverner. C'est dans une large mesure une question de dtails, o les considrations les plus nombreuses et les plus varies doivent tre prises en compte, et o l'on ne peut poser de rgles absolues. Mais je crois que le principe pratique sur lequel repose notre salut, l'idal ne pas perdre de vue, le critre de jugement de tous les dispositifs invents pour vaincre la difficult, peut s'exprimer ainsi : la plus grande dissmination de pouvoir conciliable avec l'efficacit; mais la plus grande centralisation possible de l'information et sa diffusion plus grande partir du centre. Ainsi il y aurait dans l'administration municipale - comme dans les tats de la Nouvelle-Angleterre - un partage trs soigneux entre les fonctionnaires de chaque localit de toutes les affaires qu'on n'aurait pas avantage laisser aux mains des personnes directement intresses ; mais ct de cela, il y aurait dans chaque dpartement des affaires locales, une superintendance, formant une branche du gouvernement gnral. L'organe de cette superintendance concentrerait, comme en un foyer, toute la varit des informations et expriences provenant de la direction de cette branche des affaires publiques dans toutes les localits, ainsi que de tout ce qu'on fait danalogue dans les pays trangers et de ce qu'on peut tirer des principes gnraux de la science politique. Cet organe central aurait le droit de savoir tout ce
John Stuart Mill (1859), De la libert
88
qui se fait, et sa mission serait de rendre disponibles ailleurs les connaissances acquises dans un endroit. mancips des prjugs mesquins et des vues troites d'une localit de par sa position leve et l'tendue de la sphre de ses observations, ses conseils auraient du mme coup davantage d'autorit; mais son pouvoir rel, en tant qu'institution permanente, devrait se limiter, selon moi, obliger les fonctionnaires se conformer aux lois tablies pour les diriger. Pour tout ce qui n'est pas prvu dans les rgles gnrales, ces fonctionnaires devraient tre laisss libres d'exercer leur propre jugement et d'en rpondre devant leurs mandants. Pour la violation des rgles, ils seraient responsables devant la loi, et les rgles elles-mmes seraient dictes par le lgislatif, l'autorit administrative centrale ne veillant qu' leur application; et en cas de mauvaise application, l'autorit en appellerait, selon la nature du cas, soit au tribunal pour faire respecter la loi, soit aux lecteurs pour renvoyer les fonctionnaires qui n'auraient pas appliqu cette loi selon son esprit. Telle est, dans son ensemble, la superintendance centrale que le Bureau de la loi des pauvres est cense exercer sur les administrateurs du Conseil des pauvres dans tout le pays. Quelque soit l'usurpation de pouvoir que commette le Bureau dans ce domaine, elle est juste et ncessaire, puisqu'il s'agit de corriger les habitudes de mauvaise administration dans les questions qui intressent non seulement les localits, mais toute la communaut, puisque nulle localit n'a le droit de se transformer par la dficience de son administration en un nid de pauprisme, susceptible de gagner d'autres localits et de dtriorer la condition morale et physique de toute la communaut ouvrire. Bien que les pouvoirs de coercition administrative et de lgislation subordonne que possde le Bureau de la loi des pauvres (mais qu'il n'exerce qu'avec parcimonie tant donn l'tat de l'opinion sur le sujet), soient parfaitement justifiables l o il y va d'intrts nationaux de premire importance, ils seraient totalement dplacs pour la surveillance d'intrts purement locaux. Mais un organe central d'information et d'instruction pour toutes les localits seraient galement prcieux dans tous les dpartements de l'administration. Un gouvernement ne saurait se priver de cette sorte d'activit qui n'empche pas, mais aide et stimule au contraire les efforts et le dveloppement individuels. Le mal commence quand, au lieu de stimuler l'activit et la force des individus et des associations, le gouvernement substitue sa propre activit la leur ; quand, au lieu d'informer, de conseiller, et l'occasion de dnoncer, il les enchane leur travail, ou leur ordonne de s'effacer pendant qu'il fait leur travail leur place. La valeur d'un tat, la longue, c'est la valeur des individus qui le composent ; et un tat qui sacrifie les intrts de leur lvation intellectuelle un peu plus d'art administratif ou l'apparence qu'en donne la pratique - dans le dtail des affaires ; un tat qui rapetisse les hommes pour en faire des instruments dociles entre ses mains, mme en vue de bienfaits, un tel tat s'apercevra qu'avec de petits hommes, rien de grand ne saurait s'accomplir, et que la perfection de la machine laquelle il a tout sacrifi n'aboutit finalement rien, faute de cette puissance vitale qu'il lui a plu de proscrire pour faciliter le jeu de la machine.
You might also like
- Mill LibertepdfDocument88 pagesMill LibertepdfMakis SaintilNo ratings yet
- John Stuart Mill Introduction de La LibertéDocument12 pagesJohn Stuart Mill Introduction de La LibertéNICOMAQUE IINo ratings yet
- Droits de L - Homme PDFDocument24 pagesDroits de L - Homme PDFdidiertNo ratings yet
- E Regimes Pol 11Document9 pagesE Regimes Pol 11nurselinNo ratings yet
- TP EducitDocument10 pagesTP Educityannick0% (1)
- Sur Le Controle de Nos Vies - Noam ChomskyDocument52 pagesSur Le Controle de Nos Vies - Noam ChomskyCarla Fernanda da Silva100% (1)
- Cours Familier de Littérature (Volume 12) Un entretien par moisFrom EverandCours Familier de Littérature (Volume 12) Un entretien par moisNo ratings yet
- Fiche de Revision HGGS 2021 Comprendre Un Regime Politique La DemocratieDocument6 pagesFiche de Revision HGGS 2021 Comprendre Un Regime Politique La DemocratieSlin100% (2)
- Libéralisme Et Démocratie Sont-Ils Conciliables ?: To Cite This VersionDocument9 pagesLibéralisme Et Démocratie Sont-Ils Conciliables ?: To Cite This Versionabelabelscofield08No ratings yet
- Deux Conceptions de La Liberté, Par Isaiah Berlin - ContrepointsDocument5 pagesDeux Conceptions de La Liberté, Par Isaiah Berlin - Contrepointsjgautier2100% (2)
- L'État et ses limites: Suivi d'essais politiques sur Alexis de Tocqueville, l'instruction publique, les finances, le droit de pétitionFrom EverandL'État et ses limites: Suivi d'essais politiques sur Alexis de Tocqueville, l'instruction publique, les finances, le droit de pétitionNo ratings yet
- Esprit LumièresDocument4 pagesEsprit LumièresLouis BergNo ratings yet
- Chomsky WazanniDocument5 pagesChomsky WazanniStanNo ratings yet
- DM Résumé MPSI1 Tocqueville (Enregistré Automatiquement)Document4 pagesDM Résumé MPSI1 Tocqueville (Enregistré Automatiquement)Aminata KhouleNo ratings yet
- Texte 2 - Todorov (2012)Document3 pagesTexte 2 - Todorov (2012)Romina DLNo ratings yet
- Hume, David - Essai Sur Les Premiers Principes Du Gouvernement (Uqac)Document6 pagesHume, David - Essai Sur Les Premiers Principes Du Gouvernement (Uqac)SugarplantationNo ratings yet
- Texte Sur L'étatDocument2 pagesTexte Sur L'étatSerigne Saliou SowNo ratings yet
- La Spécificité Des Systémes DémocratiquesDocument4 pagesLa Spécificité Des Systémes Démocratiquesfphyl09100% (2)
- Axe 2.diapo Tocqueville 2023 EleveDocument17 pagesAxe 2.diapo Tocqueville 2023 Elevewhpksft6hgNo ratings yet
- Cours de Philosophie Politique 2018-2019Document7 pagesCours de Philosophie Politique 2018-2019HEKPAZO GontrantNo ratings yet
- Les Racines Du Libéralisme Une Anthologie by Pierre-François MoreauDocument188 pagesLes Racines Du Libéralisme Une Anthologie by Pierre-François MoreauJoel MendesNo ratings yet
- État Et LibertéDocument30 pagesÉtat Et Libertémounir57No ratings yet
- Au Delà de L' Etat NationDocument4 pagesAu Delà de L' Etat NationMikael MoazanNo ratings yet
- Ethique L1 - Chap 4Document8 pagesEthique L1 - Chap 4PharelleNo ratings yet
- ECm 1ere PDFDocument46 pagesECm 1ere PDFJustin Domga Damo100% (1)
- De la Démocratie en Amérique, tome deuxièmeFrom EverandDe la Démocratie en Amérique, tome deuxièmeRating: 4 out of 5 stars4/5 (54)
- Définitions Science PolitiqueDocument5 pagesDéfinitions Science Politiquedavidseguin17No ratings yet
- Droit PublicDocument62 pagesDroit PublicHanan Fernandez-Boulaajoul100% (1)
- Alexis de Tocqueville Et La Démocratie LibéraleDocument3 pagesAlexis de Tocqueville Et La Démocratie LibéraledaadaadaadNo ratings yet
- La Face Cachée de L'ONU - Michel SchooyansDocument319 pagesLa Face Cachée de L'ONU - Michel SchooyansYure Araujo67% (3)
- Leçon 1 ECM 3èDocument1 pageLeçon 1 ECM 3èALIOUM HAMADOUNo ratings yet
- Droit de La 2ème GénérationDocument22 pagesDroit de La 2ème GénérationKarimNo ratings yet
- Rancière - La Haine de La Démocratie 2005 PDFDocument106 pagesRancière - La Haine de La Démocratie 2005 PDFdoommood213No ratings yet
- Rancière, Jacques - La Haine de La Démocratie-La Fabrique Ed. (2013)Document106 pagesRancière, Jacques - La Haine de La Démocratie-La Fabrique Ed. (2013)Miris RoodNo ratings yet
- K Comme KapitalDocument8 pagesK Comme KapitalCREPELNo ratings yet
- Chapitre 2 Alexis de TocquevilleDocument4 pagesChapitre 2 Alexis de TocquevilleAyyoub FAKCHICHNo ratings yet
- 05-2014 - Democratie 0Document9 pages05-2014 - Democratie 0Vladimyr FleuryNo ratings yet
- Droit Const 2Document80 pagesDroit Const 2lucianaassengonenzangNo ratings yet
- Constant Liberté AnciensDocument24 pagesConstant Liberté AnciensThierry SaesNo ratings yet
- La Myopie Des DémocratiesDocument4 pagesLa Myopie Des Démocratiesngong ernestNo ratings yet
- Ranciere, Jacques-La Haine de La DémocratieDocument46 pagesRanciere, Jacques-La Haine de La Démocratie140871raph100% (3)
- Theorie de L'etat A19 UnilDocument49 pagesTheorie de L'etat A19 UnilDarfea Di BlasiNo ratings yet
- Faut-Il Haïr La Démocratie? Par Yves CussetDocument13 pagesFaut-Il Haïr La Démocratie? Par Yves CussetLeonardo David HdezNo ratings yet
- La Nouvelle Inquisition Alain de BenoistDocument22 pagesLa Nouvelle Inquisition Alain de BenoistRaibaut PamiNo ratings yet
- Thème I La DémocratieDocument7 pagesThème I La DémocratieS A BNo ratings yet
- Expose MLP2018 01 22critique Democratie PlatonDocument4 pagesExpose MLP2018 01 22critique Democratie Platonnathan joel kleNo ratings yet
- Université Hassan II EXPOSE CITOYEN-1-1Document12 pagesUniversité Hassan II EXPOSE CITOYEN-1-1zineb lemhainiNo ratings yet
- Foucault1976 - Droit de Mort Et Pouvoir Sur La Vie PDFDocument4 pagesFoucault1976 - Droit de Mort Et Pouvoir Sur La Vie PDFmattdelezNo ratings yet
- De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en SuisseFrom EverandDe la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en SuisseNo ratings yet
- Machiavel Hobbes Lumières Et FéminismeDocument2 pagesMachiavel Hobbes Lumières Et FéminismeBès BasileNo ratings yet
- Chapitre 4 - La Souveraineté Et Dévolution Du PouvoirDocument7 pagesChapitre 4 - La Souveraineté Et Dévolution Du Pouvoirannececilepicard10No ratings yet
- Pouvoir Et Liberté Dans Les SociétésDocument26 pagesPouvoir Et Liberté Dans Les SociétésrebuberNo ratings yet
- Introduction Institution PolitiqueDocument38 pagesIntroduction Institution PolitiqueThéo MaigrotNo ratings yet
- Chapitre 4 Élève SecondeDocument13 pagesChapitre 4 Élève SecondeServiteur d’AllahNo ratings yet
- 1 La Notion DEtatDocument10 pages1 La Notion DEtatflorentbrunet4488No ratings yet
- De La Démocratie en Amérique - RésuméDocument26 pagesDe La Démocratie en Amérique - Résuméchakourali67No ratings yet
- La chute de l'empire romain: Etudes ou discours historiquesFrom EverandLa chute de l'empire romain: Etudes ou discours historiquesNo ratings yet
- Le LibéralismeDocument3 pagesLe LibéralismeLidia FloresNo ratings yet
- Liberté Des Anciens, Liberté Des Modernes 2Document2 pagesLiberté Des Anciens, Liberté Des Modernes 255tqhnfhgsNo ratings yet
- Alain - Esquisses de L'hommeDocument203 pagesAlain - Esquisses de L'hommeSimon LariviereNo ratings yet
- Verlaine, Paul - ElegiesDocument56 pagesVerlaine, Paul - Elegiesrebecca.geo1789No ratings yet
- Kierkegaard, La Reprise PDFDocument95 pagesKierkegaard, La Reprise PDFandreBishop100% (5)
- Zhuang Zi - Le Livre de Tschouang-Tseu (Document275 pagesZhuang Zi - Le Livre de Tschouang-Tseu (rebecca.geo1789No ratings yet
- Claude Henry Du Bord La Philosophie PDFDocument514 pagesClaude Henry Du Bord La Philosophie PDFSalihabensala100% (1)
- Julien Benda-La Trahison Des ClercsDocument275 pagesJulien Benda-La Trahison Des ClercsAmiral Koltchak100% (1)
- Arvon, Henri - Les Libertariens AméricainsDocument164 pagesArvon, Henri - Les Libertariens AméricainsOlivier Devoet100% (1)
- Alain (Emile Chartier) - Mars II. Echec de La Force (1939)Document349 pagesAlain (Emile Chartier) - Mars II. Echec de La Force (1939)rebecca.geo1789No ratings yet
- Alain (Emile Chartier) - Preliminaire A L'esthetique (1936)Document214 pagesAlain (Emile Chartier) - Preliminaire A L'esthetique (1936)rebecca.geo1789No ratings yet
- Alain (Emile Chartier) - La ConscienceDocument66 pagesAlain (Emile Chartier) - La ConscienceJacques_VachetNo ratings yet
- Wiesel, Elie - La Nuit (1958) (2008)Document210 pagesWiesel, Elie - La Nuit (1958) (2008)rebecca.geo1789100% (5)
- Alain SpinozaDocument82 pagesAlain SpinozadiettervonNo ratings yet
- Alain (Emile Chartier) - Preliminaire A L'esthetique (1936)Document214 pagesAlain (Emile Chartier) - Preliminaire A L'esthetique (1936)rebecca.geo1789No ratings yet
- Alain - Les Idees Et Les AgesDocument267 pagesAlain - Les Idees Et Les AgesIdomeneeNo ratings yet
- Alain - Humanites (1946)Document117 pagesAlain - Humanites (1946)rebecca.geo1789No ratings yet
- Alain - Esquisses de L'hommeDocument203 pagesAlain - Esquisses de L'hommeSimon LariviereNo ratings yet
- Alain - Vigiles de L'espritDocument216 pagesAlain - Vigiles de L'espritkainomidNo ratings yet
- Alain (Emile Chartier) - Abreges Pour Les Aveugles (1942)Document68 pagesAlain (Emile Chartier) - Abreges Pour Les Aveugles (1942)rebecca.geo1789No ratings yet
- Alain - Le Citoyen Contre Les PouvoirsDocument186 pagesAlain - Le Citoyen Contre Les PouvoirsIdomeneeNo ratings yet
- Alain - Elements D'une Doctrine Radicale (1925)Document343 pagesAlain - Elements D'une Doctrine Radicale (1925)rebecca.geo1789No ratings yet
- Alain - Le Citoyen Contre Les PouvoirsDocument186 pagesAlain - Le Citoyen Contre Les PouvoirsIdomeneeNo ratings yet
- Auguste Comte Systeme de Politique PositiveDocument146 pagesAuguste Comte Systeme de Politique PositivekainomidNo ratings yet
- Alain (Emile Chartier) - Saisons de L'esprit (1935)Document206 pagesAlain (Emile Chartier) - Saisons de L'esprit (1935)rebecca.geo1789No ratings yet
- Alain (Emile Chartier) - La ConscienceDocument66 pagesAlain (Emile Chartier) - La ConscienceJacques_VachetNo ratings yet
- Alain - Le Citoyen Contre Les PouvoirsDocument186 pagesAlain - Le Citoyen Contre Les PouvoirsIdomeneeNo ratings yet
- Alain (Emile Chartier) - Systeme Des Beaux Arts (1920)Document210 pagesAlain (Emile Chartier) - Systeme Des Beaux Arts (1920)rebecca.geo1789No ratings yet
- PolitiqueDocument175 pagesPolitiqueesojsorlacNo ratings yet
- Bodin Six Livres RepubliqueDocument340 pagesBodin Six Livres RepubliqueOrgasmique Nick100% (1)
- Schopenhauer - Les Fondements de La Morale (1894)Document207 pagesSchopenhauer - Les Fondements de La Morale (1894)rebecca.geo1789No ratings yet
- LA BOETIE - Le Discours de La Servitude VolontaireDocument82 pagesLA BOETIE - Le Discours de La Servitude Volontairenad_freeman_1No ratings yet